|
1er Juillet 2025 |
EUN SYIELLE D'HISTOUÈRE D'CALVADOS
|
Page 1 |
|
|
|
LANGRUNE s/MER | ||
|
Canton de Douvres-La Délivrande |
|||
|
|
|||
|
Les
pertes chez les marins étaient nombreuses, le 14 février 1702, une
effroyable tempête sévit en mer. Des 36 pêcheurs de la paroisse de
langrune qui subirent cette tempête aucun ne revint ! Certaines
veuves restèrent inconsolable, d’autres désirèrent convoler à
nouveau. Elles adressèrent une requête à l’évêque de Bayeux, Mgr
de Nesmond, qui après avoir examiné soigneusement la demande, autorisa
les veuves de matelots à se marier « s’il n’y a autre
empesschement »
17 Mai 1778 - Incendie. - De Caen le 7 juin. Le 17 du mois dernier, un violent incendie se manifesta à trois heures après-midi dans la paroisse de Langrune, située sur le bord de la mer, à trois lieues de cette ville. En deux heures et demie, soixante et une maison furent la proie des flammes qui consumèrent aussi les écuries et les étables qui en dépendent. Comme ce village n'est habité que par des matelots, il ne se trouva pour lors que 20 hommes en état de porter du secours contre le feu, le reste les habitants étant à Brest sur les vaisseaux du roi. Les familles dans les maisons ont été incendié n'ont pu sauver aucun de leurs effets, et par cet accident, elles se trouvent livrées à toutes les horreur de la plus affreuse indigence. M. Esmangard, intendant de cette généralité, n'a pas été plutôt informé de ce malheur, qu'il s'est empressé de faire passer des secours à ces infortunés. (Source : La Gazette du Commerce)
1778
- le grand incendie
de Langrune. - Lettre
sur l'incendie de Langrune. - Les détails en donneront la preuve ; je les rapporterai avec toute franchise et comme je les ai écrits à une Dame respectable. Langrune, le 18 Mai 1778. Madame, Ce matin, j’étais à Caen, j’y étais depuis une semaine, j’y étais chez M. l’intendant, ( M. Esmangart ), chaque jour j’en voulais partir pour faire un petit voyage ou l’on me promettait du plaisir, et chaque jour quelqu’obstacle me retenait, enfin aujourd'hui rien ne s’opposait plus à ce départ tant différé. Pendant
le dîner nous apprenons le désastre de Langrune, chacun fait ses
réflexions, chacun a le cœur serré. En sortant de table, on m’annonce
que mon cheval est prêt, je fais - « Je m'en vais donc du coté de Falaise ». - « Eh bien oui », me dit-il. - « C'est donc près de Falaise que je m’en vais ». - « C‘est que j’aimerais mieux aller à Langrune ». A
ces mots, M. Esmangart me serre les mains, me conduit dans son cabinet,
« que vous me feriez de plaisir » dit-il, « ne dites,
ni d'où vous venez, ni qui vous êtes, veillez à ce que tous ces
malheureux soient soulagés », et tout en parlant ainsi, il me
mettait de l’or dans mes poches, nous n’avions le temps de compter,
ni l’un ni l’autre, nos yeux s’étaient rencontrés, nos cœurs s’en
disaient bien long. J’arrive à Langrune, il n’y avait guères plus de vingt-quatre heures que l’incendie avait commencé ; je parcours bien vite ce Village ; ce spectacle me faisait grand mal ; ( je n’étais pas encore accoutumé ) on voyait assis sur des chaires ou par terre, des vieillards, des impotents, des paralytiques qui regardaient consumer les restes de leurs pauvres maisons ; ils avaient passé là toute la nuit, des femmes échevelées, l’air hagard, baignées de larmes, arrachaient des flammes quelques morceaux de linge grands comme les deux mains, c’était des restes de draps qui n'avaient encore brûlé que par les plis. Enfants,
grandes personnes, tout se lamentait, se désolait, ils me paraissaient
plus aigris qu’abattus par le malheur. Je
fais des questions, point de réponse, je n’avais encore l’air que d’un
homme curieux, quand je demande avec intérêt si quelqu’un a été
blessé, on me répond, « oui, la femme du Maréchal ». Je
vais chez le Maréchal, je demande à voir la femme, je détourne
promptement les yeux de son grabat, au lieu de mains et de visage,
paquets de chiffons et de papiers imbibés. Je demande au mari si je
puis être de quelque utilité, s’il veut que j’envoie chercher un
médecin, un chirurgien. Il me répond que sa femme n’a besoin de
personne, que Mlle Goujon est venue, je demande ce qu’est Mlle Goujon,
c'est, me dit-on, une bonne Demoiselle qui panse les malades, soigne les
pauvres et les assistés. Je me fais conduire chez elle, j’abrége les
compliments avec ses respectables parents et avec elle, et lui dis : -
« Mademoiselle, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas
non plus, mais vous secourez les malheureux, je viens vous aider, que
faut-il faire pour le moment ? »
- « Ce qu'il faut reprend-elle vivement, avez vous là du
pain pour nourrir deux cent personnes qui n’ont pas mangé depuis
hier ». -
« Du pain, non, lui dis-je, mais j’ai de l’argent, avez vous des
Boulangers dans le Village ? » -
« -
« Eh bien, allons ensemble ». Nous
allons, nous achetons tout le pain qu’ils ont et celui des
particuliers qui veulent bien nous en vendre, nous faisons porter tout
cela chez M. le Curé, je le prie de nous donner la liste des personnes
qui ont besoin de pain et de les mander. M.
le Curé choisit pour les compter, les petits filles d'une manufacture
qu’il a fait bâtir et qu'il entretient à ses frais. Le détail des
autres charités du Curé serait ici déplacé. On nous rapporte pour
réponse que ces malheureux ne veulent pas venir prendre du pain, je l’envoie,
j’envoie aussi de la farine et du lait pour les petits enfants, j’envoyez
ce que je peux trouver de viandes pour les malades, je charge un
boulanger de cuire toute la nuit, et j’accepte l’hospitalité dans
la maison de M. Goujon, qui était déjà le magasin de tous les meubles
et effets du Village. Comme cette maison est couverte de tuiles, ceux
qui l’avaient été et qui avaient sauvé quelques effets, avaient
tout porté chez M. Goujon.
On
m’apprend que l’incendie s’était communiqué d’un bout du
Village à l'autre avec une rapidité incroyable, parce que le vent
enlevait des paquets de paille enflammée et allait les porter à l’extrémité
de ce Village. Point
de possibilité d’éteindre le feu par la divette d'eau et de bras, (
deux cent des plus forts hommes de Langrune étaient alors à Brest ou
en mer pour le service de la Marine). On
m’append aussi des particularités bien touchantes et desquelles j’aurai
l’honneur de vous entretenir, quand je les aurai vérifiées. Il est
temps que je vous quitte, la fatigue m’accable. Peut-être
êtes-vous fatiguée d’avoir déchiffré ma mauvaise écriture. Je
vais prendre sur moi pour vous assurer lisiblement du respect avec
lequel je suis. (Source :
Le Journal de Paris)
Février
1790 -
Le Département du Calvados.
-
le comité de constitution chargé de proposer des appellations
nouvelles avait demandé que l’on donnât aux départements des noms
de rivières, ou des noms rappelant quelque particularités
géographique bien évidente. Or
un député du bailliage de Caen proposa pour ce qu’on appelait encore
en janvier 1790 le « département de Caen » un simple nom
de rocher, prenant ainsi une initiative originale, qui est d’ailleurs
restée unique en France. Rejetant
les noms d'Orne, de basse Orne et Orne Inférieur, auxquels le comité
avait d’abord songé, il fit adopter celui de
« Calvados ».
D’après la tradition, on doit cette appellation à une femme, mademoiselle Delaunay, bourgeois de Bayeux et sœur d’un député de cette ville, Jean baptiste Gabriel Delaunay. (Source : Calvados de René Lepelley)
Juillet
1791
-
Garde Nationale.
-
Tandis qu’on cherche à nous alarmer sur la crainte prochaine,
d’une invasion en France, nos frontières sont dans le meilleur
état , et l’Assemblée Nationale, vient de multiplier les
précautions, dans le Décret suivant :
Il
sera mis sur le champ en activité 97 000 hommes de Gardes Nationales, y
compris les 26 000 qui, par le Décret du …., ont été destinés à
la défense des frontières du Nord, ces Gardes Nationales seront
soldées et organisées conformément aux précédent Décrets, et
seront distribuées ainsi qu’il suit : En
Normandie : La Douzième division, de Saint-Malo au Grand-Vey, 3
000 hommes fournis par les départements de l’Isle et Vilaine, La
Manche et la Mayenne. Treize division, du Grand-Veys, à l’embouchure de la Somme, 4 000 hommes fournis par les départements du Calvados, de la Seine-Inférieure et de l’Eure. (Source : Conseil Général du Calvados)
Juin
1828 -
Cour d’Assises du Calvados.
- Samedi
dernier s'est terminée la session des assises : La dernière affaire et
la seule dont il nous reste à rendre compte, était Le
20 janvier, Dupuis revenant d'une partie de chasse avec 3 camarades
entre à Lyon-sur-mer dans une auberge, là se trouvaient réunis
plusieurs jeunes gens de la commune de
Langrune, et parmi eux le sieur Villy. On
se met d'abord à boire, ensuite une querelle s'engage, qui cependant
s'apaise, mais à peine est-on sorti de l'auberge, que la dispute
renaît entre les nommés Dupuis et Villy ; le premier prend la
fuite et est poursuivi par Villy. Armé de son fusil, le fugitif menace
son agresseur : « Si tu passes je te brûle », lui
crie-t-il, et au même instant Villy est atteint d'un coup dans la
cuisse. L'accusé
a soutenu par sa défense, qu'ayant fait un faux pas en se retirant, le
coup était parti malgré son intention ; il jouissait d'une très
bonne réputation, s'était lui-même constitué prisonnier, et Villy
qui est parfaitement rétabli, a été indemnisé. Tous ces motifs ayant prévalu, il a été condamné seulement en 2 années d'emprisonnement, comme coupable d'imprudence. (Le Journal de Caen et de la Normandie)
Septembre 1828 - Une trombe. - Mardi dernier il s'est formé sur la côte de Langrune une trombe qui a endommagé, dit-on, la toiture de plusieurs maisons. Un membre de la Société Linnéenne, qui se trouvait à Luc, l'a dessinée et doit en entretenir la Société. Il a bien voulu nous communiquer les détails suivants : « A quatre heures et demie du soir, un brouillard épais s'est élevé sur la mer en face le village de Langrune, ce brouillard paraissait agité, bientôt un mouvement de rotation ayant lieu, il s'est élevé peu à peu dans l'air sous la forme d'une colonne de vapeur aqueuse, et a fini par se confondre avec un nuage plus bas que les autres. En ce moment le spectacle devenait très curieux, et les baigneurs qui se trouvaient à Luc se sont portés en foule sur le rivage. Le nuage emporté par la trombe eut pu se comparer en quelque sorte à la filasse que le mouvement du rouet réduit en corde, les globules d'eau qui s'en trouvaient détachées semblaient descendre vers la mer, tandis que la vapeur épaisse enlevée aux flots vers l'autre extrémité, se dirigeait au contraire du bas en haut. Cette colonne, de forme visqueuse très remarquable, cédant sans se rompre à l'impulsion du vent, se trouvait courbe, au lieu d'être perpendiculaire. Enfin, après avoir suivi pendant dix minutes la direction du Nord-Ouest qui lui était imprimée par un vent de Sud-Ouest, elle a d'abord diminué de volume, s'est ensuite divisée en deux parties, dont l'une restait suspendue au nuage et l'autre en contact avec la mer, puis les, deux parties se réunissant un moment se sont de nouveau partagées, et n'ont pas tardé à disparaître entièrement ». (Le Journal de Caen et de la Normandie)
Février 1830 - Le froid. - Le changement de température qui, depuis 8 jours s'était opéré, avait débarrassé nos rivières et nos campagnes des glaces et des neiges qui les couvraient, lorsque , samedi la nuit, le vent passant brusquement au nord nous a ramené un froid excessif. Dimanche soir, vers 10 heures, le thermomètre marquait 10 degrés au-dessous de glace, à minuit 6º. ; 7 environ à huit heures du matin lundi, depuis hier soir il a varié de 5 à 11°. Heureusement pour la conservation des semences et des colzas, la terre est couverte de quelques pouces de neiges qui les préserveront. L'Orne est prise en partie, et va geler en totalité, pour peu que le froid continue.
Février 1830 - Cidre et Colère. - Roulier à Langrune, Jacques Lequesne, et Jacques Haupoix, garde champêtre à Bernières, se trouvèrent un soir au même cabaret dans cette dernière commune. Le cidre les avait mal disposés l'un contre l'autre, et ils s'étaient dit des choses peu flatteuses, mais devant la bouteille deux buveurs sont égaux, et un garde champêtre même n'est plus qu'un simple particulier au cabaret, aussi dans le cabaret tout se passa, abstraction faite de la qualité de fonctionnaire, mais sorti de la Lequesne se porta à de nouvelles injures et même à des voies de fait envers le sieur Haupoix, qui de ces outrages rédigea procès-verbal. Les faits demeures constants, le tribunal n'a condamné le prévenu qu'en 8 jours d'emprisonnement, la scène qui s'était passée dans le cabaret, le soir même où le garde a été outragé, ayant paru une circonstance atténuante. Tant il est vrai que si l'on veut se voir respecté il faut savoir se rendre respectable. (Le Pilote du Calvados)
Février 1830 - Le froid continu. - Depuis 30 ans notre pays n'avait pas éprouvé un froid aussi intense que celui qui s'est fait sentir dans la nuit de mardi à mercredi, le thermomètre, au milieu de la ville, dans un courant d'air ordinaire, est descendu à 15° au-dessous de zéro, exposé a un air libre, il a baissé jusqu'au-dessous de 17° et à 20° dans la campagne. Aussi tout est gelé, même dans les appartements où le feu est entretenu pendant toute la journée. - Aujourd'hui le thermomètre était descendu à 5 heures du matin à 15º 5/10 en plein air. (Le Pilote du Calvados)
Juillet 1830 - Les orages menacent les récoltes de colza. - La semaine dernière, beaucoup moins pluvieuse que les précédentes, a permis de travailler à la récolte des gros foins et des colzas. L'activité qu'y ont apportée les cultivateurs, dans la crainte qu'un changement de temps ne compromît cette partie importante de leur revenu, en a beaucoup avancé les travaux. Encore deux ou trois jours de beau temps et les derniers colzas seront à l'abri. Toutefois, les orages qui ont régné pendant quelques jours, et tandis que la plante était arrachée et étendue sur le sol, ont occasionné la perte d'une assez grande quantité de graine, les cosses venant à s'ouvrir par la transition brusque d'une pluie abondante à un soleil ardent. Ces
circonstances ont fait monter le prix de cette graine jusqu'à 14 fr. et
14 fr. 50 cent. La barattée.
(Le Pilote du Calvados)
Juin
1831 -
Appel à la vigilance des maires.
- M.
le préfet du Calvados vient d'adresser à MM. les maires du
département une circulaire pour inviter ces fonctionnaires à prendre
de suite toutes les mesures nécessaires pour empêcher la divagation
des chiens.
donc dans l'intérêt de la sûreté publique, que les règlements sur cette matière soient exécutés avec sévérité, afin de prévenir les accidents qui résulteraient d'un défaut de précaution et de surveillance. (Le Pilote du Calvados)
L'une
part de Caen à 7 heures du matin, et fait son retour le soir, l'autre
à 5 heures du soir, et revient lendemain matin, à 7 heures, à Caen. Le
prix des places est de 75 centimes pour la Délivrande ; Langrune et
Courseulles, 1 fr. Un
Service pour Luc part tous les matins à 7 heures ; le prix est de 1 fr. Les
guides ne sont pas fixés, ils sont à la disposition des voyageurs. Baptiste Louard, conducteur de ces voitures, fait son possible pour mériter la confiance du public. (Le Pilote du Calvados)
Septembre 1831 - Pénurie de cidre. - La boisson la plus habituelle, pour ne pas dire la seule boisson du pays, le cidre, manquera généralement cette année, aussi depuis quelques mois il a sensiblement augmenté de valeur. On pense cependant que le prix ne peut que fléchir maintenant, attendu que dans un assez grand nombre de localités, où l'on croyait la récolte des pommes devoir être tout à fait nulle, il se trouvera de ce fruit beaucoup plus qu'on ne l'espérait. L'état des pommiers donne d'ailleurs toute raison d'espérer une brillante récolte l'été prochain, la chenille et les vents n'ont fait cette année aucun mal aux arbres, qui partout ont une belle végétation que l'on considère comme une demi certitude d'une riche floraison au printemps. (Le Pilote du Calvados)
Novembre 1831 - On lit dans l' Écho de la Seine-Inférieure. - Un négociant de Dieppe, membre de la commission sanitaire, nous écrit ce qui suit : Au moment où la salubrité publique excite avec tant de raison la sollicitude générale pour nous défendre contre l'invasion du choléra asiatique qui nous menace de toutes parts, nous croyons devoir signaler à la France entière un fait patent dont la gravité peut amener les conséquences les plus désastreuses. Suivant leur habitude de tous les ans, les bateaux pêcheurs du quartier de Caen arment ouvertement dans notre port, et avec une scandaleuse audace, pour aller acheter du hareng au Helder, au Texel, et sur les rivages de la Hollande, quoique ce pays soit placé par nos lois sanitaires sous le régime de la patente suspecte.
Leur retour devant s'effectuer à Luc, Langrune et autres criques du Calvados, où de tout temps leur commerce frauduleux et immoral a été toléré, ils espèrent échapper cette année comme par le passé, à la surveillance de l'administration des douanes de leur pays, qu'a tort ou à raison l'opinion publique accuse depuis longtemps, sinon de connivence, au moins d'une incurie ou d'une complaisance aussi répréhensibles jusqu'à présent qu'elles peuvent devenir coupables dans les circonstances actuelles. Dans
une pareille occurrence, que va faire l'administration du département
du Calvados pour dissiper la crainte que nous éprouvons tous de voir
s'introduire par cette voie le funeste fléau, contre lequel tant de
prescriptions sont si rigoureusement recommandées, nous l'ignorons.
Nous savons cependant que la commission sanitaire de Dieppe a informé
le ministre du commerce et des travaux publics de la tentative insensée
que la cupidité de ces pêcheurs leur a suggérée, et nous en
attendons des mesures préventives. (Le Pilote du Calvados)
Novembre 1831 - Mise en place d'un cordon sanitaire. - D'après la décision de la commission sanitaire qui s'est réunie il y a deux jours pour prendre les mesures nécessaires contre l'invasion du choléra, il a été arrêté qu'un cordon sanitaire va être établi sur les côtes du Calvados depuis la rive gauche de la Seine jusqu'à la rive droite de la Vire. Ce cordon sera formé de détachements du 50e de ligne dont un bataillon est en garnison à Caen, il se composera en outre des proposés des douanes, de la gendarmerie, des gardes champêtres et de tous les agents de la force publique. Tout individu qui chercherait à franchir ce cordon on qui, l'ayant franchi, ne s'arrêterait pas à la première injonction, s'exposerait à être victime de son imprudence, les troupes ayant ordre de faire feu sur les personnes qui fuiraient ou forceraient la consigne. Les précautions nécessitées par l'approche de la maladie ont motivé en outre de la part de la commission, ou intendance sanitaire, les résolutions suivantes : « Tous les navires provenant des états où le choléra s'est manifesté seront soumis, avant d'être admis à la libre pratique, à une quarantaine que le défaut de lazaret ou de lieux d'isolement sur notre côte les forcera de subir à l'île Tatihou ou à la pointe du Hoc. Les bateaux pécheurs qui s'absenteront de la côte pendant plus de 24 heures pour se livrer à leur industrie, ou qui auront communiqué en mer avec d'autres navires, ne seront point admis à la libre pratique, seront seuls exceptés de cette mesure les bateaux pêcheurs qui, sans avoir communiqué, auraient été forcés de tenir la mer pendant plus de 24 heures, par suite de mauvais temps, ou qui auront relâché dans un port français, mais dans ce dernier cas ils devront en justifier par un certificat de l'agent sanitaire du lieu. Mais c'est surtout contre les débarquements clandestins et l'introduction de marchandises frauduleuses que le cordon sanitaire est formé, attendu que c'est presque toujours par cette voie que les maladies pestilentielles sont importées. L'arrêté de l'intendance va être affiché dans tout le département, afin de prévenir les citoyens sur les graves dangers auxquels ils s'exposeraient en introduisant ou en recevant chez eux des marchandises provenant de lieux infectés.
Décembre
1831 -
On nous adresse du littoral la note suivante.
- Nous
respectons trop la sagesse des mesures adoptées par l'intendance
sanitaire, dans l'intérêt du pays entier, pour ne pas nous être
assurés avant de publier cette réclamation qu'elle est de nature a
être prise en considération, sans porter atteinte aux précautions
qu'exige la salubrité publique. Nous la soumettons aux méditations de
MM. les membres de l'intendance, convaincus qu'il feront tout ce qui
dépendra d'eux pour concilier les intérêts de notre population
maritime avec les mesures que le pays a le droit d'attendre contre
l'invasion du choléra. Quelque soit d'ailleurs la décision qui sera
prise, par l'intendance, comment les pétitions qui doivent lui être
adressées dans le même sens que la note ci-après, nous inviterons
ceux même dont les intérêts pourraient se trouver momentanément
compromis à s'y soumettre, l'intérêt général devant dominer les
intérêts particuliers et en commander même quelquefois le sacrifice. -
La commission sanitaire de Caen a arrêté, le 14 de ce mois, que
tout bateau pêcheur qui resterait à la mer plus de 24 heures, ne
serait plus admis à la libre pratique, Cette décision, quoique très
sage pour prévenir l'introduction du choléra, peut être modifiée
sans qu'il en résulte aucune absence de sécurité pour le pays. Vingt-deux
bateaux de Luc et de Langrune sont partis à la pêche du hareng, plus
de 500 hommes forment l'équipage de ces bateaux. La plus grande partie
de la population de ces deux communes, qui s'élève à 4 000 habitants,
subsiste de l'industrie de la pêche, il serait même facile d'établir
que cette branche précieuse du commerce se rattache à des intérêts
bien plus étendus que
ceux de la localité. En
maintenant les dispositions de cet arrêté, qui enjoignent aux bateaux
pêcheurs d'aller purger leur quarantaine à l'île Tatihou, c'est
occasionner le plus grand préjudice à toute la population qui vit de
la pêche et à tous ceux qui y sont intéressés. 1º.
Dans beaucoup de cas, le manque de sel, et le retard qui résultera de
la nécessité de poursuivre le voyage jusque sous la côte de la
Hougue, entraîneront la perte du poisson. 2º.
Le temps nécessaire pour se rendre au lieu de la quarantaine et les
délais du retour feront perdre aux pêcheurs des moments précieux,
puisqu'il faut qu'ils reviennent toujours à la côte de Caen pour
débarquer leur poisson, changer leurs filets et se ravitailler avant de
reprendre la mer. 3º.
Les réparations à faire aux bateaux pour les mettre en état de
continuer leur pèche. réparations qui ont lieu habituellement au
moment même de l'arrivée, ne pourront se faire qu'après qu'ils auront
purgé la quarantaine. On conçoit donc quel préjudice notable tous ces
retards et ces obstacles font naître au détriment du commerce, sans
utilité réelle pour les garanties de salubrité qui les occasionnent. Ces
faits posés, que peut-on faire pour rendre le sort des pêcheurs moins
fâcheux, sans rien enlever aux précautions sanitaires qu'il est
nécessaire de prendre ? Il n'y aurait aucun inconvénient à permettre
aux bateaux de la côte de faire leur quarantaine soit au mouillage de
l'île de la porte ( Kiho) qui est vis-à-vis Luc et Langrune, à
une demi lieue
Décembre
1831 -
Mesures de prévention et d'atténuation du choléra.
- Le
conseil de salubrité publique vient de rendre publics les moyens qui
lui paraissent les plus propres à se préserver des atteintes du
choléra, et a en atténuer les effets, si malgré toutes les
précautions et les moyens hygiéniques employés, il venait à se
manifester dans nos contrées. Nous croyons utile d'emprunter au Journal
du Havre la note suivante : 1°. La propreté est de la plus grande importance, soit dans les
vêtements, soit dans l'intérieur des maisons, il faut écarter des
habitations les ordures, les fumiers, enfin tout ce qui produit des
émanations fétides. Il est reconnu que ces exhalaisons ajoutent à la
gravité des maladies en général, et accroissent notamment
l'intensité du choléra. 2º. Étendre et faire sécher dans les appartements, des linges
imprégnés d'eau chlorurée, selon les proportions qui seront
indiquées. 3°. Dans un local vaste et élevé, les fumigations à la
Guyton-Morveau sont d'une application plus prompte et plus étendue.
Elle doivent donc être préférées dans ces cas, vu la modicité de
leur prix. 4º. Se laver souvent les mains dans une solution légère de
chlorure, y tremper même les mouchoirs que l'on porte avec soi. Il est
bon de mettre sous les lits une assiette remplie de quelques onces de
chlorure solide de chaux, avec suffisante quantité d'eau. En ajoutant
un peu de vinaigre, et en remuant ce mélange, on accélérera le
dégagement du gaze désinfectant. 5º. Avoir recours à des frictions sèches ou chaudes, à des
bains de vapeurs, à des bains chauds d'eau douce et de préférence
d'eau de mer. 6º. Porter sur la peau une large ceinture de flanelle, éviter le
refroidissement des pieds. 7º.
Éviter les réunions nombreuses, surtout dans un local resserré et
peut aéré. 8º. Ne faire aucun changement à un genre de vie sain et
régulier, continuer un exercice modéré. 9°. Autant que possible la nourriture doit être presque toute
animale, il faut user des légumes frais en petite quantité, éviter
les viandes fumées, les salaisons, la pâtisserie et les fruits mal
mûrs. L'abus
des liqueurs spiritueuses devient très préjudiciable dans les temps
d'épidémie, ainsi que les excès de tout genre. 10º. Enfin se mettre en garde contre ces spécifiques vantés par
quelques journaux,
ou colportés dans les campagnes. (Le Pilote du Calvados)
Janvier
1833 -
Observations
météorologiques pour 1832. - Voici
le relevé des observations météorologiques pour 1832. Plus grand
degré de chaleur le 13 août, 35 Le vent a soufflé du nord 59 fois, du nord-est 46, de l'est 28, du sud-est 22, du sud 66, du sud-ouest 54, de l'ouest 54, du nord-ouest 37. Eau de pluie tombée 525 hect. 58 cent. (Mémorial du Calvados)
Mai 1834 - La reconnaissance hydrographique. - Par une circulaire en date du neuf mai , M. le préfet du Calvados prévient les maires des communes littorales du département que les travaux relatifs à la reconnaissance hydrographique des côtes de France vont être repris, à la fin de ce mois, sous la direction de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef de la marine, et que ces travaux auront lieu cette année en partie sur le littoral du Calvados. M. le préfet recommande à MM. les maires de donner à M. Beautemps-Beauprè toutes les facilités qui dépendent d'eux pour le succès de la mission dont il est chargé. (Mémorial du Calvados)
Janvier 1835 - Le mauvais temps. - Hier la nuit, après plusieurs jours d'un temps doux et calme comme au mois d'avril, une violente tempête s'est fait sentir dans notre pays. Les vents n'ont pas cessé de souffler de la partie de l'ouest, sud-ouest, pendant toute la journée d'hier, et toujours avec une grande violence. Il est également tombé beaucoup de pluie. Heureusement notre côte n'avait pas à souffrir de cette tourmente qui soufflait de terre, mais il n'a pas dû en être de même sur la côte d'Angleterre, exposée à tout l'effort de la tempête. Jusqu'à présent nous n'avons eu connaissance d'aucun accident, et nous espérons que les pêcheurs de notre littoral qui se trouvaient à la mer pour la pèche du hareng auront pu atteindre les ports de la côte Est de la Manche, près desquels ils se trouvaient. Malgré
la sécheresse, qui donne aux racines des arbres plus de moyens de résistance,
nous ne doutons pas que beaucoup de pommiers n'aient été déracinés
dans nos campagnes. (Le Pilote du Calvados)
Janvier
1840 - Le temps qu'il fait. - La température douce et modérée qui
règne depuis l'entrée de l'hiver donne lieu, dans notre pays, à des
phénomènes de végétation On voit à Salies, dans le château qui domine la ville, un pommier en pleine floraison pour la troisième fois, durant le cours de l'année 1839. Ce pommier, de médiocre taille mais vigoureux, a donné abondamment du fruit des deux premières poussés, et, chose remarquable, les produits de cette double sève sont encore, en ce moment suspendus à l'arbre. Chacun peut voir et palper ces pommes, filles de la même année, quoique d'âges divers, belles, fraîches, appétissantes, couronnées de fleurs et de verdure, et contempler sur le même arbre, au plein cœur de l'hiver, comme sous les régions tropicales, la fleur, le bouton et le fruit. Dans le même local, un poirier voisin a donné, aussi en 1339, deux floraisons très abondantes. Les premières gelées de décembre ont seules empêché le fruit de nouer. En outre, le propriétaire peut offrir chaque jour des fraises en parfaite maturité, cueillies aux pieds de ces arbustes. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Avril
1840 - Nouvelle local. -
On
a remarqué que l'usage des moules à l'époque des grandes marées,
déterminait parfois tous les symptômes de l'empoisonnement. Les
toxicologistes ont supposé que les accidents auxquels ces bivalves
donnaient lieu, étaient dus à un état morbide de ce coquillage,
qui se manifesterait chez lui au moment de la reproduction qui a lieu
dans ce temps-ci. Les
habitants de nos côtes qui apportent à nos marchés, pendant le
carême , une si grande quantité de moules, ont la mauvaise habitude de
les conserver plusieurs jours chez eux, plongées dans de l'eau de mer,
placées dans de grandes bassines de cuivre. Ces vases, par l'action du
sel marin, ne tardent pas à se tapisser de vert de gris. Les moules
qu'on en retire après ce temps ne doivent certainement pas être sans
danger pour les personnes qui les mangent, si surtout elles sont cuites
dans une petite quantité d'eau, selon la très mauvaise habitude des
cuisinières du pays. Ce
coquillage pendant sa cuisson devrait toujours être entièrement
couvert de ce liquide, et l'écume albumineuse qui le surnage, rejetée
avec soin, comme contenant le principe C'est donc une économie très mal entendue, une vieille routine des cuisinières qui les portent à cuire pour ainsi dire à la vapeur ce coquillage, dans la crainte de le dessaler en employant une plus grande quantité d'eau. (Source : L'Indicateur de Bayeux)
Avril
1840 -
Agriculture. -
Malgré la grande sécheresse que nous éprouvons depuis deux
mois, les produits du sol, dans notre pays, ont la plus belle apparence.
Les premiers blés sont magnifiques, les derniers faits sont un peu
clairs, parce que l'hiver est venu trop tôt et s'est terminé trop tard
pour eux; mais comme ils se trouvent en général sur de fortes terres,
il y a tout lieu de penser qu'ils épaissiront en croissant. Les
craintes qu'avait fait concevoir l'action des gelées du mois de mars
sur les colzas ne se sont heureusement pas réalisées. Il est vrai
qu'en plaine quelques-uns ont beaucoup souffert, mais ceux
qui ont été transplantés et qui se trouvent abrités par des haies se
présentent sous un aspect tout à fait rassurant, ils sont en fleurs et
donnent les plus belles espérances. On
avait également eu des inquiétudes à l'égard des avoines d'hiver,
mais tout fait espérer que le mal n'est pas aussi grand qu'on l'avait
supposé. Si la récolte de ce grain n'est point des plus abondantes,
elle sera sans nul doute satisfaisante. Quant
aux pommiers, ils sont on ne peut plus beaux. Les bourgeons commencent
à se montrer, et, ce qui donne beaucoup de sécurité, les feuilles
précèdent les fleurs. Le cidre, quoique rare, a déjà éprouvé une
baisse notable. Tout fait donc augurer que la récolte prochaine nous
dédommagera de la stérilité des années dernières. En
somme, la campagne est aussi belle qu'elle puisse l'être après les
froids tardifs que nous venons d'éprouver. S'il continue à nous
arriver des blés des ports de la Baltique et autres lieux, il faut
espérer que le prix des céréales va éprouver un mouvement de baisse
sensible. Car il est à remarquer que le blé est plus cher dans le
Calvados que sur tous les autres points de la France. Dans l'est, il n'a pas sensiblement augmenté depuis le commencement de l'année, dans le département des Vosges, il ne vaut que 19 à 20 fr, l'hectolitre. Il est bien certain dès lors que quand même les céréales seraient rares chez nous, ce qui n'est heureusement pas à craindre, nos halles seront abondamment approvisionnées et que les prix continueront à fléchir. (Source : L'Indicateur de Bayeux)
Avril
1840 -
Nouvelle locale. -
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer, d'après les
renseignements qui nous arrivent de différents côtés, que chaque jour
vient ajouter aux espérances que l'état de nos campagnes permet de
recevoir depuis trois semaines. Les
blés sont magnifiques, la floraison des pommiers se fait favorablement.
Toutes les poires et les pommes précoces sont généralement assurées,
aussi la baisse dans le prix des blés et du cidre continue-t-elle en
s'affermissant. ( Source : Pilote du Calvados.)
Juillet
1840 -
Nouvelle locale. -
On commence à sentir dans quelques communes des environs
de Caen, toutes l'utilité de la sape pour couper les blés.
Déjà cet instrument si répandu dans la Flandre, est apprécié par
nos cultivateurs instruits. La
société d'agriculture de Caen, a promis encore cette année des
récompenses aux ouvriers qui remplaceront la faux par la sape dont tout
le monde reconnaîtra insensiblement la supériorité. On se rappelle
combien on a eu de peine à substituer la faux à la faucille. Il doit
en être de même de la sape. Ce n'est qu'avec de la persévérance qu'on triomphe des préjugés dans les campagnes comme dans les villes. On peut se procurer des sapes, chez M. Lair, secrétaire de la société d'agriculture. ( Source : L’Indicateur de Bayeux.)
Septembre
1840 -
Échenillage
et destruction des hannetons.
-
Le conseil d’arrondissement rappelle pour ce qui concerne
l'échenillage, les dispositions de la loi du 26 ventôse an IV ,
modifiée par l'article 471 du code pénal , et prie M. le préfet d'en
prescrire l'exécution dans toutes les communes de l'arrondissement. Quant
à la destruction des hannetons, le conseil pense qu'en attendant une
mesure législative toute spéciale, il faudrait que l'administration
invitât les maires des communes a requérir, vers l'époque où le
scarabée sort de terre, les vieillards et les enfants pour lui l'aire
la chasse, et qu'elle les autorisât à leur accorder une prime
proportionné e à la quantité détruite .
On ne peut dire que ce procédé fasse disparaître entièrement cet ennemi de nos champs, mais on peut au moins assurer qu'il arrêterait l'accroissement de sa reproduction. (Source : L’indicateur de Bayeux)
Mars
1841 -
Nouvelles locales. - On avait vu passer il y a plusieurs jours sur tout le
littoral, de nombreuses volées de gibier sauvage qui retournaient vers
les contrées septentrionales
qu'elles habitent, et d'où les froids rigoureux les éloignent tous les
ans : Il était facile d'augurer de ce fait que les mauvais jours de
l'hiver étaient passés. Aussi
depuis bientôt quinze jours le plus beau temps est-il venu nous
dédommager des rigueurs de la mauvaise saison que nous avons
traversée. L'aspect de la campagne a déjà complètement changé :
partout les blés s'annoncent bien et les pommiers sont chargés
d'autant de boutons que l'année dernière. Les herbages sont
magnifiques et les herbes vont bientôt venir en aide à la rareté des
fourrages secs. La plupart des colzas, grâce aux neiges qui les
couvraient, ont été garantis des derniers froids : partout la plante
présente une assez belle apparence. (Source : L’indicateur de Bayeux)
Novembre
1841 -
Nouvelles locales.
- On sait que
les pêcheurs des cotes de Normandie et de Bretagne prétendaient avoir
remarqué depuis la chute de l'empereur que le poisson se trouvait
en moins grande quantité dans les parages français. Les pêches
miraculeuses que l'on fait actuellement au Tréport et dans le voisinage
n'ont pas détruit cette idée superstitieuse, elles en ont amené un
autre, et aujourd'hui ces mêmes pêcheurs sont persuadés que le
poisson est revenu sur les cotes de France avec les restes mortels de
Napoléon. .
(Source : L’indicateur de Bayeux)
Octobre
1841 -
Nouvelle locale.
- Nos pêcheurs ont
déjà pris au-delà de quatre millions d'huîtres sur les bancs,
quoique la pêche n'ait pas été active, mais il paraît que les
Anglais n'ont pas renoncé à en avoir leur part, car dans la nuit du 13
au 14 courant, on a eu connaissance de bateaux anglais qui étaient
encore à y pécher. (Source : L’indicateur de Bayeux)
Juin 1842 - Nouvelles locales. - Par ordonnance royale, les jeunes soldats de la classe 1841, sont appelés à l'activité, le départ aura lieu le 15 juillet prochain pour le corps de l'armée de mer, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et des équipages militaires, pour les autres corps, le 16 du même mois. (Source : L’indicateur de Bayeux)
Juin 1842 - Nouvelles locales. - La cour de cassation vient de résoudre une question qui intéresse vivement les populations maritimes de notre pays. Elle
a décidé que l'arrêt du conseil du roi dit 24 mars 1787, qui défend,
sous des peines fort graves aux pêcheurs de la côte de Normandie
d'apporter dans nos ports des harengs pêchés par des navires
étrangers, était aboli et qu'il n'y avait lieu, dans l'état actuel de
la législation, de prononcer aucune peine pour contravention à cette
ancienne
Juillet 1842 - Nouvelles locales. - Il paraît que les abondantes pluies versées, depuis quelques jours, sur notre plaine, ont détruit en très grande partie, ces myriades de petites chenilles noires qui ravageaient tous les colzas et les menaçaient même, dans quelques contrées, d'une dévastation complète. Aussi nos cultivateurs qui, dans la crainte d'être obligés de semer une seconde fois, avaient fermé leurs magasins de graines au commerce, commencent-ils à les lui rouvrir. La
plus grande partie de cette plante précieuse est sauvée et presque
partout elle présente le plus magnifique développement. Il est assez
remarquable qu'aucune pièce de terre plantée en colza, quelque petite
qu'on la suppose, n'a été dévorée entièrement par les insectes dont
nous parlons, et qu'ils se sont contentés, au contraire, d'y marquer
leur funeste passage en les dépouillant partiellement, tantôt de deux
sillons en deux sillons, tantôt en losange, en écharpe, en zig-zag,
tantôt en y laissant juste au milieu, un grand vide quasi circulaire.
Tout le monde a pu vérifier ce fait, que nous avons nous-même été a
portée de constater, sur une vaste étendue de terrain. (source :
L’Indicateur de Bayeux)
Août 1842 - Varech et astéries considérés comme engrais. - Le varech est, comme chacun le sait, une plante aquatique qui croit sur les rochers, que la mer arrache en montant et jette sur ses bords. Les Bretons l'appellent gouësmon, les Normands varech, et, en Saintonge, on le nomme Sar. On emploie le varech comme engrais dans les terres du littoral. On le coupe sur les rochers dans le mois de mars ou de septembre, on le recueille au rivage où d'ordinaire, après une tempête, la mer l'apporte de loin. Le varech qu'on récolte sur le rocher est plus estimé, mais il n'est pas aussi abondant. J'ai remarqué que, depuis quelques années, ce ne sont pas les cultivateurs riverains des côtes maritimes qui font le plus fréquent emploi d'engrais marins. Le varech est porté à une demi-lieue et même jusqu'à quatre à cinq lieues de la mer. C'est à la nature du sol qu'il faut demander raison de ce lointain transport. Le varech est un engrais échauffant, mais il n'est pas nutritif, substantiel, si je puis ainsi dire, on l'emploie, quand on veut buter la végétation. C'est vraiment plaisir de voir accourir avec leurs charrettes, les cultivateurs des campagnes voisines des côtes, lorsqu'après quelque terrible tourmente, la mer a amoncelé le varech sur les grèves, c'est qu'alors il faut préparer les terres, il faut les alimenter, il faut les féconder, si l'on veut qu'elles produisent au centuple. Toutefois, nous devons le dire, le varech ne vaut pas le fumier, et ne peut pas le remplacer. Quand, l'année précédente, la terre a été bien fumée, on peut se contenter de l'engrais marin, mais employer deux années de suite le varech seul, ce serait vouloir appauvrir, stériliser le sol, car, nous le répétons, le varech accélère la végétation, mais ne fait pas fructifier. Le seigle, l'avoine, l'orge, le chanvre, le lin, le sarrasin, la cameline, l'ognon, aiment le varech, mais le blé ne le souffre pas. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Août
1842 - Nouvelles locales.
- Le
mot varech ou wrack, dans notre pays, ne désigne pas et n'a jamais
désigné une plante unique de la famille des algues : il signifie C'est à tort que M. Pilet a dit que le varech avait autre fois sa législation, mais que les lois qui régissent la matière sont tombées en désuétude. Trois ou quatre condamnations ont frappé, cette année même, en 1842, dans l'arrondissement de Caen, des individus qui y avaient contrevenu. Le droit de recueillir le varech appartient au premier occupant, le droit de récolter les algues qui croissent sur les roches et que sans doute, par analogie, on appelle aussi varech, appartient généralement aux communes sur le territoire desquelles il a poussé. Au moyen-âge il constituait un droit féodal. Nous voyons, en effet, par une charte du XIIe siècle, conservée aux archives de la préfecture du Calvados, que Richard-Cœur-de-Lion donne aux moines de St-Etienne de Caen le port de Dives, avec un chantier pour la construction des navires auquel il ajouta le droit de wrack. L'abbesse de Sainte-Trinité de Caen jouissait aussi de ce droit dans diverses paroisses du Cotentin, notamment dans celles de Saint-Vast, de Quettehou et de Morsalines. Beaucoup d'autres seigneurs possédaient de semblables privilèges, mais il est probable que les uns et les autres de ces privilèges étaient plus ou moins restreints et que les cultivateurs riverains en étaient quittes pour abandonner aux suzerains les épaves proprement dites. En tout cas, si ces dîmes existèrent jamais, on ne les payait plus, bien avant le XVIIe siècle, car la Coutume de Normandie n'appelle droit de varech que le droit de s'emparer des choses jetées par la mer à terre. L'ordonnance de la marine de 1681 organisa par son titre X du livre 4e, la coupe du varech dans les paroisses situées sur les côtes. Les habitants des paroisses devaient s'assembler le premier dimanche du mois de janvier de chaque année, pour régler les jours auxquels devait commencer et finir la coupe des herbes marines croissant en mer à l'endroit de leur territoire. Les habitants des communes d'Hermanville, Lion et ses hameaux, Luc, Langrune et ses hameaux, Bernières, Courseulles, Arromanches, Tracy, Manvieux , Fontenailles, Longues, Marigny, Commes et ses hameaux, Port-en-Bessin, Huppain, Villers, Ste-Honorine-des-Pertes, Colleville et St-Laurent, pourront faire ladite coupe pendant trente jours, qui seront choisis entre le troisième jour avant la pleine lune de mars, et le troisième jour après la pleine lune d'avril. Ceux des communes de Vierville, St-Pierre-du-Mont, Englesqueville et Grandcamp, pourront faire la coupe des dites herbes, pendant trente jours. à compter du 1er du 15 mars jusqu'au 15 avril suivant. - Les conseils municipaux desdites communes, s'assembleront le 11 ventose prochain, sur la convocation des maires, pour faire ledit choix, auquel il sera procédé les années suivantes, à la session fixée au i5 pluviôse par les lois du 28 pluviôse an VIII. - La coupe ou récolte desdites herbes sera faite à la main, avec un couteau ou faucille. Il est défendu de la faire d'une autre manière, et d'arracher lesdites herbes avec la main ou avec des râteaux et autres instruments qui puissent les déraciner, la peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de peine corporelle en cas de récidive. - Ceux qui ne seront point habitants des communes dénommées en l'art. II, ne pourront y faire la coupe desdites herbes de Mer, pour quelque cause et sous quELque prétexte que ce puisse être, à peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de peine corporelle en en cas de récidive. -
Il est également permis à toutes personnes de prendre
indifféremment, en tous temps et en tous lieux, lesdites herbes
détachées des rochers par l'agitation de la mer et jetées à la côte
par le flot, et de les transporter où bon leur semblera, soit pour
être employées à l'engrais des terres ou à faire de la soude. Il est
défendu de les y troubler ni inquiéter, quand bien même ceux qui
enlèveraient ces herbes les auraient prises sur d'autres territoires
que le leur, à peine contre les contrevenants , de cinquante livres
d'amende. (source : L’Indicateur
de Bayeux)
Août
1843 -
Nouvelles locales. -
On nous communique un remède aussi sûr que prompt contre la
brûlure. Nous croyons utile de le faire connaître à nos lecteurs. On
prend une pincée de pousses de jeunes buis que l'on pile avec trois
blancs de poireaux, et on y ajoute une cuillerée d'huile d'olive. On
renferme ensuite le tout dans un linge bien blanc et on l'applique sur
la partie brûlée. Plusieurs
personnes qui ont fait l'essai de ce remède, en ont obtenu les plus
prompts et les plus heureux résultats. (source : L’Indicateur
Septembre
1843 -
Nouvelles locales. -
Nous lisons dans le « Haro » les réflexions
suivantes sur un abus qui a lieu fréquemment sur notre littoral et
qu'il est bon de signaler : Pêche
de moules. - Depuis quelque temps , les habitants de la côte ne se
contentent pas des engrais tels que le varech et les ammonites (
fifottes, étoiles que la mer leur apporte,
ils pèchent les moules pour les porter clans la terre. Avons-nous
besoin de dire que la moule est la nourriture des pauvres, et que sur la
côte même un grand nombre de familles n'ont souvent pas d'autre mets ?
C'est-là
un fait reconnu ; il importe donc au dernier degré de protéger ce
coquillage contre une spéculation désastreuse. Le
gouvernement républicain avait senti cette nécessité ; aussi, dans
une instruction ministérielle de prairial an X, adressée aux syndics
de mer nous trouvons le passage suivant : « La pêche des moules doit
se faire avec un couteau de sept pouces sur les moulières qui
découvrent et sur celles qui ne découvrent pas, et avec un râteau
dont les dents sont de quinze lignes de distance les uns des autres ». Depuis
longtemps cette instruction est tombée en désuétude, et cela par
défaut de surveillance. Nous
devons toutefois faire une exception : Depuis quelque temps, M. Lepetit,
syndic à Ouistreham, s'est fortement opposé à l'enlèvement des
moules fait par un autre moyen que celui toléré par l’instruction de
prairial ; et hier encore, à Lion, il dressait procès-verbal contre un
pêcheur. Nous
croyons que l'instruction est inefficace et le sera jusqu'à ce qu'on
ait interdit formellement l'enlèvement des moules pour servir
d'engrais, et attaché une pénalité sévère à l'infraction de cette
interdiction. La
chambre s'occupe de chasse et de braconnage ; la chasse et le braconnage
ne font guère tort qu'aux grands possesseurs ; la pêche des moules
cause le plus grand préjudice aux populations misérables.
S'occupera-t-on de les protéger ! (source : L’Indicateur de
Bayeux)
Décembre 1843 - Nouvelles locales. - Nous avons eu plusieurs fois occasion de parler de la manière dont on fait la pêche sur nos côtes. Nous avons surtout réclamé contre celle des moules. Il en est une autre contre laquelle nous devons nous élever, celle du petit poisson : c'est vraiment une chose désastreuse que cette pêche, les marins de la côte du Calvados, notamment ceux de l'arrondissement de Caen, se servent de filets à mailles très serrées, et il n'est pas étonnant de voir à la Délivrande, par exemple, vendre le poisson par mesure. Ajoutons même que lorsque le poisson est trop petit pour être vendu, on le garde pour le donner aux volailles du pays. C'est
là un abus que nous signalons à MM. les syndics, et qu'il est temps de
voir disparaître. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Mars 1844 - Nouvelles locales. - Un vent de nord-est souffle en ce moment avec une grande violence, ce qui contrarie beaucoup la pèche sur notre côte. Des
marins nous affirment que depuis plus de 40 ans, la mer n'avait été
plus terrible que la nuit dernière. Nous sommes, quant à présent,
assez heureux pour n'avoir aucun
Mai
1844 -
Nouvelles maritimes. -
Voici, d'après
des renseignements authentiques, quelle est l'étendue des sinistres
maritimes arrivés sur notre littoral depuis le commencement
de la tempête de ces jours derniers : Le
brick la « Providence », capitaine Bouchon, venant de
Libourne, avec un chargement de vin et eau-de-vie, à destination du
Havre et de Caen, a été jeté à la côte, le 17, à neuf heures du
soir, à l'entrée de la rivière d'Orne. L'équipage a été sauvé. Le
houry la « Prudence », venant de Bordeaux, avec un
chargement de vin et d'eau-de-vie, à destination de Rouen, a été
également jeté à la côte près de Deauville. La
goélette norvégienne « Annette-Dorothée » , capitaine
Holer, venant de Mandal, chargée de bois, est aussi échouée sous
Cabourg, à peu de distance de la rivière de Trouville. On ignore si
les équipages de ces deux navires ont été sauvés. Le
sloop anglais « Actif », capitaine Morgon, venant de
Swansea, avec un chargement de cuivre, à destination de Rouen, a fait
côte à Saint-Aubin-de-Langrune. L'équipage a été sauvé, on
espère renflouer le navire après déchargement. Deux
houris, la « Victoire » et le « Jeune-Conquérant »,
ont été également jetés sur la côte près de Luc-sur-Mer. Le
navire la « Jeune-Adèle », capitaine Laborde, allant
d'Abbeville à bordeaux, sur lest, a relâché à Courseulles. Ce navire
a éprouvé quelques avaries. Le capitaine Laborde a rapporté
qu'il a trouvé en mer, entre deux eaux et toute désemparée, une
goélette norvégienne , la « Caroline-Mathilde », capitaine
Bioness, venant de Moss avec un chargement de planches à destination de
Caen, et à la consignation de Mme veuve Verel. Ce
navire est venu à la côte sous Asnelles, on a trouvé dans le roufle
un chat et un chien encore vivants, il y a malheureusement lieu de
penser que le capitaine qui a dû s'embarquer dans son canot avec son
équipage composé de 7 hommes, aura péri en même temps que lui en
voulant se rendre à terre. Ce
qui tendrait à accréditer cette opinion, c'est qu'on a retrouvé
depuis l'échouement du navire qui est totalement brisé, les débris
d'un canot épars sur la côte ainsi qu'une grande quantité de
planches. Depuis
ce sinistre, il est entré à Courseulles une autre goélette
norvégienne, à destination aussi du port de Moss, qui a touché en
entrant et qui a fait de graves avaries. Elle est battue à chaque
marée par la violence des lames qui viennent du large et qui déferlent
sur elle avec une grande impétuosité. Toute la côte, depuis Courseulles jusqu'à Lion-sur-Mer, est couverte de planches et de débris. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Mai 1844 - Police correctionnelle. - Audience du 21 mai. Jean-Baptiste Dubosq, journalier à Langrune, convaincu de larcin de la somme d'environ un franc au préjudice des sieurs Le Comte et Debaudre, a été condamné en 15 jours de prison. — Le sieur Souffland, propriétaire à Bayeux, avait confié à titre de dépôt, une roue de charrette au nommé Baptiste Marguerite, charron à Coulombières, celui-ci convaincu du détournement de cet objet, aura à subir 13 mois d'emprisonnement.
Mai 1845 - Nouvelles locales. - Lundi dernier, vers cinq heures du soir, le nommé Eugène Dibel, journalier, demeurant à Langrune, et qui avait été admis le matin même au nombre des ouvriers employés aux travaux du bassin de Caen, a été atteint et fortement pressé à l'estomac entre un wagon qu'il conduisait et dont il était occupait à ôter le crochet, et un convoi d'autres wagons qu'on venait de décharger, et qui remontaient au point de départ. Cet individu a été conduit à l'hôpital, où on lui a fait immédiatement des applications de sangsues et de cataplasmes qui l'ont beaucoup soulagé. Du reste, son état n'inspire aucune inquiétude, et tout porte à croire qu'il sera rendu sous peu de jours à son ouvrage, à sa femme et à ses trois enfants. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Juin 1846 - Pêche des Moules. - Une ordonnance du roi du 18 décembre 1723 a statué sur la pèche des moules. Malgré les dispositions qu'elle contient, il est souvent arrivé que les pécheurs y ont contrevenu. Plusieurs fois des condamnations ont été prononcées, et l'an dernier notamment, un délinquant a été condamné par le tribunal correctionnel de Pont-l'Évêque à 25 .fr. d'amende pour une contravention à cette ordonnance ( V. notre n° du 14 septembre 1845) Cependant les contraventions se renouvellent et récemment encre, on en a pu reconnaître à Saint-Sauveur. Les
pécheurs devraient pourtant savoir plus que personne combien il est
préjudiciable à l'intérêt commun et à leurs intérêts particuliers
de dévaster ainsi les moulières. C'est, sans servir aucunement les
intérêts du moment, se priver, pour l'avenir, d'une ressource
précieuse, tant pour la nourriture des populations riveraines que pour
les bénéfices qu'en tirent les mareyeurs qui en portent dans
l'intérieur. (source
Journal de Honfleur)
Janvier
1847 -
Nouvelles locales. -
Un crime d'un cynisme dégoûtant a été commis le 24 décembre
dans la commune de Langrune. La fille Petremaine (Mélanie), âgée de
20 ans, a été trouvée ayant les bras attachés derrière le dos, les
pieds liés à deux piquets fixés en terre, un mouchoir en forme de
tampon dans la bouche, un autre fortement attaché lui couvrait les yeux
et le nez, ses cheveux étaient coupés ras de la tête, et le désordre
de ses vêtements accusait un viol. Cette
malheureuse fille a été l'objet des plus grands soins de la part de
l'autorité locale, mais elle est dans un état qui fait craindre pour
ses jours. Le lendemain elle n'avait pas encore repris connaissance,
depuis, elle est dans un état d'exaspération effrayant. La gendarmerie s'est aussitôt mise à la recherche des auteurs de cet horrible crime. Elle est parvenue à découvrir que les frères Huet dit La Cavée, de la commune de Luc, pourraient être soupçonnés de s'en être rendus coupables. La justice informe activement. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Mars
1848 -
Ordre Judiciaire. -
D'après un arrêté du Gouvernement provisoire, les arrêts
des cours et les jugements des tribunaux seront désormais rendus : AU
NOM DU
Mars 1848 - Le drapeau. - ( 6 mars ) Considérant que le drapeau de la France est le signe visible de l'unité nationale. Considérant dès lors que la forme du drapeau national doit être fixée d'une manière invariable. Arrête : Art. 1er . — Le pavillon, ainsi que le drapeau national, sont rétablis tels qu'ils ont été fixés par le décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II, sur les dessins du peintre David. Art. 2. — En conséquence, les trois couleurs nationales, disposées en trois bandes égales, seront à l'avenir rangées dans l'ordre suivant : le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu, le rouge flottant à l'extrémité. (source : Journal de Honfleur)
Septembre 1848 - Nouvelles de France. - Nous n'avons eu le temps dans notre dernier numéro que d'annoncer très-succinctement le départ de Paris dans la nuit du 29 au 30 août d'un convoi de 111 insurgés qui, à leur arrivée au Havre, ont été embarqués sur la frégate à vapeur le « Darrien » qui les attendait et est partie aussitôt pour Brest, emportant aussi le convoi précédemment arrivé. Elle est arrivée à sa destination. 400 de ses passagers ont été mis à bord de la « Didon » et 120 à bord de la « Guerrière ». Dans les 111 individus du dernier convoi, il n'y en a que deux du Calvados : Lucien Guérin, 22 ans, tailleur, né à Clécy ; Auguste Épreron, 30 ans, forgeron, né à Langrune. Le 3 septembre un nouveau convoi, composé de 484 hommes parti de Paris dans la nuit précédente, est arrivé au Havre ; ils ont été provisoirement mis à bord de l' « Andelle », amarré dans le bassin Vauban et qui à passé dans celui de la Floride. La frégate à vapeur l’ « Ulloa » est arrivée dans la matinée, mais la mer n'apportait pas assez d'eau pour que ce bâtiment pût entrer dans le port. On a pris alors le parti de faire sortir l’ « Andelle », remorqué par le steamer l’ « Alcide ». Le transbordement a été opéré en rade et a duré une heure et demie. L’ « Ulloa » est ensuite partie pour sa destination. L' « Andelle » n'a pu rentrer qu'a là marée suivante. (source Journal de Honfleur)
Août 1851 - M . le préfet du Calvados vient de publier la circulaire et l'arrêté suivants, relatifs à la conservation des côtes et rivages de la mer : Messieurs, les propriétaires de terrains, menacés d'envahissement par la mer, se plaignent sans cesse de l'enlèvement de matériaux sur le rivage. De leur côté, Ies administrations municipales qui ont besoin de pierres et de graviers pour la confection et l'entretien des voies publiques, et les particuliers habitués à trouver sur le rivage les matériaux nécessaires à la confection, prétendent que l'enlèvement des pierres et galet n'a rien de nuisible, et que l'interdiction presque absolue, qui résulterait de l'application rigoureuse de l'arrêté du 16 août 1847, apporte une gêne inutile à l'exécution des travaux publics. Cette controverse démontre au moins que l'on ne peut permettre l'extraction des matériaux sur tous les points du rivage, sans dommage pour les propriétés limitrophes, et qu'il est indispensable d'examiner de plus près la question, afin de bien déterminer les lieux où l'on ne peut tolérer l'enlèvement de cette défense naturelle, et ceux qui, par leur disposition, n'ont pas besoin de cette protection. J'ai
l'honneur de vous adresser un arrêté qui organise des commissions
chargées de visiter toutes nos côtes, et de donner son avis sur les
mesures à prendre pour la conservation du rivage, en conciliant le
mieux possible l'intérêt des propriétés riveraines avec les besoins
des travaux publics et particuliers.
Juillet
1852 - Nouvelles divers.
- Le tribunal
correctionnel, dans son audience du 26 juin, a condamné à 100 fr.
d'amende un habitant de Langrune convaincu d'avoir, le 3 mai dernier,
enlevé, avec des pelles et à l'aide d'une voiture, du frai de moules
sur un rocher nommé les Ecores-de-Baz, à Langrune. (Source :
Le Journal de Honfleur)
Septembre 1852 - Les grandes marées. - La marée du 15 septembre, une des plus hautes de l'année, et dont, comme on sait, l'effet s'est fait sentir le 17, favorisée par des vents de S. 0., s'est élevée plus que ne l'indiquaient les tables. Nous avions omis de la signaler. Celle du 13 octobre doit, d'après les calculs astronomiques, être plus haute encore. Si Ies vents soufflaient de la même partie, elle pourrait occasionner des dégâts sur plusieurs points du littoral. Le 17 septembre l'eau avait effleuré les portes de nos bassins. (Source : Le Journal de Honfleur)
Mai 1852 - Les moules. - A partir du 1er mai, la cueillette des moules est ouverte sur les diverses moulières du Calvados, et, depuis le commencement du mois, ce mollusque est mis en vente à la poissonnerie et dans nos rues. Apparemment il laisse encore beaucoup à désirer sous le rapport important de la salubrité, car nous apprenons, de source certaine, que plusieurs personnes qui on ont mangé, ont été indisposées assez sérieusement pour avoir recours aux médecins. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Juillet 1852 - Incendie. - Un incendie, qu'on attribue à la malveillance, a éclaté, vendredi dernier, à Langrune, sous un hangar rempli de chaume, de colza, et s'est communiqué, en un clin d’œil, à une grange adjacente et à deux corps de bâtiments voisins, qui sont devenus la proie des flammes. Une maison, couverte en tuiles, a été préservée des atteintes du feu, auquel elle a opposé une barrière infranchissable. Le mobilier qui garnissait les constructions incendiées a été en partie sauvé. Parmi les personnes auxquelles ce sinistre cause le préjudice le plus grave, on cite un pauvre pêcheur, père de cinq enfants, et dont la femme est grabataire et une malheureuse fille, qui est presque constamment malade. Ce cruel événement leur a enlevé leurs dernières ressources. Des misérables, dont nous regrettons vivement de ne pas pouvoir clouer les noms au pilori, ont profilé lâchement de l'incendie, pour commettre un vol d'argent et de linge au préjudice de la famille du pécheur ! L'administration
préfectorale et les habitants de Langrune viendront en aide aux
incendiés, nous en avons la certitude : Ce sera, de leur part, un
véritable bienfait ! (source : L’Indicateur de Bayeux)
Janvier
1853 - Nouvelles Locales.
Les journaux de Caen, en rendant compte
d'incendies qui ont eu lieu dans cette ville et à Langrune, expriment
le regret que les compagnies de pompiers ne soient pas encore
reconstituées. Nous n'avons pas heureusement le même motif, mais nous
pouvons exprimer le même regret. Sans doute si nous éprouvions quelque
incendie, le zèle et l'empressement des anciens membres de la compagnie
les feraient encore distinguer, comme toujours, mais les secours n'ont
pas
Avril
1853 -
Nouvelles divers. - Le
détail le plus intéressant qui ressort des tableaux de recrutement est
relatif au degré d'instruction de jeunes gens appelés sous les
drapeaux, Les statistiques militaires accusent un progrès lent, mais
constant, dans la situation intellectuelle des populations. Ainsi,
des jeunes gens appelés de 1831 à 1835, près de la moitié (480 sur 1
000 ) ne savaient ni lire ni écrire. Cette proportion est descendue à
437 sur 1 000 pour les jeunes gens appelés de 1836 à 1840 ; à 400 sur
1 000 pour ceux de 1841 à 1845. Pour
la classe de 1848, sur 304 023 appelés, 175 416 savaient lire et
écrire ; 13 092 ne savaient que lire ; 106 279 ne savaient ni lire ni
écrire ; enfin il en est 9 236 dont le degré d'instruction n'a pu
être vérifié.
Ces chiffres font ressortir le nombre des illettrés dans une proportion de 349 sur 1 000. Le progrès est sensible. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Juillet
1853 -
Nouvelles des campagnes.
- Depuis
quatre jours, le temps s'est considérablement amélioré, et la saison
d'été se fait enfin sentir. La plus grande activité règne dans nos
campagnes environnantes, et la récolte des foins se fait partout dans
de meilleures conditions qu'on n'eût pu l'espérer la semaine
dernière. Sous l'action d'une température plus favorable, les blés versés se relèvent, et présentent un aspect plus consolant. Il faut espérer que, si ce beau temps continue, on n'aura plus de crainte sérieuse à concevoir sur les résultats de la prochaine récolte. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Juillet
1853 -
Nouvelles du temps. -
Le printemps
a fini et la saison d'été a commencé le 21 juin, à 1 heure 33
minutes du soir. Le soleil, à la même heure, a quitté les Gémeaux
pour entrer dans le signe du Cancer. Pendant le printemps qui vient de finir, les vents d'ouest ont dominé, ils ont régné 77 jours sur 90. C'est à leur persistance qu'il faut attribuer les pluies continuelles que nous avons eues. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Juillet 1853 - Vacances scolaires. - Par décision de M. le ministre de l'instruction publique, les vacances commenceront dans les collèges et institutions à partir du 10 août prochain. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Septembre 1853 - Nouvelles locales. - Dimanche dernier, Mgr Blanquart de Bailleul, archevêque de Rouen, assistait à la grand'messe de Langrune. Il a officié, le soir, aux vêpres, dans la chapelle de Notre-Dame de la Délivrande. M. l'abbé Vauquelin, missionnaire, a prononcé, entre vêpres et compiles, un sermon sur la confiance envers la très Sainte Vierge, sermon nourri d'instruction et de piété, plein d'idées ingénieuses et touchantes, d'images bien choisies, animé surtout par le sentiment intime du sujet. Le
jeune prédicateur remplissait de sa voix pénétrante et harmonieuse le
sanctuaire trop étroit pour la foule des fidèles. Parmi eux, se
trouvait l'auteur des Études ous sommes heureux de savoir et de dire que l'éminent écrivain, dont la renommée grandit chaque jour avec le bien immense qu'il accomplit par ses ouvrages, a trouvé, dans notre pays, un accueil tout à fait sympathique, digne de son caractère, du charme de sa personne, et de l'aimable et sincère modestie qui relève ses hautes qualités. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
On le retira presque immédiatement, mais malgré les soins qui lui furent prodigués, il ne put être rappelé à la vie. Le corps a été reporté à Flers. -
Le même jour, à Lion-sur-Mer, un autre malheur du même genre,
a failli arriver. Une dame qui était allée, seule, prendre un bain à
la mer, a été renversée par une vague et elle se serait noyée sans
les prompts secours qui lui furent portés par M. le marquis de
Folleville. (Source : Le Journal de Honfleur)
Mars
1855 -
Les grandes marées. - Les
18, 19 et 20 mars courant, aura lieu une des plus grandes marées de
1855. Elle atteindra en hauteur 1m 11, et pourra causer quelques
désastres sur nos côtes, si elle est favorisée par les vents.
(Source : L’Indicateur de Bayeux)
Mars 1856 - Cour d’Assises du Calvados. - présidence de Monsieur le conseiller d’Angerville. Audience du 20. —
Lemarinier, armateur à Langrune, accusé de faux en écriture de
commerce, est acquitté. . (Source :
Le journal de Honfleur)
Mars 1856 - Marées de 1856. - L’armée 1856 est remarquable par le nombre de marées que le calcul y indique comme devant être fortes. Trois sont cotées 1,14 et une 1,15. Les marées de ces numéros ne sont pas très rares, il est vrai, et ne sont pas toujours désastreuses. Nous en avons eu récemment de 1,15 en 1852, ..34, et ..48 ; de 1,16 en 1852, ..47 et ..45, et même une de 1,17 en 1847, sans qu’elles aient causé de malheurs dans notre voisinage, le vent ne les ayant point poussées sur nous. Cependant chacune des principales marées de cette année pourrait être fort dangereuse dans nos ports et sur nos côtes, si la force et la direction du vent venaient à les favoriser. On ne peut donc trop recommander de précautions à nos riverains, surtout pour la prochaine marée, de 1,15, dont le plein doit avoir lieu le 7 ou le 8 mars, à une époque de l’année que signalent presque toujours des vents assez violents, et même des tempêtes. (Source : Le journal de Honfleur)
Juin 1856 - Port de Courseulles. - 70 navires sont entrés dans le port de Courseulles pendant le mois qui vient de s'écouler, les uns chargés de diverses marchandises, les autres venant de la pêche.
Un sloop anglais, qui avait fait côte entre Langrune et Saint-Aubin, est venu se faire réparer et reprendre sa cargaison qui était en pierre de granit, qu'il avait fait apporter par terre. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Janvier 1858 - Le Jour de l’an. - Une belle gelée, adoucie par un soleil resplendissant, a favorisé, pendant la journée d'hier, les visites du jour de l'An. En dehors des visites hiérarchiques, on a généralement constaté que le nombre des cartes va diminuant chaque année. Il ne parait pas qu'il en ait été de même des Étrennes. Cet usage si cher aux enfants a donné lieu à des ventes assez avantageuses pour les divers magasins de cette spécialité. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Janvier 1858 - Le froid. - Pour s'être montré tardif, dans notre contrée, l'hiver s'est fait sentir depuis huit jours d'une manière assez vive. La température s'est considérablement abaissée, et le froid sévit avec une certaine intensité. Dans la nuit de lundi à mardi, le thermomètre est descendu à 11 degrés au-dessous de zéro. La gelée est arrivée brusquement sans que des pluies soient venues accroître préalablement la hauteur de nos cours d'eau qui, sur plusieurs points, sont insuffisants pour faire marcher les moulins. Il en résulte que la fabrication de la farine va devenir plus difficile, au reste, et par une heureuse compensation, les récoltes en terre ne peuvent que gagner à cette température plus rigoureuse. Elle est venue à propos pour arrêter la végétation trop précoce des blés et des plantes oléagineuses, qui d'ailleurs, offrent, dans notre contrée, le plus riche aspect. Il faut donc accepter comme un bienfait providentiel cette saison, rigoureuse mais nécessaire, et ne pas oublier surtout qu'à la Charité incombe le devoir d'en soulager les souffrances et d'en atténuer les rigueurs ! (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Janvier
1858 - Des récompenses.
-
L'amiral ministre secrétaire d'État au département de la
marine et des colonies a décerné, par une décision du 22 du mois
dernier, des récompenses pour faits de sauvetage aux personnes,
ci-après, dénommées, savoir : Un
témoignage officiel de satisfaction au sieur Croix (Pierre-Léopold),
mousse à Honfleur, pour avoir, à Trouville, le 4 juillet 1857, sauvé
un enfant qui venait d'être entraîné par le courant. Un
témoignage officiel de satisfaction au sieur Colleville (Constant),
matelot inscrit à Caen, patron de bateau, pour s'être jeté à l'eau
tout habillé afin d'en retirer un enfant qui venait d’y tomber, à
Port-en-Bessin, le 1er octobre 1857. Une
médaille d'honneur en argent de 2e classe au sieur Blasne (Jacques-Henri-Théophile),
pour avoir, à Langrune, le 6 septembre 1857, sauvé deux
personnes en danger, de se noyer dans la mer. (Source : L’Indicateur
de Bayeux)
Avril
1858 -
La grande marée d’équinoxe.
- La
marée extraordinaire d'équinoxe aura lieu le 14 de ce mois, sur les
côtes de la Manche, de l'Océan et de la mer du Nord,
Août
1858 - Fête religieuse
à Langrune. -
Demain mercredi, 18 août, à neuf heures et demie du matin, aura
lieu l'inauguration du nouvel autel de l'église de Langrune, dont les
premiers fonds ont été fournis par les habitants de cette commune et
la colonie de ses baigneurs, l'une des plus nombreuses et des plus
distinguées de nos côtes. Cet autel, dans le style de l'église, est
un chef-d'œuvre digne de ce beau monument, l'un des plus remarquables
de notre littoral. Une messe en musique sera chantée par la société chorale des Vénitiens de Bayeux. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Août
1858 - Le règlement.
-
Il arrive quelquefois que des fonctionnaires municipaux croient
pouvoir, nonobstant les termes des règlements sur la fermeture des
débits de boissons, autoriser certains habitants à laisser ouverts
leurs établissements après l'heure de fermeture fixée par ces
règlements. Il parait utile, dès lors, de porter à la connaissance de MM. les maires que la Cour de cassation vient de décider qu'un maire n'a pas le droit, lorsqu'il existe un arrêté qui ordonne la fermeture des établissements publics à une heure déterminée, de donner la permission de dépasser cette heure, pour quelque cause que ce soit. Il ne peut, en effet, appartenir à l'autorité municipale de modifier un arrêté régulièrement pris. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Octobre
1858 - Le temps qu’il fait.
- Les
astronomes ont compulsé toutes les tables météorologiques
quotidiennes depuis deux siècles, et ils n'ont pas trouvé un seul 16,
ni 17, ni 18 octobre ni aucun jour voisin dans le calendrier où l'on
ait joui, d'une température de vingt-cinq degrés centigrades au-dessus
de zéro. L'année
1858 est l'une des années les plus extraordinaires de ce siècle pour
la beauté de la température. Malheureusement
beaucoup, d'industries ont à souffrir de la sécheresse extraordinaire
aussi, cette année. Quinze jours de pluies seraient un véritable
bienfait pour elles. (source : L’Indicateur de Bayeux) Octobre
1858 - La grande marée et la basse mer d'octobre sur les
côtes du Calvados. -
Les spectacles
grandioses que présente la mer commencent à éveiller la curiosité. Parmi
les phénomènes maritimes susceptibles d'être prévus, il n'en est pas
de plus remarquable que celui des grandes marées et des basses mers qui
leur succèdent toujours. Nous
arrivons à la pleine lune d'octobre, qui aura lieu le 22 : le soleil ne
sera encore éloigné que d'environ 11 degrés au sud de l'équateur ;
la lune, qui aura franchi cette ligne le 19, approchera de son périgée
(sa plus courte distance à la terre), qu'elle atteindra le 25. L'action
combinée du soleil et de la lune sur la mer sera insuffisante encore
pour la faire battre à pleins rivages et donner le spectacle de la
cinquième et dernière grande marée de 1858 : Les grandes marées
précédentes ont eu lieu Ie 17 mars, le 15 avril, le 10 août et le 9
septembre. On
sait que les plus grandes marées arrivent toujours aux nouvelles et aux
pleines lunes, à l'époque des équinoxes, et elles sont d'autant plus
considérables que la lune et le Au
Havre, par exemple, l'unité de hauteur du port est de 5 mètres 67 ; ce
nombre a été obtenu en prenant la moitié de 7 mètres 14, qui est la
différence observée, dans ce port, entre les plus hautes et les plus
basses mers ; à l'embouchure de l'Orne, l'unité est de 5 mètres 65 ;
à Port-en-Bessin, de 3 mètres 20. Nous devons citer ici un fait
important que l'observation nous révèle, c'est que, dans nos ports les
plus grandes marées suivent toujours d'un jour et demi l'instant de la
nouvelle et de la pleine lune . En conséquence, la pleine lune
d'octobre ayant lieu le 22, à trois heures vingt-sept minutes du soir,
la plus haute marée ne se produira que le 24 octobre au matin Les
marées peuvent dépasser les hauteurs que nous venons d'indiquer mais
la cause n'en doit pas être, attribuée à l'influence combinée du
soleil et de la lune ; cela ne peut avoir lieu que si les vents viennent
à souffler du large et à pousser impétueusement la masse des eaux
contre leurs rivages. Voir
la mer agitée bouillonner avec des flocons d'écume garnissant la
crête de chaque vague, n'est que la moitié du curieux spectacle qui
attend les touristes aux bords de la Manche. Une
très basse mer succède toujours à une très haute marée ; les eaux
se retirent d'autant plus au large qu'elles se sont plus avancées vers
le rivage. Ce fait n'a rien qui doive surprendre ; l'explication
scientifique en est toute simple : comme c'est la lune qui, par son
passage au méridien du lieu, détermine l'heure de la marée,
lorsqu'elle passe au méridien d'un autre point du rivage, elle n'y
produit la haute mer qu'en retirant, pou r ainsi dire, les eaux du lieu
qu'elle vient de quitter pour les accumuler sur le nouveau rivage auquel
elle va donner une grande marée. De
ce retrait des eaux après une forte marée, il résulte que les plages
plates et peu profondes se trouvent découvertes et presque laissées à
sec à une assez grande distance au large. Une des plages qui réunit le
mieux ces deux conditions est celle du Calvados ; aussi, n'est-il pas
étonnant de voir la mer se retirer sur certains points jusqu' à une
distance de quatre ou cinq kilomètres. Tout le monde connaît la
fameuse chaîne des rochers de Calvados qui ont donné leur nom au
département ; d'ordinaire ils sont entièrement plongés sous l'eau, on
n'en aperçoit pas la moindre crête à la surface. Mais viennent les
basses mers des équinoxes, on les voit se détacher par massifs noirs
sur la plage sablonneuse. C'est
une grande fête pour les habitants du pays et des villes voisines, on
voit ce jour-là hommes et femmes de tout rang et de toute qualité,
suivre pied à pied la mer qui se retire jusqu'au delà du rocher,
laissant derrière elle une infinité de poissons de toute sorte
oubliés dans les petites mares qui se forment dans les bas fonds de
sable avec une profondeur de quelques pouces d'eau à peine. Il se fait
alors sur tous les points une pêche générale, pêche à la main et
sans danger, à laquelle tout le monde peut prendre part, d'autant plus
qu'on ne risque jamais que de se mouiller les pieds jusqu'à la hauteur
de la cheville. La
pêche est des plus variées : aux poissons les plus estimés viennent
se joindre des coquillages, tels que homards, langoustes, pouparts
(sorte de gros crabes qui s'enfoncent dans le sable), des crabes de
plusieurs espèces, des huîtres qu'on détache du rocher, une foule de
petit coquillages rares et curieux par leur forme bizarre, puis des
étoiles de
Mai 1859 - La « Joséphine-Rosalie ». - Il n'est question en ce moment sur nos côtes, dit « le Moniteur du Calvados », que d'un terrible sinistre qui serait arrivé au bateau de pêche la « Joséphine-Rosalie », capitaine Letellier (Paul), appartenant à Mme veuve Leroux, de Langrune. Depuis le 29 mars, jour où ce navire a été rencontré par le bateau « Charles-Marie », de Fécamp, on n'en a reçu aucune nouvelle. La « Joséphine-Rosalie » avait à son bord vingt-cinq hommes d'équipage, non compris le capitaine, presque tous mariés et pères de famille. On pense que le navire a péri corps et biens dans l'Océan Atlantique, près les îles d'Ouessant (Finistère), coulé par un des bâtiments à vapeur qui sillonnent ces parages en si grand nombre. Une centaine de filets, dont plusieurs ont été reconnus pour appartenir à la « Joséphine-Rosalie », ont été ramassés sur les côtes de ces îles. Cet événement plonge dans la douleur vingt-six familles qui toutes jouissaient des sympathies publiques. Fasse le ciel que toute espérance ne soit pas perdue. (Source : Le journal de Honfleur)
Octobre 1859 - L’été de la Saint-Michel. - L'été de la Saint-Michel nous est arrivé depuis quelques jours, il s'est manifesté par un temps magnifique et par une élévation de température qui nous ramène aux beaux jours du mois d'août. (Source : Le journal de Honfleur)
Octobre
1859 - Une aurore boréale. - Samedi
soir, on a observé, vers huit heures et demie, dans la direction du
nord-ouest, sur les côtes de la Seine-Inférieure, du Calvados et de la
Manche une aurore boréale. Elle a commencé par des rayons
blanchâtres, qui se sont confondus en une masse orangée, d'une clarté
assez vive. Ce spectacle a duré environ cinq minutes. (Source : Le
journal de Honfleur)
Avril 1860 - Une circulaire du Ministre. - Une circulaire du ministre de la marine vient d'autoriser les jeunes gens de la classe de 1859, qui appartiennent aux communes du littoral, à contracter des engagements volontaires de sept ans pour les divisions des équipages de la flotte. Afin de faciliter l'incorporation d'un plus grand nombre de jeunes conscrits, le ministre a décidé que la taille de 1 mètre 63 centimètres, au lieu de 65, pouvait être accordée aux jeunes gens qui justifieront cette faveur par leur constitution et leur aptitude spéciale au service de la marine. ( L’Ordre et la Liberté)
Avril 1860 - L’hiver. - Le bonhomme hiver veut-il ou ne veut-il pas céder sa place au printemps ? Telle est la question que nous nous adressons depuis trop longtemps déjà. Mardi dernier, les rayons du soleil étaient tellement splendides qu'on se sentait aise de prendre les vêtements d'été.
Mai 1860 - Une victime de l'intempérance ! - Le 21 de ce mois, on a trouvé dans les dunes, entre Langrune et St-Aubin, le cadavre d'un individu qu'on n'a pas tardé à reconnaître pour être celui du sieur Patey François, âgé d'environ 55 ans, journalier, né et domicilié à St-Aubin-sur-Mer. Après
examen fait du cadavre, de la part d'un homme de l'art, il a été
constaté que la mort n'était que le résultat de l'abus des liqueurs
fortes. ( L’Ordre et la Liberté)
Juillet
1860 - Un acte de courage.
-
Nous nous empressons d'enregistrer un acte de courage et de
dévouement qui s'est accompli dernièrement à Langrune, et qui fait le
plus grand honneur à son auteur. Mercredi
dernier, le nommé A. Pain, âgé de 17 ans, conçut la malencontreuse idée de prendre un bain peu de temps après
avoir mangé. Bientôt le travail de la digestion étant arrêté, ce malheureux jeune homme ne pouvait plus respirer et vit avec effroi le danger qui l'entourait. A ses cris de désespoir, M. Rousselle, baigneur à l'établissement des bains de Langrune, s'élança à son secours et parvint, non sans de grands efforts, à le ramener sur la plage, où des soins empressés le rappelèrent à la vie. ( L’Ordre et la Liberté)
Juillet
1860 - Les militaires au champ.
-
Depuis quelques jours nous jouissons d'une température admirable
qui répare les dégâts causés dans nos campagnes par des pluies
incessantes qui, dernièrement, nous faisaient concevoir de sérieuses
craintes pour nos récoltes. Aujourd'hui nos prairies ont repris leur
riant aspect et les travaux des champs s'exécutent dans de bonnes
conditions. On
sait que, sur la demande de M. le préfet, un certain nombre de
militaires de la garnison sont mis, pendant le temps des moissons, à la
disposition des agriculteurs. Voici quelles sont les conditions exigées
pour l'obtention de ces militaires. 1°
leur transport gratuit au lieu de travail. 2°
la fourniture d'habits de travail. 3°
la nourriture et le couchage. 4°
le repas à demi-paie le dimanche. 5°
le salaire est fixé à 1 fr. 50 c. par jour. Les demandes de travailleurs doivent être adressées à M. le préfet. ( L’Ordre et la Liberté)
Août
1860 -
Amélioration
des moulières
sur le littoral
du Calvados.
-
Conseil général.
Vu la
délibération par
laquelle le Conseil
d'arrondissement de
Pont-l'Evêque signale
le mauvais
état des
moulières du littoral.
Considérant que les
produits des
moulières du littoral
ont diminué dans
une grande proportion,
que de 155
000 fr. qu'ils étaient Par ces motifs, prie l'administration de s'occuper de l'étude de cette question, afin de porter, s'il est possible, un prompt remède à cet état de choses.
Août 1860 - Création de bancs d'huîtres sur les côtes du Calvados. - Le Conseil d'arrondissement de Caen demande que des tentatives soient faites pour peupler de bancs d'huîtres les côtes du Calvados. Considérant que les expériences tentées sur les côtes de Bretagne et de Gascogne, pour y créer des bancs d'huîtres, ont parfaitement réussi, que les côtes du Calvados présentent toutes les conditions désirables à cet effet, que l'industrie des parcs à huîtres a reçu une extension considérable sur les côtes du département. Émet le vœu que l'administration supérieure ouvre un crédit pour le repeuplement des côtes du Calvados de bancs d'huîtres.
Septembre
1860 - Une incendie.
- Un incendie
a eu lieu, avant-hier, chez Mlle Leroux, armateur à Langrune. Divers
objets d'armement ont été détruits et ont occasionné une perte de
d'environ 1 509 fr., qui sera supportée par la compagnie du Soleil. ( L’Ordre
et la Liberté)
Août
1861 - Un sinistre à Langrune. - Un
grand malheur vient d'attrister la plage de Langrune. Deux marins, les
nommés Letellier (François) et Laurent (Auguste) partirent, mercredi
matin, dans un petit canot pour faire la pêche. La mer était belle, et
rien ne pouvait faire présager le triste accident que nous déplorons.
Les voiles étaient, dit-on, trop fortes, et on pense qu'un léger coup
de vent de terre a sufi pour faire sombrer la frêle embarcation. Un
des deux marins, François Letellier a été assez heureux pour saisir
les avirons au moyen desquels il s'est soutenu sur l'eau. Pendant une
heure et demie, il a crié au secours. Une barque de Luc a fini par
l'entendre, et il a pu être ramené sain et sauf au rivage. Mais son
compagnon a immédiatement coulé, et tous les jours on attend que la
mer rapporte son cadavre. Laurent
(Auguste) était âgé de 26 ans et marié depuis quatre ans. Il laisse
sa jeune femme enceinte et une pauvre petite fille de 29 mois ! On
nous écrit que M. le curé de Langrune, mú par un vif sentiment de
charité, a déjà recueilli, en faveur de cette veuve désolée et
dénuée de toutes ressources, des dons parmi les respectables familles
qui sont en ce moment aux bains. En
portant ce douloureux événement à la connaissance de nos lecteurs,
nous espérons que le pieux exemple du vénérable pasteur de Langrune
ne restera pas isolé, et que de nombreuses offrandes lui viendront en
aide pour soulager une aussi grande infortune. Une
souscription est ouverte, à cet effet, dans les bureaux de l'Ordre et
la Liberté. ( L’Ordre et la Liberté )
Août
1862 - Pour la restauration. - Nous
rappelons à nos lecteurs que c'est jeudi prochain, 7 courant, à 5
heures de l'après-midi, qu'aura lieu la cérémonie religieuse en
Octobre 1862 - Le temps qu'il fait. - Une succession de tempêtes et de giboulées, mêlées de coups de tonnerre, cause, depuis plusieurs jours, de notables dégâts aux toitures de nos maisons et aux arbres de nos campagnes. Nous apprenons que, dans les vergers du Bessin et du Pays-d'Auge, beaucoup de pommiers ont été renversés ou au moins fort endommagés par la violence du vent du sud-ouest. Le baromètre, qui était descendu, ces jours-ci, au-dessous de 745 millimètres, est remonté, la nuit dernière, au-dessus de 752. Néanmoins, une pluie diluvienne est venue encore déconcerter, ce matin, les personnes qui espéraient une trêve dans cette continuité de mauvais temps. Les
colzas, dont on a planté cette année une quantité exceptionnelle,
doivent avoir et au-delà l'eau nécessaire à leur reprise. Nos
rivières ont considérablement grossi, mais nous n'avons jusqu'ici
reçu la nouvelle d'aucune inondation. (l’Ordre et la Liberté)
Novembre 1862 - Avis. - Le préfet du Calvados a l'honneur d'informer les institutrices du département que le Jury international de l'exposition de Londres a décerné une mention honorable collective aux écoles de filles du département, pour les travaux d'aiguille exécutés dans ces écoles. (l’Ordre et la Liberté)
Novembre
1862 -
Le mauvais temps. -
Le Courrier
de Cherbourg signale
le mauvais temps qui règne sur nos côtes, soumises, paraîtrait-il, à
une seconde édition des rafales équinoxiales. Jusqu'à ce jour,
cependant, on n'a aucun sinistre à déplorer. (l’Ordre et la
Liberté)
Juillet 1863 - Des militaire aux champs. - Le ministre de la guerre a décidé que cette année, comme les années précédentes, des militaires seraient mis à la disposition des cultivateurs qui en auraient besoin pour les travaux des champs, à défaut d'un nombre suffisant d'ouvriers civils. (l’Ordre et la Liberté)
Juillet 1863 - Le temps. - Le beau temps qui nous favorise d'une façon si exceptionnelle cette année attire sur nos côtes une affluence considérable de baigneurs. De tous côtés les plages offrent l'aspect le plus riant et le plus animé. A Trouville, le nombre des étrangers est immense, il en est de même à Cabourg, à Beuzeval, à Houlgate. D'un autre côté, les voitures de M. Luard, qui ne désemplissent pas, déversent à toute heure des flots de voyageurs à Lion, à Luc, à Langrune, à Saint-Aubin, à Bernières à Courseulles, etc... Arromanches n'est pas resté étranger à ce mouvement, un assez grand nombre de baigneurs s'y sont donné rendez-vous. En ce moment, deux hôtes illustres y sont attendus : le célèbre historien, M. Thiers ; puis Mme la maréchale Mac-Mahon, duchesse de Magenta. On
annonce pour dimanche prochain, une brillante fête de bienfaisance qui
sera donnée dans le vaste Casino de Cabourg. MM. les administrateurs de
cet établissement ont eu la bonne pensée d'organiser un bal au profit
des pauvres, parmi les souscripteurs on cite le prince et la princesse
de Metternich. (l’Ordre
Avril 1864 - Chemin de fer en projet de Caen à la mer. - M. le préfet du Calvados, à la date du 14 avril, a pris l'arrêté suivant : Nous, préfet du département du Calvados, officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. - Vu la décision, en date du 7 de ce mois, par laquelle M. le ministre des travaux publics a autorisé M. Mauger (Anthime), demeurant à Douvres, à faire les études d'un chemin de fer entre Caen et la mer. - Vu l'art. 1382 du Code Napoléon, les lois des 16 septembre 1807 et 3 mai 1841. Avons arrêté : Art. 1er. M. Mauger et les agents par lui préposés sont autorisés, en exécution de la décision ministérielle indiquée ci-dessus, à pénétrer sur les propriétés privées pour étudier le meilleur tracé de la ligne en projet de Caen à la mer. Ces études s'appliqueront aux terrains situés dans les communes de Caen Venoix, Saint-Contest, Épron, Cambes, Mathieu. Anisy, Anguerny, Douvres, Luc, Langrune, Saint-Aubin-sur-Mer, Bernières et Courseulles. Art. 2. Une expédition du présent sera adressée à MM. les maires, pour être affichée aux lieux accoutumés. Une expédition sera également transmise à M. Mauger, qui devra, lui et ses agents, en justifier aux propriétaires, sur leur réquisition, en prenant envers eux, s'il est besoin, l'obligation écrite de leur payer les dommages occasionnés. (l’Ordre et la Liberté)
Juin 1864 - Chemin de Caen à la Mer. - Il y a à peine deux mois qu'il est question d'un chemin de fer de Caen à la mer, que déjà, tant est vive l'impatience du public, on voudrait voir cette nouvelle ligne livrée à la circulation. Mais les choses ne vont pas si vite, et, avant que le sifflet d'une locomotive ne se fasse entendre sur les côtes si riantes de Luc ou de Courseulles, il faut rédiger le projet, étudier le meilleur tracé, le soumettre à l'approbation, puis faire les travaux, etc..., etc…, ce qui ne veut pourtant pas dire que nous sommes condamnés à attendre longtemps encore l'inauguration du chemin. Non l'entreprise est confiée à des mains trop habiles et surtout trop actives pour avoir à redouter ce désagrément. Nous pourrions presque prédire que, le 1er juillet de l'année prochaine, la population caennaise pourra déjà se rendre à Luc. La ligne projetée, qui s'étend de Caen à Courseulles, aura un parcours total de 24 kilomètres, plus une ligne de raccordement, de 4 à 5 kilomètres, avec le réseau de l'Ouest, elle desservira les stations suivantes : Caen, Cambes, Mathieu, Douvres, la Délivrande, Luc, Langrune, St-Aubin, Bernières et Courseulles. La gare de Caen sera construite en grande partie sur le terrain occupé par la propriété de M. de Lalonde, place St-Martin. Cette gare sera monumentale, et l'idée générale qui a présidé à la composition de sa façade offre une grande analogie avec les dessins de la magnifique gare de Strasbourg, à Paris. Une colossale statue de Notre-Dame de la Délivrande ornera son fronton, et, bénissant l'entreprise, elle semblera la présider. L'étude des 24 kilomètres est terminée, mais le projet ne sera complètement rédigé que dans un mois environ, époque à laquelle il sera soumis à l'approbation de l'administration. Les travaux ne pourront donc être commencés qu'au mois de septembre prochain, c'est-à-dire après les récoltes. Il n'y aura de travaux importants, dans toute l'étendue de la ligne, que pour monter de Caen sur les hauteurs de Couvrechef, et pour descendre des hauteurs de Mathieu jusqu'au niveau du rivage de Luc, et encore l'importance de ces travaux n'est-elle que secondaire. Dans
tout le parcours, les plus fortes pentes n'excèderont pas un
centimètre par mètre, et les rayons des courbes ne seront nulle part
inférieurs à 500 mètres. Ce renseignement La ligne de Courseulles se raccordera avec le chemin de fer de Paris à Cherbourg, dans la prairie, derrière l'établissement du Bon-Sauveur, au moyen de l'embranchement de 4 à 5 kilomètres dont nous avons déjà parlé. Certains trains, et notamment l'express venant de Paris, seront en correspondance immédiate avec le service de Courseulles, à cet effet, une machine légère opérera le transport d'une gare à l'autre. Le trajet de Caen à Courseulles s'effectuera en 55 ou 60 minutes. Le dimanche matin, le mouvement des voyageurs étant plus considérable, des départs auront lieu d'heure en heure de Caen pour Luc, où on arrivera une demi-heure après. Il y aura, bien entendu, une très grande amélioration dans le prix du transport, on parle de billets d'aller et retour, de Caen à Luc, moyennant 1 fr.. Ainsi qu'il était facile de le concevoir, l'administration n'a rencontré aucun obstacle de la part des cinq ou six cents propriétaires auxquels elle a dú s'adresser pour obtenir des renseignements, aux termes de l'arrêté de M. le préfet du Calvados, en date du 14 avril dernier, tous ont montré une grande obligeance envers les agents de la nouvelle entreprise. L'aplanissement de toutes les difficultés matérielles laisse donc espérer que la ligne de Caen à Luc sera livrée à la circulation le 1er juillet 1865. On dira peut-être qu'il sera difficile de réaliser un projet aussi important dans l'espace de dix mois. Nous n'aurons qu'une réponse à opposer à cette objection, c'est que l'activité si connue de M. Mauger et de M. l'ingénieur chargé du projet saura bien suppléer à la brièveté du temps qui existe entre le mois de septembre et le mois de juillet. (l’Ordre et la Liberté)
Août 1864 - Pour les pauvres. - On se souvient avec infiniment de plaisir du beau concert donné l'an dernier, à pareille époque, par des artistes d'élite, à l'hôtel du Petit-Paradis, en faveur des pauvres de Langrune. Cette année, les mêmes artistes, dont le cœur égale le talent, se proposent de donner une matinée musicale à laquelle sont conviés les nombreux baigneurs de nos plages, aussi bien que tous les amateurs de notre pays. Un public nombreux ne manquera pas d'assister à cette jolie fête, qui procurera un double plaisir, celui, d'abord, d'exercer la charité, et en même temps celui d'entendre de bonne musique, exécutée par des artistes universellement connus et appréciés. Le concert aura lieu à Langrune, hôtel du Petit-Paradis, le mardi 23 du présent. On commencera à midi. L'entrée
est gratuite, mais il est exigé, pour être admis, de se munir d'une
carte, qui pourra servir pour toute une famille. On trouvera des cartes
au bureau de notre journal. (l’Ordre et la Liberté)
Août
1864 -
Pour les écoles. -
Le ministre de l'instruction publique vient de charger les
préfets de demander aux Conseils généraux une allocation pour acheter
à l'usage Un
baromètre de Fortin. Un
thermomètre à minima de Rutherford. Un
thermomètre à maxima de Negretti. Un
psychromètre. Un
pluviomètre. Une
girouette. L'achat
de tous ces objets ne doit pas dépasser 250 fr., et permettra, dit M.
le ministre, aux écoles normales de rassembler les matériaux d'une
statistique des orages qui sévissent sur la France. (l’Ordre et la
Liberté) Août
1864 -
Le mauvais temps. -
Les bourrasques qui se sont fait sentir, mardi dernier, ont été
si violentes qu'elles ont occasionné des dégâts dans beaucoup de
communes. Des pommiers ont été couchés sur le sol ; beaucoup d'autres
ont eu leurs branches rompues. Les pommiers et les poiriers ont été tellement secoués par la tempête, qu'une grande quantité de fruits jonchent le sol. Ce fait est d'autant plus regrettable que ces fruits sont loin de leur maturité, ce qui constitue une perte évidente pour les propriétaires. (l’Ordre et la Liberté)
Septembre
1864 -
La grande marée. -
La grande
marée du 18 n'a produit sur tout notre littoral aucun phénomène digne
de remarque. M. Babinet et les curieux attirés par ce spectacle
toujours imposant en ont été cette fois pour leurs frais d'annonce et
de curiosité. C'est à peine si, à Langrune, la mer, en se retirant, a
laissé apercevoir les rochers du Calvados. De
Honfleur, on écrit que la marée, cotée 1-16, s'est élevée dans
les bassins à une hauteur moindre que celle du mois de mars, qui
n'était cotée que 1-14, et pendant laquelle la mer avait pourtant
envahi une partie des quais de ce port. Il faut dire aussi que le vent
qui soufflait S. S.- O. a puissamment contrarié l'attente des amateurs. A
Caen, un assez grand nombre de personnes s'étaient rendues dimanche
matin sur le cours Caffarelli, et attendaient sur les bords de l'Orne
l'arrivée d'une barre quelconque, mais la barre capricieuse s'est
vainement fait attendre, et, les choses s'étant passées avec le calme
ordinaire, chacun s'est retiré avec plus ou moins de désappointement.
On nous assure qu'à Caudebec et à Villequier, points maximum du
mascaret, la déception a été tout aussi grande que partout ailleurs. C'est
jeudi prochain, 22 septembre, à 7 heures 25 minutes du soir, que
l'été finit et que commence l'automne.
(l’Ordre et la Liberté)
Décembre 1864 - Le temps qu’il fait. - La neige est tombée assez abondamment dans nos contrées dimanche matin ; à midi, elle avait déjà, aux environs, une épaisseur de près de 20 centimètres. La soirée de dimanche a été calme et douce, mais, dans la nuit, le froid l'a emporté, et, lundi matin, le thermomètre marquait une des plus basses températures de nos contrées maritimes, 10 degrés au-dessous de zéro. Cherbourg et le Cotentin, en général, ont eu plus de neige que nous, ce qui n'est pas habituel. Cette neige a l'inconvénient d'arrêter beaucoup de travaux, mais elle est plutôt avantageuse aux biens de la terre. Elle recouvre les nouvelles semailles, fait mourir les insectes et protége les colzas, si retardés cette année, et qui ne résisteraient pas à une forte gelée directe. Ces
derniers frimas ont nécessairement interrompu la fabrication des
cidres, qui était assez avancée, et qui donnait des résultats
exceptionnels. En effet, les jus de cette année Quant
au commerce des poulains et des chevaux en général, à part les sujets
d'élite, il y a stagnation obstinée, malgré l'impulsion que la
fondation de la Société du demi-sang normand avait paru donner tout
d'abord au marché chevalin. Le mécanisme de cette institution est du
reste mieux compris, et beaucoup de gens qui, dans le principe, ne
s'étaient pas bien rendu compte de la raison d'être de cette nouvelle
Société d'encouragement, reviennent de leurs défiances, maintenant
surtout que la publication des statuts leur a ôté pour le moment toute
crainte de la voir dégénérer en Société étalonnière. (l’Ordre
et la Liberté)
Juillet
1865 -
L'état des récoltes.
- Nous lisons dans le dernier numéro du Pays normand : «
L'état des récoltes est satisfaisant; cependant, si l'on s'en rapporte
aux apparences, la récolte en blé équivaudra à une forte demi-année
tout au plus. Dans le Lieuvain et lieux circonvoisins, les blés offrent
un bel aspect, toutefois ils auraient besoin d'un peu de pluie. La région normande est la moins mal partagée pour les colzas; on compte à peu près sur une demi-année, tandis que dans les autres contrées le produit sera presque nul. Les rares pommiers qui avaient quelques fruits les perdent en ce moment, par suite de la sécheresse. En définitive, les choses se passeront comme nous l'avons déjà dit : la récolte sera insignifiante. La récolte fourragère est magnifique. » (l’Ordre et la Liberté)
Juillet 1865 - On nous écrit de Langrune. - Langrune a des moments d'émotion comme l'Océan qui borne un de ses côtés. La semaine dernière, les premières familles arrivées ici pour prendre les bains, ne retrouvaient sur cette plage hospitalière aucune des franchises dont elles jouissaient les années précédentes. Tout le rivage est loué par adjudication publique, et l'adjudicataire prétendait exercer un arbitraire qui aurait fait fuir les baigneurs et nui singulièrement aux intérêts de la commune. De son côté, le maire défendait au sieur Blanc, dit Zéphir, de conduire à la mer des personnes qui depuis onze ans ont confiance en lui, et qui déclaraient qu'elles quitteraient Langrune s'il leur fallait recourir à l'adjudicataire actuel ou à ses agents. Grande imprudence du maire à la veille des élections ! Heureusement,
le premier magistrat du département, M. Le Provost de Launay, a
écouté les plaintes des baigneurs, et a fait droit à leurs
réclamations. Désormais la plage est libre, on peut y porter sa chaise
ou son pliant sans payer une rétribution illégale. Zéphir continuera
son industrie. (l’Ordre et la Liberté)
Juillet
1865 -
On nous écrit !
- Voici
la lettre de M. Roussel, baigneur à Langrune, dont nous avons parlé
jeudi : Langrune-sur-Mer,
le 11 juillet 1865. «
Je lis dans votre numéro du 6 de ce mois un article qui se rencontre
aussi dans le journal le Moniteur du Calvados de la même date,
et qui blesse gravement mes intérêts.
Il
est clair seulement que j'ai le droit de proscrire tout établissement
de bancs et toute agglomération de chaises, destinés à recevoir les
promeneurs, en exigeant d'eux une rétribution, qu'à moi seul ce droit
appartient. Quant
à la question des guides, il conviendra d'examiner, si après une
convention formelle, faite entre moi et la commune, sanctionnée et
homologuée par l'administration supérieure, et en tout conforme au
cahier des charges des adjudications des localités voisines, je dois
jouir des droits qui me sont concédés et que j'ai chèrement achetés
par un prix fort élevé de location et par des charges considérables
qui me sont en sus imposées dans l'intérêt de la sûreté publique. Je
me propose donc d'adresser de suite une réclamation tant à M. le
préfet qu'à M. le maire de Langrune, et, si je ne suis pas octroyé,
de poursuivre la réparation du préjudice qui m'est occasionné,
laissant à chacun la responsabilité des dommages que la commune
éprouvera. Je
vous invite, monsieur, à insérer la présente dans votre prochain
numéro, et au besoin, je requiers cette insertion. Agréez,
Monsieur, mes civilités empressées. Auguste ROUSSEL. (l’Ordre et la Liberté)
Juillet 1865 - On nous écrit ! - Avant de l'insérer, nous avons cru convenable de communiquer à notre correspondant de Langrune la lettre qu'on vient de lire, en lui demandant son appréciation. La réponse que nous recevons, sous la date du 14, est celle-ci : « Tous les intérêts sont respectables, tous ! mais le sieur Roussel nous permettra de faire passer ceux du public avant les siens. Aujourd'hui il recule devant une prétention qu'il affichait le mois dernier, celle d'imposer une rétribution à toute chaise, à tout pliant, apportés par un promeneur pour se reposer sur le rivage de Langrune. il a raison. Aussi bien, M. le préfet a-t-il fait droit aux réclamations qu'il a reçues contre cette étrange privilège. La question des guides a également été tranchée par M. le préfet avec son équité ordinaire. Il a reconnu aux baigneurs le droit de donner leur confiance à qui ils veulent, pourvu que le guide remplisse les conditions qu'impose la prudence des règlements. Si la commune de Langrune a vendu des privilèges qui ne lui appartenaient pas, le hasardeux acquéreur de ces privilèges peut réclamer, jeter les hauts cris, user même du papier timbré: c'est son affaire. Agréez,
etc... » (l’Ordre et la Liberté)
Mars
1866 -
Les bains de mer. -
Les habitants du
littoral font déjà de grands préparatifs pour la saison des bains de
mer. Cette saison est l'une de leurs principales ressources, grâce à
la vogue actuelle de la villégiature maritime. Il n'est donc pas
étonnant si chaque localité cherche à se surpasser pour offrir aux
étrangers toutes les A
Luc-sur-Mer, la masure qui offensait la vue, vis-à-vis de l'hôtel de
M. Francis, a été démolie et le chemin qui conduit à la mer a été
réparé et élargi de plusieurs mètres. On y construit en ce
moment des maisonnettes destinées au petit commerce, ce qui ajoutera
encore à l'animation de la plage. Lion-sur-Mer,
Langrune, Saint-Aubin ne restent pas non plus inactifs. Dans
cette dernière localité, un hôtel-restaurant va être installé pour
la belle saison, et la municipalité de cette commune prend toutes
les mesures nécessaires pour en rendre le séjour plus agréable que
jamais aux étrangers. Comme on le voit, nos populations maritimes ne restent pas en arrière du progrès, et elles comprennent enfin que les bonnes récoltes ne se font qu'avec de bonnes semailles.
Décembre
1866 -
Un secours. -
Par décision du 5 décembre, conformément à la proposition de
M. le Préfet, M. le ministre de la justice et des cultes a bien voulu
accorder un secours de 8000 francs à la commune de Langrune pour
l'aider dans la dépense de consolidation du clocher de son église.
Avril
1867 -
Une condamnation. -
M. Jules Guesdon, âgée de 17 ans, marin, demeurant à Langrune,
est poursuivi pour rébellion. Déclaré coupable de ce délit commis
par lui à Ouistreham le 3 mars dernier, il est condamné à un mois
d'emprisonnement.
Avril 1867 - Un accident. - Samedi, vers quatre heures de l'après-midi, une voiture lourdement chargée de pierres à ferrer les routes et conduite par le sieur Buhour, cultivateur à Langrune, passait rue Saint-Jean à Caen, l'essieu s'étant tout à coup rompu par les deux bouts, a été renversée et brisée. Il y a pas eu d'autre accident.
Septembre
1867 -
Une visite. - M.
le comte de Quast, inspecteur général des monuments du royaume de
Prusse, a passé près d'une semaine dans le Calvados. Il
a visité successivement Falaise, Saint-Pierre-sur-Dives et plusieurs
églises rurales de la contrée. À Caen, il a vu avec le plus grand
intérêt nos églises de l'Abbaye, de la Trinité et de Saint-Pierre,
et dans l'arrondissement celles de Bernières, Langrune, Thaon,
etc..., les châteaux de Lasson et de Fontaine-Henry. Enfin, à Bayeux,
M. Lambert lui a fait voir la cloche de Fontenailles, la Tapisserie et
la cathédrale.
Octobre
1867 -
L'orage du 3 octobre.
- Nous
apprenons que sur toutes les côtes du Calvados, la mer a été
terrible, pendant toute la durée de cet orage dont tant de communes ont
eu à souffrir. Les
vagues, soulevées comme par une force invisible, s'élevaient à de
gigantesques hauteurs, et venaient battre la grève avec fureur. Aucun accident, que nous sachions, du moins, n'est heureusement à déplorer de ce côté.
1°
Une rente de 500 francs au capital de 10 000 francs au bureau de
bienfaisance de Langrune-sur-Mer, dont 250 francs doivent être remis à
M. le curé pour être, par ses soins, distribués aux pauvres de
ladite commune, sans en rendre compte à qui que ce soit. 2°
Une autre rente de 300 francs au capital de 6000 francs au profit
des écoles de ladite commune, dont 200 applicables à l'école des
filles. 3°
18 000 francs à l'agrégation des sœurs de la Miséricorde
établie à Caen. 4°
6 000 francs à l'agrégation de l'établissement des Petites-Sœur
des pauvres à Caen 5°
10 000 francs au bureau de bienfaisance de la ville de Caen.
Mai
1868 -
Le climat. -
L'élévation de la température qui n'a cessé de régner
pendant la majeure partie du mois qui se termine, est un événement
assez rare dans nos climats,
où la chaleur n'atteint son maximum que vers le mois de juillet. Voici
à cette occasion la nomenclature des plus fortes chaleurs observées
depuis un siècle et demi : En
1702, le thermomètre monta à 39 degrés centigrades au dessus
de zéro. En
1753 et 1793, à 38 degrés. En
1825, à 37 degrés. En
1800 et en 1830, à 36 degrés. La moyenne de la chaleur des étés et de 30 degrés. Cette moyenne à presque été atteinte dans la dernière quinzaine de mai 1868.
Juin 1868 - Une arrestation. - Mardi la nuit, les gendarmes de Douvres ont amené à Caen, dans une voiture, le nommé Georges Christ, demeurant à Langrune. Cet homme, qui est fou furieux, avait été arrêté à Ouistreham.
Août
1868 -
Un rappel. -
Nous croyons le moment opportun pour appeler que le 23 juillet,
la Cour impériale d'Aix a décidé que le fait de se baigner sans
vêtement constitue non pas seulement une contravention de police, mais
bel et bien un outrage public à la pudeur prévue par l'art. 330 du
Code pénal et puni, sauf l'admission de circonstances atténuantes,
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16
à 200 fr.
Août
1868 -
Les vols. -
Les plaintes s'élèvent contre les bandes de rôdeurs qui
exploitent en ce moment le littoral. Depuis
Honfleur jusqu'à Arromanches et au-delà, on voit, depuis que la saison
des bains est ouverte, des compagnies de bohémiens qui viennent camper
à l'entrée des communes
du littoral, et de la envoient leurs enfants en haillons et pieds nus,
mendier dans les maisons et jusque sous les pieds des chevaux et sous
les voitures au risque de
Août
1868 -
Décision du Conseil général.
- La session
du Conseil général, commencée le lundi 24 août, a été terminée
lundi dernier, à trois heures. Parmi
des décisions prises par le Conseil, nous devons une mention toute
particulière à l'approbation qu'il a donné, samedi, à la
construction des chemins de fer départementaux : 1°
Chemin de fer de Caen à Courseulles, passant par Cambes,
Mathieu, Douvres, Luc, Langrune, Saint-Aubin, Bernières. 2°
D'Orbec à Lisieux, sur une longueur de 16 kilomètres. 3°
De Falaise à Pont-d'Ouilly, à un point de raccordement sur la
ligne de Caen à Flers.
Septembre
1868 -
Le chemin de fer. - La
question du chemin de fer de Caen à Courseulles va avoir prochainement
une solution. Trois
compagnies se présentent pour entreprendre la construction de cette
nouvelle ligne, qui pourra être terminée pour l'été 1870.
Octobre 1868 - Une annonce. - On annonce que les Conseils municipaux vont être convoqués en session extraordinaire pour s'occuper des chemins vicinaux et voter une imposition nécessaire à leur achèvement.
Octobre 1868 - La mer. - Dans la nuit de mardi à mercredi, la mer de la Manche avait une phosphorescence comme on ne lui en voit pas aux plus fortes chaleurs de l'été. Les bateaux en marche paraissaient naviguer au milieu d'une véritable mer de feu.
Octobre
1868 -
Un phénomène.
- Un curieux
phénomène s'est produit mercredi, vers minuit. Les quelques personnes
qui, à cette heure avancée, se donnaient le plaisir de la promenade,
ont aperçu dans l'espace un magnifique météore qui apparaissant dans
la direction de l'est est allé disparaître derrière les hauteurs du
bois de Rocques. Sa
forme était celle d'un globe de transparence blanche, traînant à sa
suite une longue bande d'un rouge étincelant, illuminant le paysage
comme une vive lumière électrique. La
marche peu rapide de ce bolide a permis à ceux qui l'ont aperçu
d'admirer son éclat. Son passage est signalé dans plusieurs villes. À Caen son passage n'a été annoncé par aucun bruit, tandis qu'à Rouen, on a entendu une forte détonation.
Octobre 1868 - La garde nationale. - Les maires de toutes les communes de France viennent de recevoir du ministre de la guerre la liste des hommes inscrits pour faire partie de la garde nationale.
Novembre
1868 -
Des décès. - Avec
l'un de nos confrères, nous avons dit dans notre dernier numéro, que
trois personnes étaient mortes subitement à Langrune. Des
renseignements qui nous parviennent de cette commune, il résulte que
Mme Laville seule aurait succombé violemment.
En
travestissant ainsi les fait, l'auteur de l'article a-t-il été de
bonne foi, ou bien a-t-il voulu mettre sa plume au service de
déplorables dissentiments ? Quoi
qu’il en soit, ce n'est pas par de tels procédés qu'on parviendra à
les éteindre, et à ramener la paix et la concorde dans cette commune
divisée depuis trop longtemps.
Novembre 1868 - Un drame. - Le 12 de ce mois, dans le courant de la journée, la femme Laville, née Grenier Marie-Anne, âgée de 64 ans, ménagère à Langrune, qui était occupée à laver du linge, a été frappée d'apoplexie foudroyante et a expiré quelques heures après.
Novembre
1868 -
Un accident. -
Dans la journée de mardi dernier, le sieur Pierre Bernard
Desaunais, cultivateur à Langrune, partait de Cheux, monté dans une
voiture, pour se rendre à son domicile. En traversant la commune de
Fresne-Camilly, il tomba de son siège, dans sa chute, il se brisa la
colonne vertébrale. Transporté
à son domicile, il y est mort le lendemain des suites de ses blessures.
Janvier
1869 -
Des ventes. -
M. François Louis Charles Lemarinier, épicier, demeurant à
Langrune, a vendu la nue propriété des immeubles ci-après désignés
: 1°
Moyennant 4920 fr. de principal, à M. Louis Jacques Alexandre
Dadin, avocat, demeurant à Caen, une pièce de terre sise à Langrune,
en la delle du Petit-Marais. 2°
Moyennant 1650 fr. de principal, à M. Victor Alphonse Knéel,
négociant à Caen, boulevard des Sables, une pièce de terre sise à
Langrune, nommée le Petit Clos. 3°
Moyennant 200 fr. de principal, à M. Pierre Christiern,
domestique, demeurant à Luc, une maison sise à Luc, au vieux Luc. 4°
Moyennant 6050 fr. de principal, à M. Dadin, susnommé, une
portion de terre en labour, sise à Tailleville, en la delle un closdes
Vingt-Acres.
Janvier
1869 -
Une condamnation.
- L'autre
samedi, M. le juge de paix de la Délivrande a condamné le sieur Colin,
à cinq jours de prison, pour avoir injurié Mlle Léonide,
porte-bannière des demoiselles de vierge de la commune de Langrune. Si
je publie cet acte judiciaire, c'est afin d'éviter toute confusion, et
qu'on aille pas supposer que, dans cette affaire, il s'agisse de la trop
célèbre Léonide, actrice parisienne. Cette dernière, peut avoir beaucoup de talent, mais je doute qu'elle possède les qualités requises pour entrer dans la congrégation des filles de vierge, et profiter des indulgences y attachées.
Février
1869 -
Une tempête. - La
tempête qui sévit depuis dimanche dans notre contrée à redoublé de
violence pendant la nuit de lundi. Le vent soufflait avec fureur, et il est
à craindre que des sinistres aient eu lieu sur nos côtes. Tout
notre littoral s'est ressenti des effets de cette épouvantable
tempête. Mardi on entendait dire aux marins qu'ils ne se rappelaient
pas avoir vu depuis plus de 20 ans, un
Mars
1869 -
Un ouragan. - L'ouragan
du 2 mars a occasionné des dégâts assez importants sur divers points
de notre département. A
Luc, le clocheton de la chapelle du Nouveau-Luc a été renversé dans
la matinée par une violente rafale. En tombant, l'une des pierres de ce
clocheton après avoir défoncé la toiture, le plafond et brisé la
balustrade, a pénétré dans la chapelle, où elle a creusé dans le
pavé un trou d'une profondeur de 20 centimètres environ. Il n'y avait
personne dans la chapelle en ce moment. Les autres pierres sont
tombées ça et là sur le mur d'enceinte du monument et en ont démoli
une vingtaine de mètres. La couverture en ardoises et les enduits en
plâtre ont éprouvé des détériorations importantes. L'orgue a
également souffert. On évalue la perte totale a près de 3000 francs. A
Lion, la mer, poussée par le vent, à défoncé le mur de soutènement
situé en face du Casino. Dans la direction de Luc, elle a submergé une
certaine quantité de terrains, et amené des éboulements de la dune. A
Langrune, la mer a également
envahi le jardin de M. de Franquenet sur une longueur de plus de 20
mètres. Aux
environs de Bayeux et de Pont-l'Evêque, bon nombre des pommiers ont
été arrachés par le vent. A
Bayeux même, l'ouragan a renversé la partie supérieure de pinacle sur
le côté méridional du portail de la cathédrale. A
Trouville, la mer était tellement grosse qu'elle a submergé les quais
à l'heure de la marée, et que ses larmes ont déferlé jusque
par-dessus le pont qui traverse la Touques. Près
de Honfleur, la tempête a fait éprouver quelques dégâts aux
propriétés longeant la mer, mais sans pertes considérable. A
Cabourg, la tempête s'est élevée avec une telle impétuosité, que la
mer a remporté la digne des bains de Cabourg, passé par-dessus la
route et envahi des maisons qui se trouvent à la descente de Caumont,
au pied de la falaise, le long du chemin du Mauvais-Pas. La
mer a également fait sentir ses ravages à Houlgate, où elle a démoli
la digue de Mlle Dupont de l'Eure.
Mars
1869 -
Une grande marée. - La
marée de lundi dernier est une des plus fortes que l'on ait vues depuis
plus de 30 ans. La mer, poussée par un vent nord-nord-est, a été
d'une violence extrême et a causé quelques dégâts. Elle est entrée
dans beaucoup de maisons du bord de la mer. Les
vagues montaient à 100 mètres le long des falaises de Port.
Mars
1869 -
La tempête du 20 mars. - Samedi
dernier, on a relevé sur le rivage de Port-en-Bessin que la mer venait
d'y porter, un cadavre d'homme. Il
a été trouvé à Luc une planche de poulaine en chêne, peinte en noir
et portant en lettres fouillées au ciseau le nom de « Tobina ». Depuis
dimanche, on a recueilli sur la plage entre Langrune et Ouistreham,
une assez grande quantité de madriers et de planches en bois blanc,
marqués SS. G. d'un bout et
Avril
1869 - La
tempête. -
On sait les malheurs et les désastres occasionnés sur nos
côtes par l'ouragan du 19 mars et des jours suivants. On sait que le
rivage a été jonché de débris, que la mer, en furie, a rejeté
un certain nombre de cadavres, et que, l'on aperçoit en plusieurs
endroits là mâture de navires enfoncés dans le sable, A
la suite des nombreux naufrages qu'il faut déplorer, la religion a
recueilli, de la part des survivants de nombreux témoignages de foi et
de reconnaissance. On
a vu des compagnies de marins partis de Ver, de Courseulles. et de;
Bernières venir
à la Délivrande pour s'acquitter du vœu qu'ils avaient fait, à
Notre-Dame pendant la tempête.
Souvent, dans;
ce pieux voyage,
les femmes accompagnaient leurs maris sauvés, comme, par miracle du
plus affreux péril. Quelle impression forte, et salutaire, fusait dans
les villages le passage de ces hommes nos
pêcheurs, aux traits fatigués,
marchand tête nue et pieds nus , le chapelet en main ou chantant
les litanies de la douce et bonne
Protectrice qu’ils avaient invoquée avec confiance dans l'horreur de
la tempête ! Quelques-uns avaient déjà les pieds en sang. Pendant
la tourmente, un marin de Langrune se trouvait près de Dives sur
son bateau. Il rapporte que dans la nuit, ils se sont vus sombrer trois
fois et que, confiant dans la divine
Providence, il renouvelait son vœu. La mer, à la fin, les a jetés,
ses compagnons et lui, sur la côté et tous en vie. Les autres, n'ont
pas manqué de venir aussitôt à la Délivrande
; pour lui, retenu d'abord par une douleur de côté, il a fait quelques
jours après son pèlerinage, pieds nus à l'aller comme,
au retour. Les
hommes du bateau échoué, aussitôt qu'ils ont pu toucher la terre, se
sont rendus à la chapelle pour y témoigner leur reconnaissance
à la très sainte Vierge. Le
lundi de Pâques, dit la Semaine religieuse, à laquelle nous empruntons
ces lignes, neuf marins échappés au naufrage de leur navire, venaient
nu-pieds en pèlerinage dans la chapelle
de la Vierge, en l'église de
Dives.
Septembre
1869 -
Fait divers.
- Nous avons
dit dans notre dernier numéro qu'un
cadavre avait été trouvé entre Luc et Langrune. Le corps a été
reconnu pour être celui
du nommé Jean-Baptiste Bénouville, âgé de 70 ans, cultivateur et
maçon, demeurant à Douvres, il avait au cou une pierre de 5 kilogs
attachée avec une corde. On attribue ce suicide
à une querelle survenue entre ce malheureux et sa femme.
Septembre 1869 - Fait divers. - La marée du 6 octobre indiquée comme devant atteindre une grande hauteur, elle est cotée 115. Le coup de vent prématuré qui s'est fait sentir porte à craindre qu'une nouvelle tempête coïncide avec l'élévation des eaux. S’il en était ainsi, il en résulterait des dégradations considérables sur nos cotes.
Octobre
1869 -
Fait
divers.
- Une
certaine appréhension paraissant exister au sujet de la grande marée
attendue sur les côtes de la Manche dans les premiers jours du mois
prochain, le lieutenant-gouverneur de Jersey a consulté à ce sujet le
« département météorologique » de Londres qui a répondu que la
plus haute marée aura lieu le 6-7
Octobre
1869 -
Le chemin de fer de
Caen à Courseulles.
- On
s'occupe activement des formalités à remplir pour commencer le chemin
de fer de Caen à Courseulles. Les entrepreneurs traitent à l'amiable
avec les propriétaires des terrains nécessaires à la construction de
la voie, et, en cas de contestation, le jury va être tout prochainement
appelé à statuer. S'il ne surgit aucune difficulté sérieuse, si l'hiver ne vient pas par sa rigueur, interrompre, les travaux, tout porte à croire que la partie comprise entre Caen et Luc-sur-Mer sera terminée et livrée à la circulation pour le mois de juillet prochain. Beaucoup
de personnes se demandent quel sera le prix des places ? Si les
entrepreneurs s'en tiennent aux conditions stipulées dans le Cahier des
charges, le prix du voyage devra être, en 3e
classe, à peu près le même que par les voitures
publiques.
Décembre
1869
- La
neige.
- Nous
sommes en hiver, la fête de Noël nous a amené la neige et le froid.
Dans toute notre contrée, la couche de neige a près de vingt
centimètres d’épaisseur. Les cours d'eau se couvrent de glace, les
travaux de maçonnerie
sont suspendus.
Février
1870 -
Fait divers.
- Le
froid de ces derniers jours a été tel, que sur notre littoral, entre
Courseulles et Ouistreham, les congres, étrilles, crabes et autres
coquillages saisis
par le froid, venaient échouer sur la grève. Des cultivateurs des
environs ont enlevé ces animaux, qui seront utilisés à
l'engraissement des terres.
Mars 1870 - La tempête. - Le mauvais temps de la semaine dernière a porté ses fruits. La côte de Courseulles à Ouistreham se couvre de débris et d'épaves. Dimanche dernier, on apercevait entre Saint-Aubin et Langrune, à peu de distance du rivage, une portion considérable d'un grand navire, dont la nationalité n'a pu être reconnue, les pêcheurs rentrant au port ont rencontré en mer des planches, des madriers, dont l'abord n'était pas sans danger, des balles de coton et de tabac qui indiquaient un naufrage dans nos parages. Un bateau de Courseulles employé à la pêche des huîtres a ramené dans sa drague une botte neuve, dans laquelle se trouvait la jambe du propriétaire, paraissant récemment détachée du tronc. Aucun cadavre n'a été signalé.
Septembre
1870 -
Les espions.
- Des
espions prussiens sont signalés sur notre littoral. A Langrune, une
visite domiciliaire a été faite pour arrêter des marchands colporteurs
dont les allures étaient suspectes. Lundi,
entre Luc et Lion, trois individus
étrangers ont
été arrêtés et dirigés sur Caen.
Octobre
1870 -
Fait divers.
-
Encore une fois, le
ciel, normand s'est trouvé illuminé par une aurore Boréale. Une
splendide couleur rouge éclairait l'espace et formait un Jadis,
les aurores boréales étaient regardées comme le signe de sanglants
désastres, aujourd'hui, on les attribue tout simplement à l'ignation
spontanée du fluide magnétique qui s'enflamme comme la limaille de
fer. On a remarqué que le sommet de l'arc dominait toujours le
méridien magnétique du lieu d'observation. Arago
croyait avoir trouvé le signe précurseur de ce phénomène dans un
mouvement sensible de l'aiguille d'inclinaison et de l'aiguille de
déclinaison, qui tous les matins du jour
ou doit, se montrer l'aurore dévie de 5 à 15 minutes. En
regardant l'aurore, beaucoup de gens croyaient y voir la réalisation de
la fameuse prophétie de Blois, qui annonce une grande perturbation dans
le ciel. Malheureusement pour les amateurs du merveilleux, les aurores
boréales sont si peu rares que jusqu'à la moitié du siècle dernier,
on avait déjà recueilli près de mille observations, et dans les
régions polaires où elles sont permanentes.
Novembre
1870 -
Fait divers.
- Une
souscription faite à Langrune, sur l'initiative de M. le curé, dans le
but de pourvoir de couvertures les jeunes mobiles de la paroisse, a
produit immédiatement une somme plus que suffisante pour cet objet. 50
fr. restants ont été adresses au P. Granger, aumônier du IIe
régiment de la mobile, avec prière d'en disposer en
faveur des jeunes soldats de Langrune. |
|||
 |
|||
 |
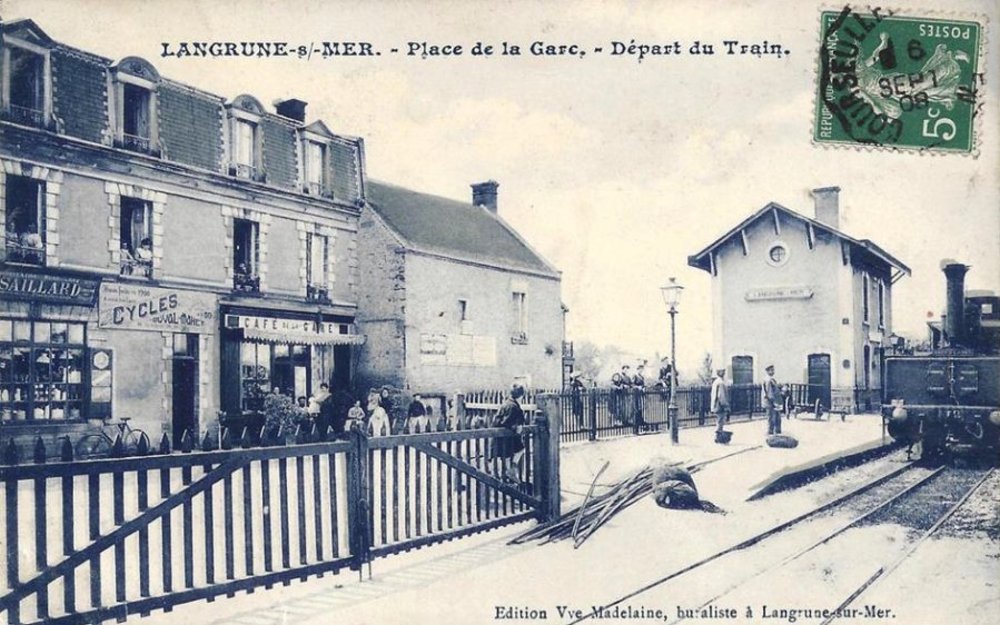 |
||
| LANGRUNE-s/MER - Place de la Gare. - Départ du Train. | |||
| Haut de page | |||
|
|
|||



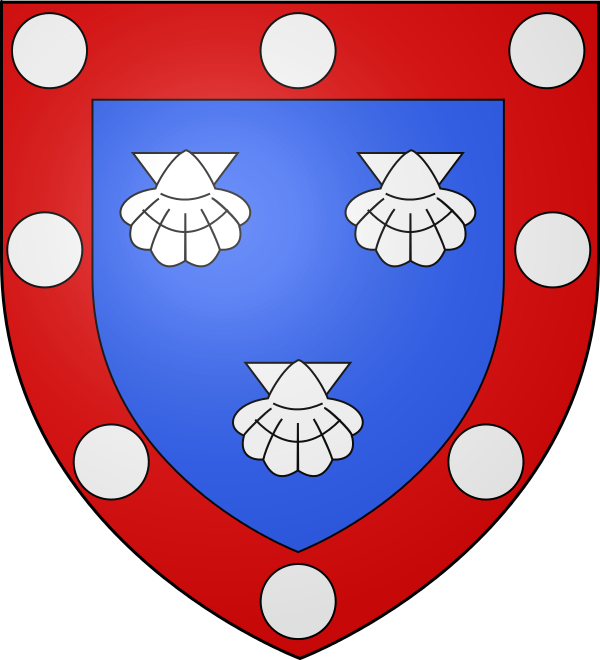
 |
|||
 Février
1702 - Les marins de langrune payèrent un lourd
tribut à la mer. - Du
moyen-âge au milieu du 19e siècle, l'agriculture, l'élevage, la
pêche côtière se partager l’activité des enfants de langrune.
Février
1702 - Les marins de langrune payèrent un lourd
tribut à la mer. - Du
moyen-âge au milieu du 19e siècle, l'agriculture, l'élevage, la
pêche côtière se partager l’activité des enfants de langrune. 
 Pendant
toute la soirée, on m’entretint du malheur de la veille. J'apprends
que le feu a pris d’abord chez une fille qui faisait cuire son dîner
à un feu de paille, dans une maison sans plancher et couverte de
chaume. Le vent qui était violent avait porté de la paille allumée à
intérieur du toit. Le reste n'a pas besoin d’explication.
Pendant
toute la soirée, on m’entretint du malheur de la veille. J'apprends
que le feu a pris d’abord chez une fille qui faisait cuire son dîner
à un feu de paille, dans une maison sans plancher et couverte de
chaume. Le vent qui était violent avait porté de la paille allumée à
intérieur du toit. Le reste n'a pas besoin d’explication.
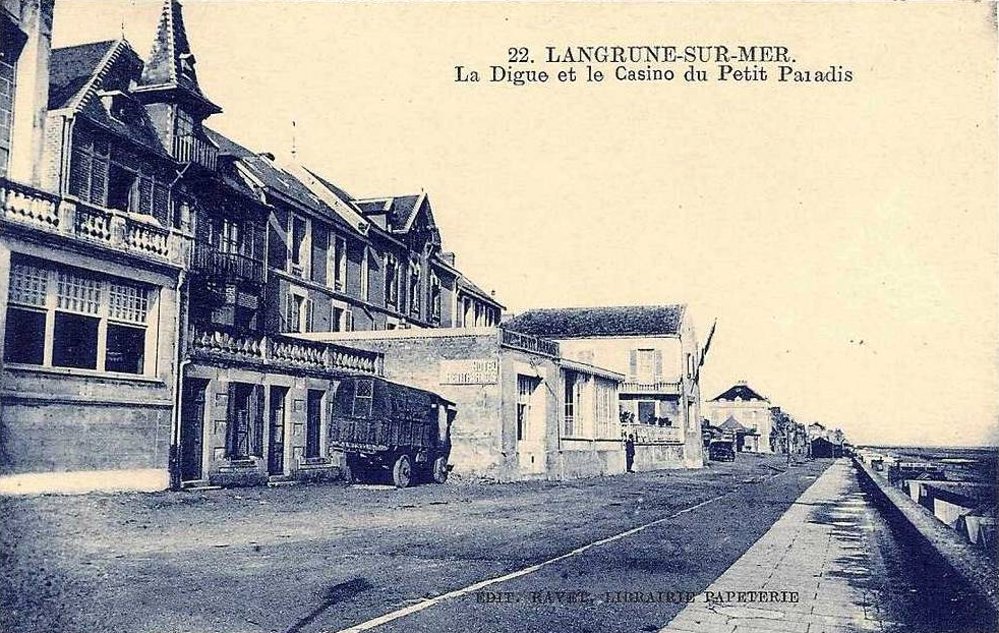 Les
besoins des malheureux vont devenir des plus pressants,
Les
besoins des malheureux vont devenir des plus pressants,
 Leurs
équipages disent à qui veut l'entendre que telle est leur destination,
et ils poussent l'oubli de toutes les convenances à tel point, qu'ils
mettent à terre, et cela sous les yeux d'une population nombreuse qui
les observe, tous leurs filets de pêche, et embarquent à la place des
barils pour contenir, et du sel pour préparer le hareng qu'ils vont
acheter à l'étranger, et qu'ils rapportent comme provenant de leur
pêche.
Leurs
équipages disent à qui veut l'entendre que telle est leur destination,
et ils poussent l'oubli de toutes les convenances à tel point, qu'ils
mettent à terre, et cela sous les yeux d'une population nombreuse qui
les observe, tous leurs filets de pêche, et embarquent à la place des
barils pour contenir, et du sel pour préparer le hareng qu'ils vont
acheter à l'étranger, et qu'ils rapportent comme provenant de leur
pêche.
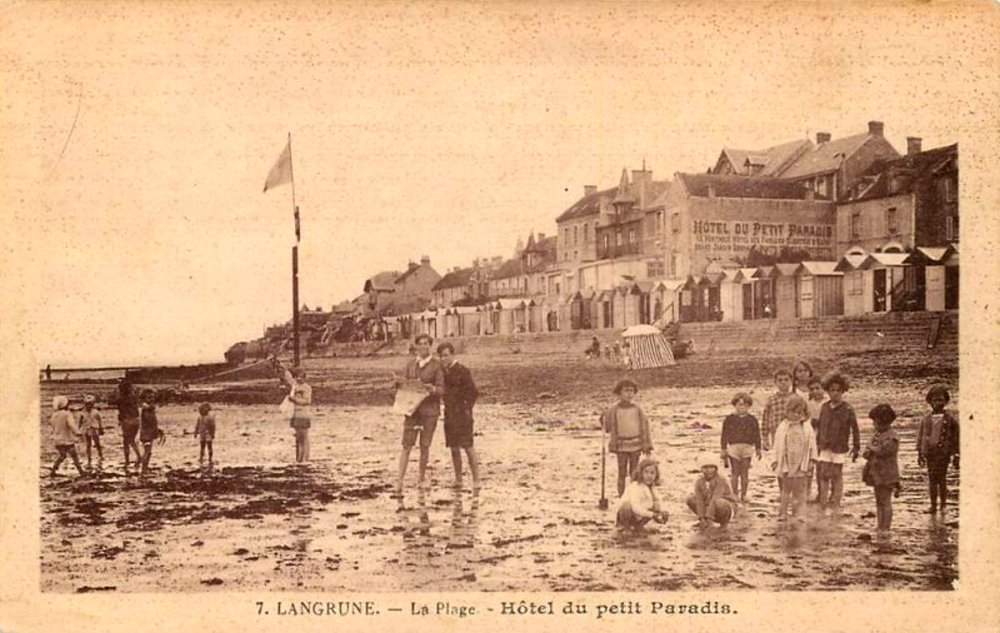 en
mer, soit dans celui de la fosse de Colleville, dans lequel la tenue est
également bonne, soit enfin près de la redoute de Merville, dans la
«
en
mer, soit dans celui de la fosse de Colleville, dans lequel la tenue est
également bonne, soit enfin près de la redoute de Merville, dans la
« 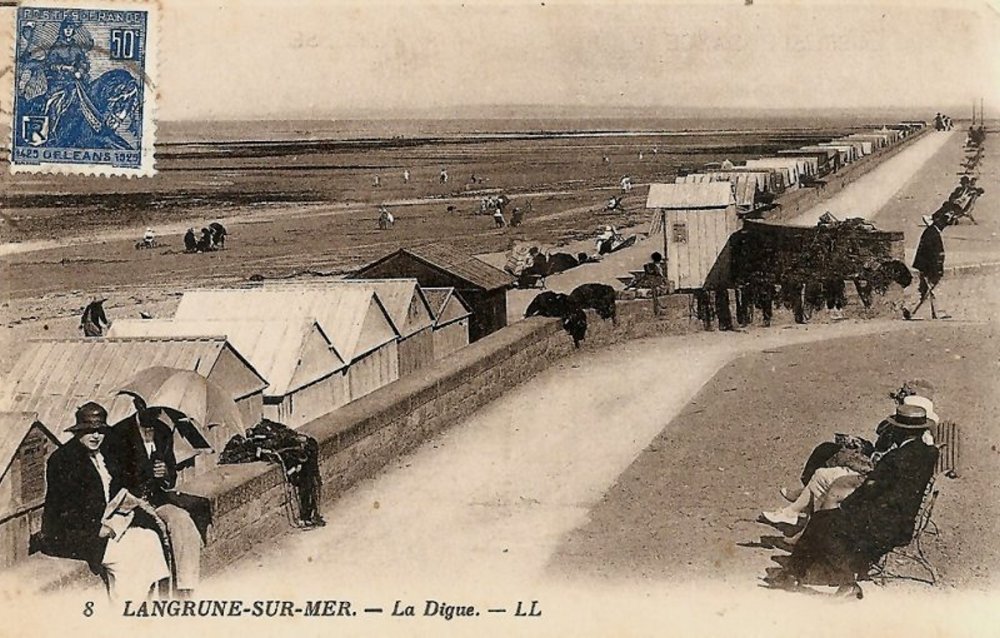
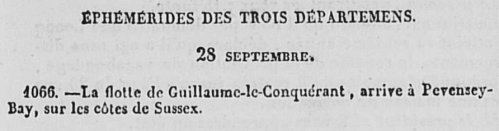 peut-être
sans exemple dans nos annales d'horticulture.
peut-être
sans exemple dans nos annales d'horticulture.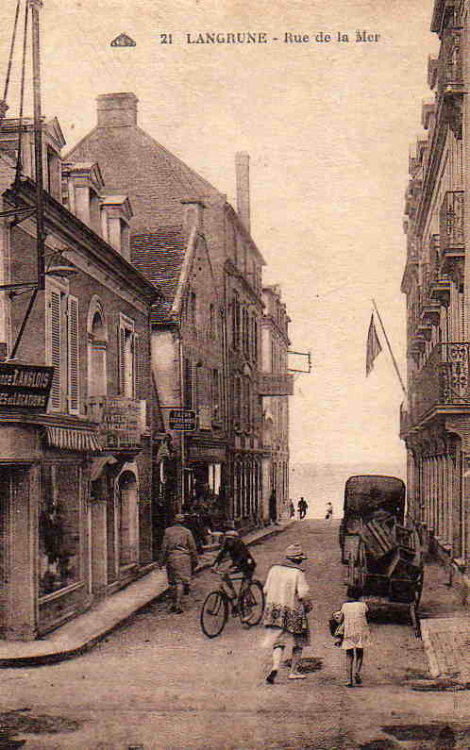
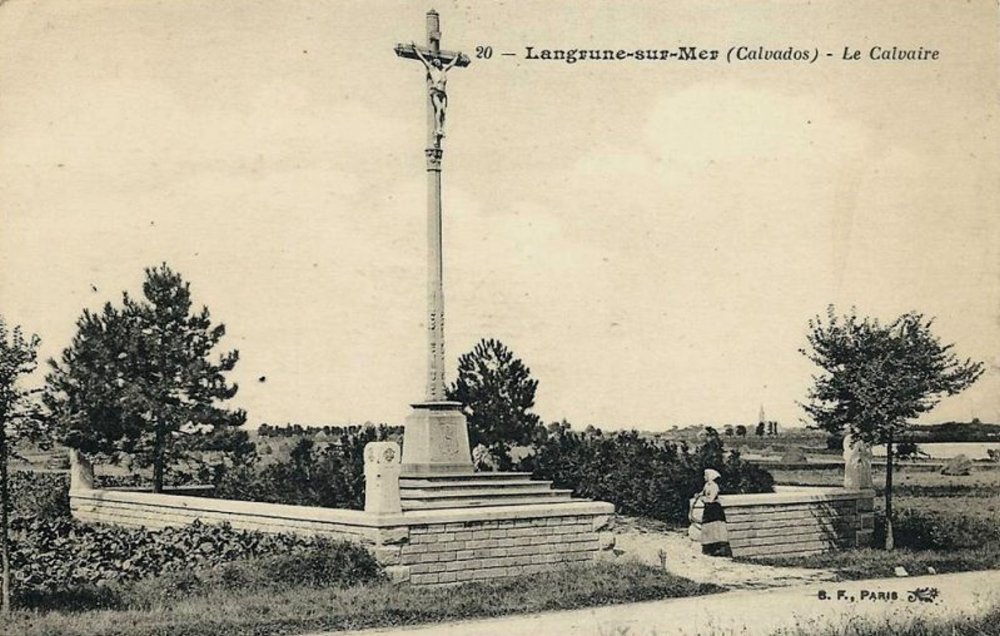
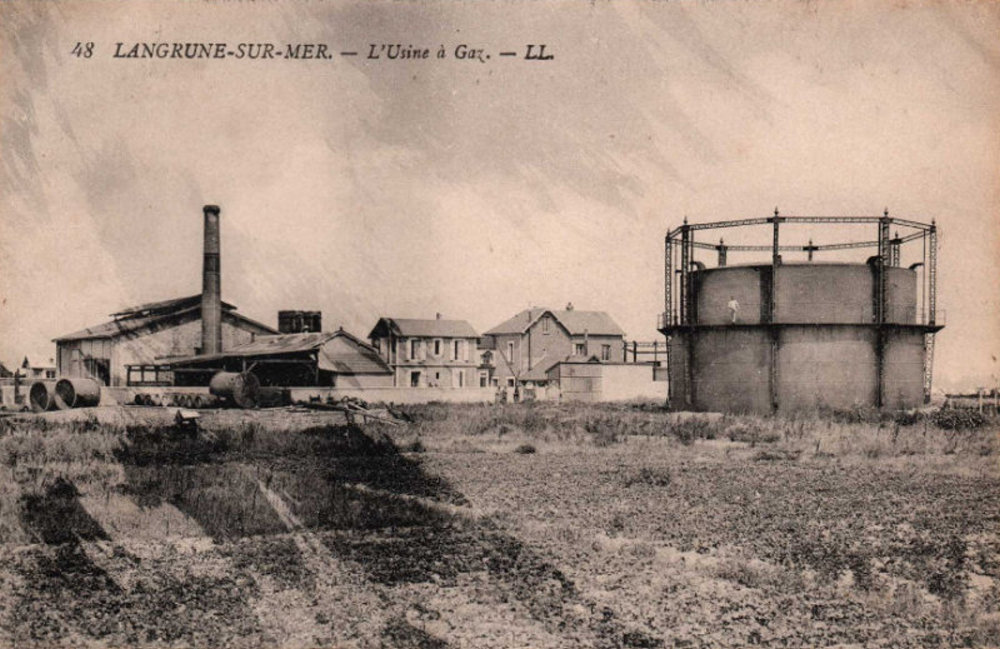 prohibition.
(Source : L’indicateur de Bayeux)
prohibition.
(Source : L’indicateur de Bayeux)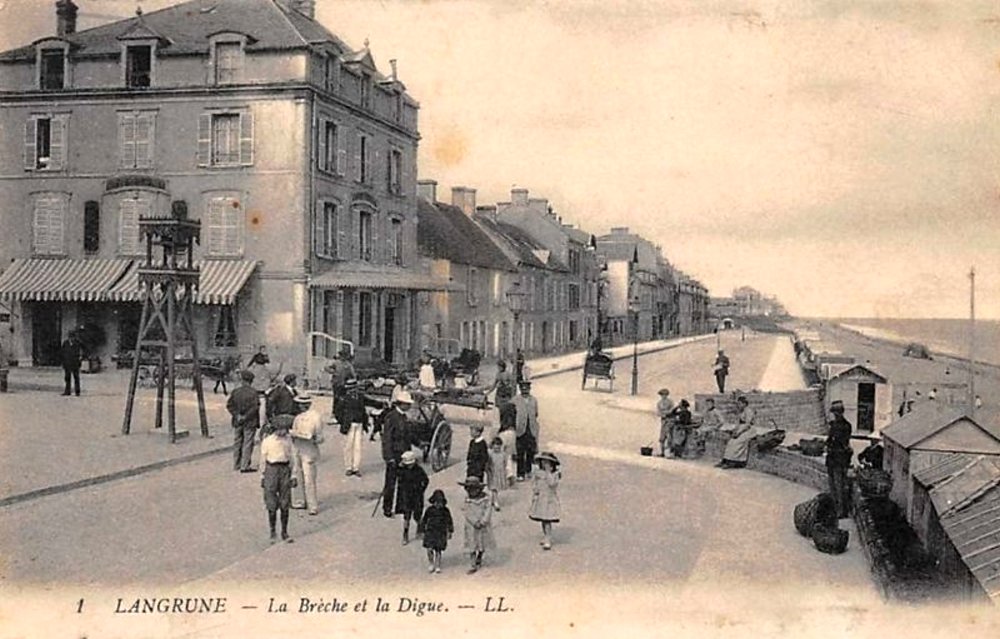


 PEUPLE
FRANÇAIS.
PEUPLE
FRANÇAIS. 
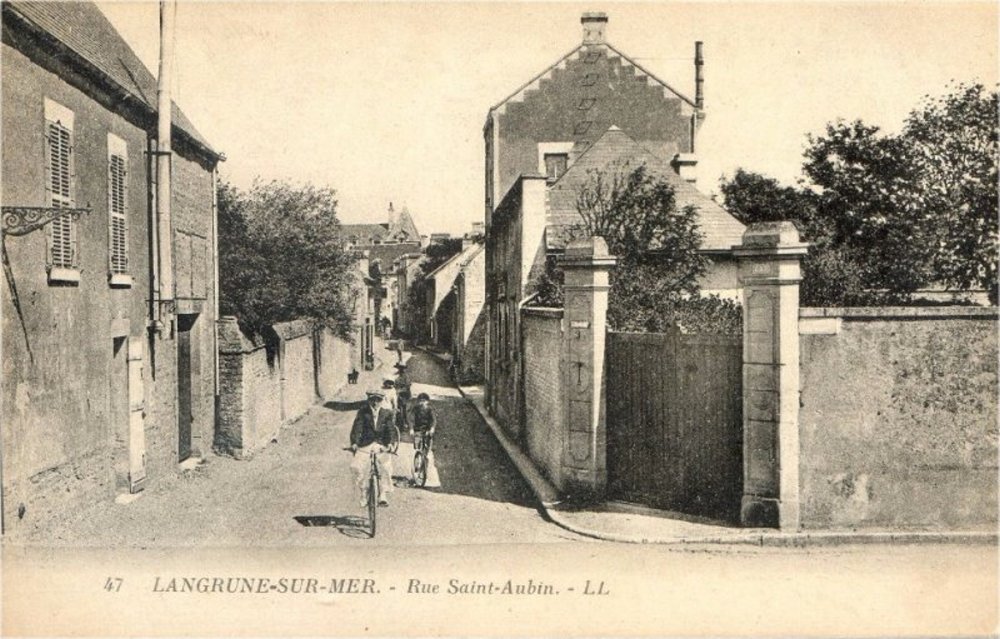
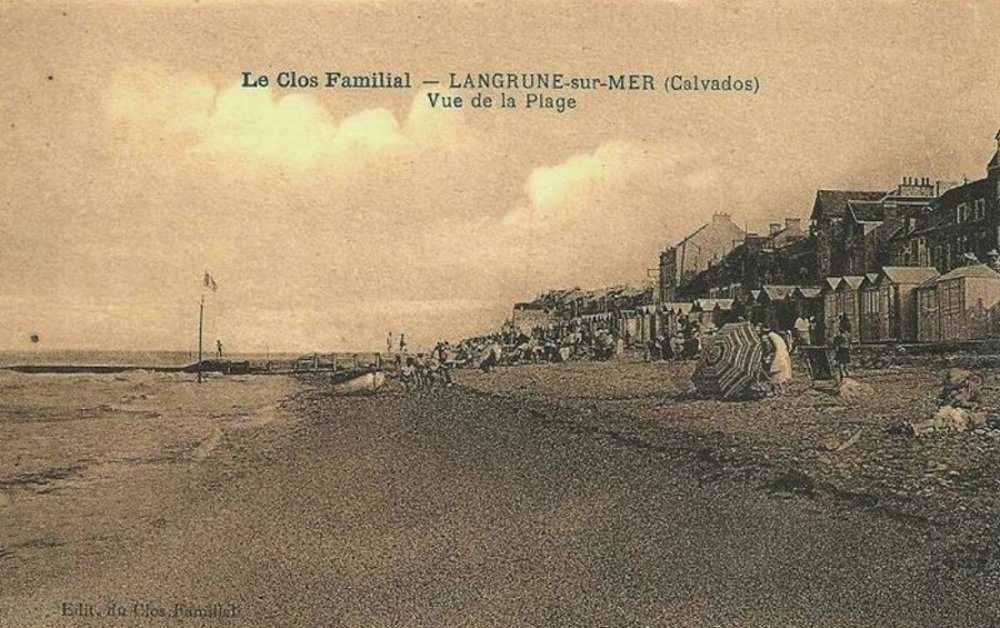


 soleil
sont plus rapprochés de la terre et du plan de l'équateur. La mer ne
monte pas à une égale hauteur dans les différents ports de France ;
chaque port a son unité de hauteur dans la marée, et cette unité est
la quantité dont la mer s'élève ou s'abaisse relativement au niveau
moyen qui aurait lieu sans l'action du soleil et de la lune ; elle est
déduite d'un grand nombre d'observations de hautes et basses mers dans
les régions équatoriales.
soleil
sont plus rapprochés de la terre et du plan de l'équateur. La mer ne
monte pas à une égale hauteur dans les différents ports de France ;
chaque port a son unité de hauteur dans la marée, et cette unité est
la quantité dont la mer s'élève ou s'abaisse relativement au niveau
moyen qui aurait lieu sans l'action du soleil et de la lune ; elle est
déduite d'un grand nombre d'observations de hautes et basses mers dans
les régions équatoriales.
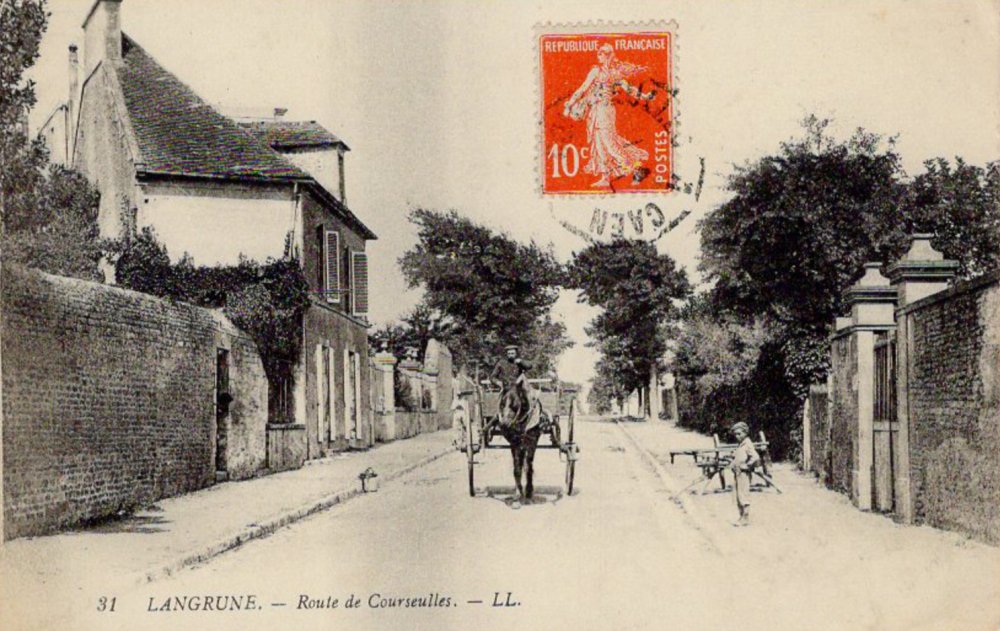
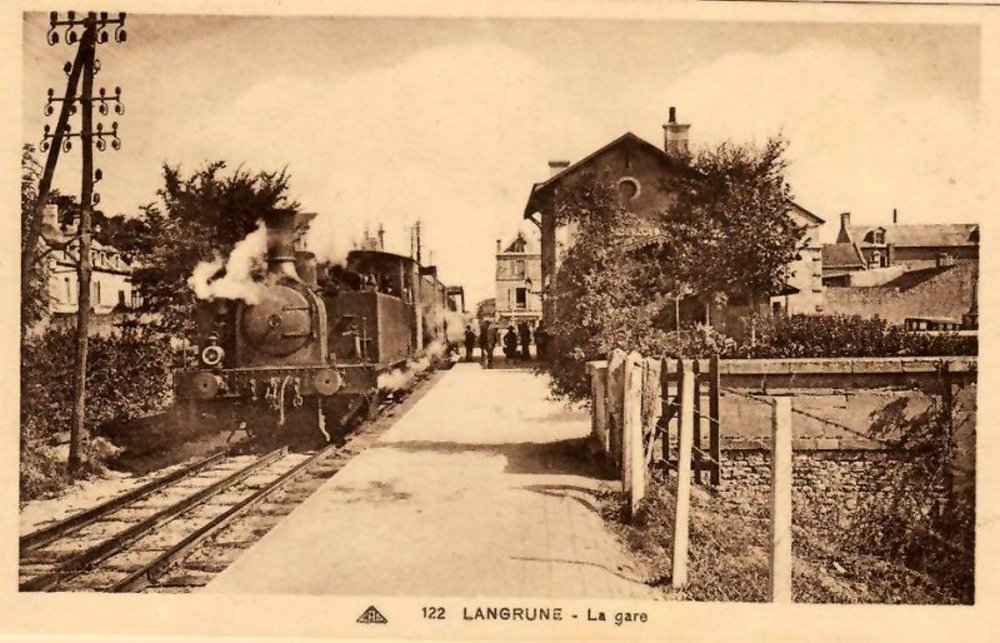

 démontre
péremptoirement que l'exploitation sera plus facile que sur beaucoup de
lignes de premier ordre. Aussi la dépense totale n'excèdera-t-elle pas
quatre millions.
démontre
péremptoirement que l'exploitation sera plus facile que sur beaucoup de
lignes de premier ordre. Aussi la dépense totale n'excèdera-t-elle pas
quatre millions.
 séductions
d'agrément et de confortable.
séductions
d'agrément et de confortable.
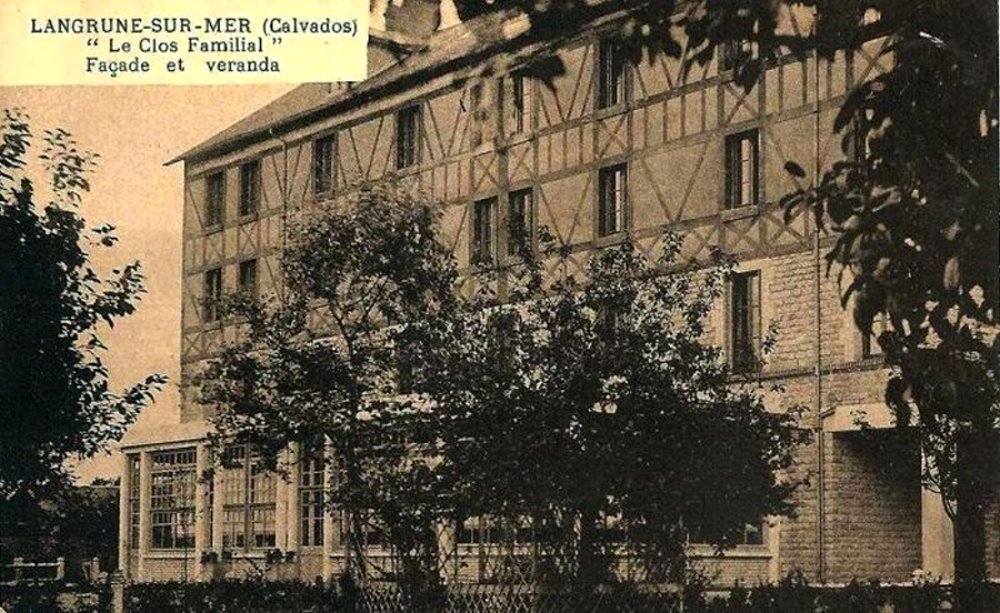 Quand
à MM. Desaunais et Marie, il n'en est rien. M. Desaunais est mort à la
suite d'un accident, que nous avons relaté précédemment, et M. Marie
était atteint de paralysie depuis plus d'une année.
Quand
à MM. Desaunais et Marie, il n'en est rien. M. Desaunais est mort à la
suite d'un accident, que nous avons relaté précédemment, et M. Marie
était atteint de paralysie depuis plus d'une année.
 X
R de l'autre. Parmi ces épaves, on a trouvé un bout-dehors de foc
mesurant 7 mètres 40 de long. Toutes ces épaves semble être à
la mer depuis peu de temps. Ont fait naturellement sur leur
provenances des tristes conjonctures.
X
R de l'autre. Parmi ces épaves, on a trouvé un bout-dehors de foc
mesurant 7 mètres 40 de long. Toutes ces épaves semble être à
la mer depuis peu de temps. Ont fait naturellement sur leur
provenances des tristes conjonctures.
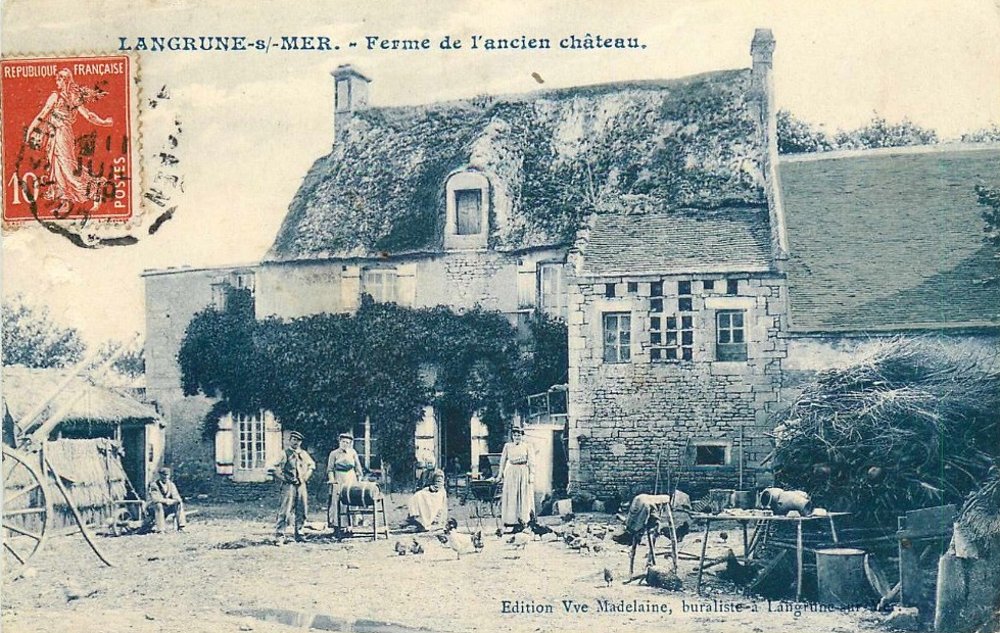 arc-en-ciel
très régulier, que malheureusement le passage de nombreux nuages
obscurcissait à de fréquents intervalles.
arc-en-ciel
très régulier, que malheureusement le passage de nombreux nuages
obscurcissait à de fréquents intervalles. 