|
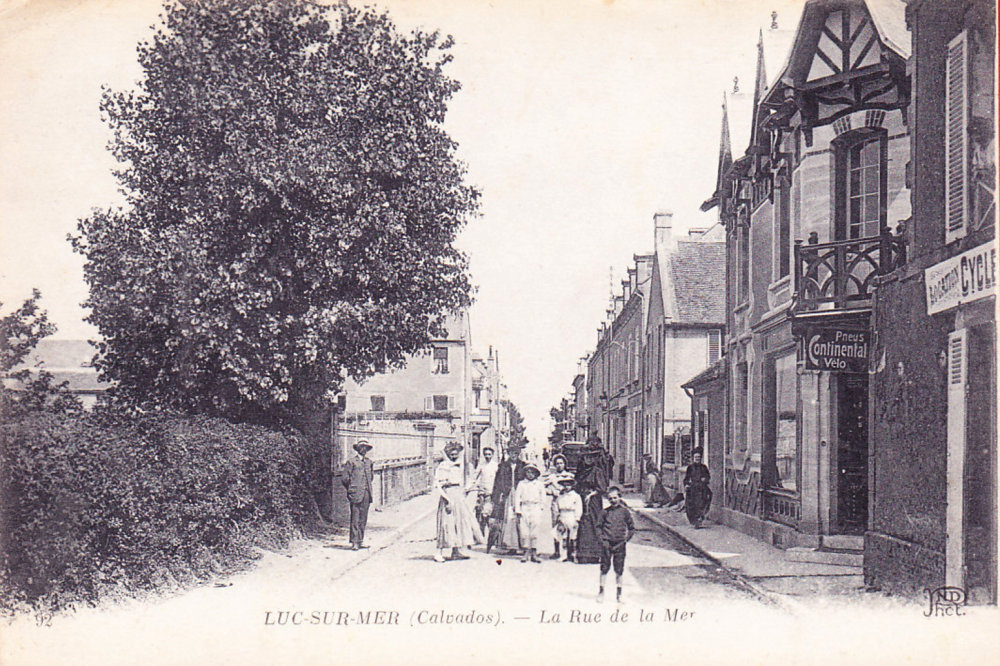 Avril
1828 -
Pêche du hareng. -
Depuis des
siècles la pêche du hareng a été l'objet des spéculations des
marins des côtes du Calvados, elle est une source féconde d'aisance
pour toute la population du pays où l'on s'en occupe, et plus d'un
commerçant notable a trouvé une des causes principales de ses
richesses dans ses armements pour la pêche des harengs, ou dans les
établissements par lui formés pour leur salaison. Avril
1828 -
Pêche du hareng. -
Depuis des
siècles la pêche du hareng a été l'objet des spéculations des
marins des côtes du Calvados, elle est une source féconde d'aisance
pour toute la population du pays où l'on s'en occupe, et plus d'un
commerçant notable a trouvé une des causes principales de ses
richesses dans ses armements pour la pêche des harengs, ou dans les
établissements par lui formés pour leur salaison.
Les
Dieppois, si avantageusement placés sous beaucoup de rapports, ont
été jaloux des succès de nos Bas-Normands, et ils ont saisi toutes
les occasions possibles de leur nuire. Placés à l'entrée de la
Manche, le hareng leur arrivait plutôt qu'à nous, ils pensèrent que
ce serait pour eux un avantage inappréciable de faire fixer l'époque
à laquelle devrait se terminer une pêche qui cependant ne semble pas
pouvoir être l'objet d'un privilège local.
Ils
commençaient ordinairement à pêcher à la fin d'août le hareng, qui
n'arrivait sur les côtes du Calvados que vers la fin de décembre. Les
armateurs de Dieppe crurent avec raison qu'ils forceraient les marins du
Calvados à abandonner ce genre d'industrie, en faisant fixer la fin de
la pêche au premier janvier de chaque année.
Après
avoir présenté leur projet sous toutes les formes possibles, à tous
les gouvernements et dans toutes les circonstances qu'ils crurent
favorables à leurs desseins, ils obtinrent en 1816 à peu près ce
qu'ils demandaient.
Le
14 août, sur le rapport du ministre de l'Intérieur qui ne put
résister aux exigences du ministère des finances et de la direction
des douanes, parut l'ordonnance du Roi qui, dans son art. 2 statua que
la pêche du hareng serait fermée le 15 janvier dans tous les ports du
royaume.
Cette
décision, qui n'admettait aucune distinction, était évidemment basée
sur une erreur de fait, car fixer une seule et même époque pour la
pêche d'un poisson voyageur qui paraît pour les uns quand il
disparaît pour les autres, c'est à peu près comme si l'on eût
ordonné que la récolte des bleds fût faite simultanément dans les
campagnes de Dieppe et dans celles de
Marseille.
Au
surplus, cette ordonnance, dont les principales dispositions furent
puisées dans l'arrêt du conseil du 24 mars 1687, dans l'arrêt du
parlement de Rouen du 23 mai 1765, et dans le décret du 8 octobre 1810,
s'occupa de régler ce qui concerne généralement cette pêche.
Ainsi,
dans son art. 3, elle défend d'acheter du hareng de pêche étrangère
à peine de 500 fr. d'amende et de la confiscation du poisson, des
barques, bateaux et ustensiles de pêche. Par d'autres dispositions,
elle défend aussi de livrer à la salaison les harengs qui auraient
plus de 2 nuits de capture, et indique les conditions auxquelles la
douane doit délivrer en franchise le sel nécessaire, etc…
Le
résultat de la limitation de la pêche fut de faire cesser tout à coup
cette branche de commerce sur les côtes du Calvados. Beaucoup de
spéculateurs furent ruinés, des établissements importants créés à
grands frais à Trouville, Touques et Dives, furent fermés pour ne plus
se rouvrir, seulement quelques armateurs de Honfleur et de Luc
essayèrent de lutter contre les entraves que l'on mettait à leur
industrie.
Des
réclamations s'élevèrent de toutes parts, le ministère de la marine,
qui depuis longtemps avait recueilli sur cette question importante des
documents qui promettaient un tout autre résultat, se plaignit de
n'avoir point été consulté. M. Lacoudrais, alors commissaire au
quartier d'Honfleur, et que son mérite si distingué sous tous les
rapports, a appelé à remplir auprès du ministre de la marine des
fonctions éminentes, s'occupa avec activité de cette affaire, et
rédigea à ce sujet plusieurs mémoires forts de faits et de
raisonnement que les Dieppois combattirent en vain.
Le
Conseil général du Calvados, le Préfet, les membres de la
députation. et particulièrement feu M. Brochet de Vérigny, l'un
d'eux, réunirent leurs efforts et firent enfin triompher la vérité et
la justice. Le 4 janvier 1822 parut l'ordonnance du Roi qui abrogea la
disposition limitative de l'ordonnance du 14 août 1816, et proclama la
liberté absolue de la pêche du hareng.
 Alors
de nouvelles spéculations commerciales prirent naissance sur les côtes
du Calvados, et l'on vit renaître les établissements de salaisons de
Luc. Alors
de nouvelles spéculations commerciales prirent naissance sur les côtes
du Calvados, et l'on vit renaître les établissements de salaisons de
Luc.
Mais
par une fatalité nouvelle, ce poisson que l'on prenait autrefois le
long des côtes de France, semble avoir fui nos parages, depuis quelques
années il n'entre plus dans la Manche et se trouve vis-à-vis le nord
de l'Angleterre dans le voisinage d'Yarmouth et des bancs appelés
Doggers bancks et Galloper.
Cette
circonstance a forcé nos navires à aller chercher le hareng, qu'ils
eussent attendu en vain, au surplus les Diéppois et les Boulonnais leur
avaient montré l'exemple, et il est vrai de dire que leur pêche et la
nôtre s'exécutent en tout de la même manière.
Mais
il a fallu chez eux et chez nous faire des armements plus
considérables, et substituer aux petites barques dont on se servait
pour pêcher à la vue des côtes, de grands bateaux du port de 40 à
100 tonneaux, et montés par 20 ou 30 hommes, cette extension a
nécessairement fixé beaucoup de spéculateurs qui ont dirigé leur
industrie vers cette branche de commerce , et on a vu s'accroître
rapidement les établissements de Luc et de Langrune.
Ces
succès ont facilement réveillé la jalousie des Diéppois et de leurs
voisins auxquels tout ce que nous disons ici s'applique aussi. Ils ont
renouvelé leurs réclamations et ont suggéré à la douane que les
harengs de nos pêcheurs provenaient de pêche
étrangère
et que nos saleurs ne devaient plus dès lors profiter de la franchise
du sel qui est délivré par la douane, seulement pour les salaisons du
poisson Français, si nous pouvons nous exprimer ainsi. On conçoit que
la douane adopta vivement cette idée qui lui promettait de fréquentes
saisies, et des confiscations progressives.
L'ordonnance
de 1816 avait déjà prévu l'achat de poisson à l'étranger et avait
créé des syndics pour le maintien des conditions auxquelles la
franchise du sel était concédée.
Une
nouvelle ordonnance du 27 septembre 1826, et une autre toute récente du
3 janvier 1828, ont déterminé les fonctions respectives des syndics et
des douaniers, qui ensemble ou séparément usent de tous les moyens
possibles pour vérifier à l'arrivée des bateaux l'origine du poisson.
Mais
il faut le dire, la manière dont les douaniers se conduisent à Dieppe
est bien différente des procédés dont ils usent à Luc. A Dieppe, les
pêcheurs, les nôtres même qui souvent vont y vendre leur poisson,
sont toujours bien reçus, à Luc, au contraire, aucuns ne débarquent
qu'après des visites serpuleuses, et ne jouissent de la liberté
qu'après avoir subi de longs et sévères interrogatoires, formalité
que l'ordonnance de 1826 n'autorise cependant que dans les cas douteux.
Cette
année plusieurs bateaux ont été saisis à Luc. Leurs patrons ont
été traduits devant les tribunaux.
Le
15 mars dernier, le tribunal de police correctionnelle de Caen avait
renvoyé de l'action 4 de ces navires prévenus d'avoir introduit en
France des harengs de pêche étrangère. La douane avait fondé sa
saisie sur les prétendues contradictions qu'elle disait exister dans
les interrogatoires des équipages. Le tribunal reconnut que les
capitaines représentaient à la justice le document légal qui devait
éloigner l'idée de la fraude, c'est-à-dire, le certificat des syndics
constatant l'origine du poisson, et que d'ailleurs il n'existait aucune
preuve de l'achat de ce poisson à des pêcheurs étrangers.
Dans
ces entrefaites le gouvernement, voulant connaître la vérité sur ces
prétendus achats à l'étranger, a demandé des renseignements précis.
Le ministère de l'Intérieur et celui de la Marine se sont adressés à
leurs agents locaux, des enquêtes ont eu lieu, on a consulté des
fonctionnaires publics qui pouvaient avoir des connaissances exactes,
les documents recueillis de toutes parts ont à l'unanimité repoussé
des inculpations qui ne reposaient que sur des suppositions suggérées
par des rivalités et par l'intérêt personnel.
La
douane seule a persisté dans son système, et elle a si bien fait que
l'appel des quatre jugements du 15 mars a été porté.
Mais
par quatre arrêts rendus jeudi dernier par la Cour royale de Caen,
Chambre des appels de police correctionnelle, la décision des premiers
juges a été confirmée.
 Les
bateaux saisis étaient : Les
bateaux saisis étaient :
Le
« « Saint-Jean-Baptiste »,
capitaine Constant Aubey.
Le
« Généreux »
, capitaine François Mériel.
Le
« Saint-Louis »,
capitaine Pierre Aubey.
La
« Victoire »,
capitaine Pierre-Louis Meriel. (Le Journal de Caen et de la Normandie)
Septembre
1829 -
Un accident. -
Plusieurs accidents sont encore
arrivés depuis peu à Caen et dans les environs. La semaine dernière,
à Luc, un enfant a été écrasé par une voiture, et à cette occasion
nous ne pouvons nous empêcher de nous récrier contre la cruelle
insouciance avec laquelle les parents abandonnent les enfants au milieu
des chemins les plus passagers, chaque jour on en rencontre jouant dans
les ornières et ne faisant aucune attention aux avertissements et aux
cris des conducteurs de voitures, le plus souvent ce ne serait pas ces
derniers qu'on devrait rendre responsables d'évènements qu'ils n'ont
pu prévoir et éviter, la loi ne devrait-elle pas plutôt punir les
parents qui, chargés de veiller à la conservation de leur enfants, se
rendent coupables d'une négligence inconcevable en les voyant d'un œil
indifférent s'exposer ainsi au danger, et cherchent quelquefois même
après à spéculer sur les accidents dont ces enfants ont été
victimes. (Le Journal de Caen et de la Normandie)
Mars
1830 -
Épave mystérieuse sur la côte de Luc et Lion.
- Depuis
quelque temps plusieurs débris de bâtiment ont été jetés sur la
côte de Luc et de Lion. Un canot ayant 20 pieds de quille et 4 pieds et
demi de baux, et un mât de goélette, ayant 22 pieds de long et
provenant d'un navire d'environ 90 tonneaux, ont été recueillis par la
douane de cette côte. (Le Pilote du Calvados)
Août
1830 -
Un incendie. -
La semaine
dernière, un incendie a eu lieu dans la commune de Luc, et a dévoré 2
maisons, celle des sieurs Lemarchand et Letellier.
L'incendie
a eu lieu par des copeaux placés auprès de la cheminée du sieur
Letellier, et auxquels le feu s'est communiqué pendant que sa femme
était sortie pour quelques instants. (Le Pilote du Calvados)
Juin
1831 -
Les deux drapeaux de la chapelle de la Délivrande, cause de
guerre. - La
chapelle de la Délivrande, si renommée dans notre pays par ses
miracles, est située sur le territoire de Luc, aux confins de celui de
Douvres.
Par
sa position comme qui dirait je suis sur la limite de deux états, elle
a failli être en petit ce que sera bientôt en grand le Luxembourg, une
cause de guerre entre les peuples limitrophes, sur le point de savoir
lequel des deux planterait son drapeau sur le faîte sacré.
Reprenons
les choses de plus loin, et racontons comment une diplomatie officieuse
a su dans un congrès prévenir par ses protocoles d'imminentes
hostilités.
Plusieurs
fois déjà le maire de Luc avait remplacé sur la chapelle le drapeau
tricolore que le vent, le diable ou quelqu'autre puissance mystérieuse,
malfaisante et anti-tricolore, déchirait sans cesse, malgré la
solidité de l'étoffe dont il était fait. Témoins des efforts
inutiles de Luc pour maintenir son drapeau sur le nid de nos ci-devant
missionnaires, les Douvrois en firent dernièrement fabriquer un sur
lequel l'ouragan même serait sans empire, car confectionné en tôle ce
serait bien le diable s'il ne résistait pas. Le drapeau métallique fut
placé sur la chapelle.
A
cet aspect grande rumeur a Luc, qui voit dans ce fait un acte
attentatoire à ses droits et à sa propriété. Le maire de cette
commune substitue bientôt son drapeau à celui des Douvrois, qui  s’entêtant
pour ne pas perdre le bénéfice de leur bonne intention, attachent de
nouveau leur étendard au pignon de la chapelle et en scellent fortement
dans la muraille la lance dont la longueur le place au dessus de celui
des Lucois. Nouveaux murmures de la part de ceux-ci, furieux qu'un
drapeau rival, vint par sa hauteur humilier le leur. Enfin les têtes se
montent et déjà on s'apprête d'un côté à renverser et de l'autre
à défendre le drapeau douvrois (1). s’entêtant
pour ne pas perdre le bénéfice de leur bonne intention, attachent de
nouveau leur étendard au pignon de la chapelle et en scellent fortement
dans la muraille la lance dont la longueur le place au dessus de celui
des Lucois. Nouveaux murmures de la part de ceux-ci, furieux qu'un
drapeau rival, vint par sa hauteur humilier le leur. Enfin les têtes se
montent et déjà on s'apprête d'un côté à renverser et de l'autre
à défendre le drapeau douvrois (1).
Fort
heureusement des diplomates neutres sont intervenus pour régler les
affaires, un plan qui plaçait la chapelle sur le juste milieu de la
ligne séparative des deux états avait réveillé les anciennes
prétentions et les pensées jalouses des Douvrois, mais un plan exact,
copié sur celui du cadastre, a été soumis au congrès, et le premier
protocole a rejeté la prétention. Restait le grand point à juger :
Douvres voulait que son drapeau fût maintenu, et offrait d'inscrire son
nom dessus, conjointement avec celui de Luc ; Luc rejetait ce mezzo
termine
comme
une concession contraire a son droit exclusif sur la chapelle.
L'intention des Douvrois mieux appréciée ( elle était surtout de voir
un drapeau sur la chapelle qui n'en voulait pas souffrir ) a servi de
base au protocole définitif, et il a été convenu que les deux
drapeaux resteraient sur le toit, pourvu que celui de Douvres ne
dépassât pas celui de Luc.
La
paix a été signée à ces conditions, et maintenant les deux drapeaux
flottent fraternellement sur la chapelle, d'où la main invisible qui
lui a attiré ce double déboire, ne cherchera pas sans doute à les
abattre, de peur que le lendemain on n'y en plaçât un plus grand
nombre.
(1)
Les choses en étaient venues au point qu'un pauvre diable de
perruquier, dont la boutique est sise sur Luc, à deux pas de la
chapelle, allait perdre toutes ses pratiques. Les Lucois ayant trop loin
pour venir se faire raser chez leur concitoyen de la frontière, r t les
Druvrais ne voulant pas qu'on put dire, dans l'état ou en étaient les
affaires, qu'un habitant de Luc. leur faisait la barbe .(Le
Pilote du Calvados)
 Juin
1831
-
Service d’une voiture publique de Caen à Luc.
-
A dater du
dimanche 12 juin 1831, le sieur Quesnel, entrepreneur de voitures
publiques, fera partir tous les jours de Caen pour Luc, à 7 heures du
matin, et de Luc pour Caen, à 7 heures du soir, une voiture à 4 roues,
montée sur ressorts et très commode. Juin
1831
-
Service d’une voiture publique de Caen à Luc.
-
A dater du
dimanche 12 juin 1831, le sieur Quesnel, entrepreneur de voitures
publiques, fera partir tous les jours de Caen pour Luc, à 7 heures du
matin, et de Luc pour Caen, à 7 heures du soir, une voiture à 4 roues,
montée sur ressorts et très commode.
L'exactitude
que le sieur Quesnel a apportée dans le service les années
précédentes, lui fait espérer que les personnes qui ont bien voulu
l'honorer de leur confiance daigneront la lui continuer.
Le
prix des places est fixé à 1 fr. tout payé.
Les
bureaux sont toujours établis à Caen, chez M. Jeanne, cafetier au
Marché au Bois ; à la Délivrande, chez M. Deliot, cafetier, et à
Luc, hôtel du Grand Orient.
A
dater de la même époque, il fera partir tous les jours une voiture
pour Courseulles à 7 heures du matin, et de Courseulles pour Caen à 5
heures et demie du soir.
Les
bureaux sont, à Caen, chez M. Jeanne ; à la
Délivrande, chez M. Deliot, et à Courseulles, hôtel des Étrangers.
Le
prix est fixé à 1 fr. 4o c. par place, tout payé. . (Le Pilote du
Calvados)
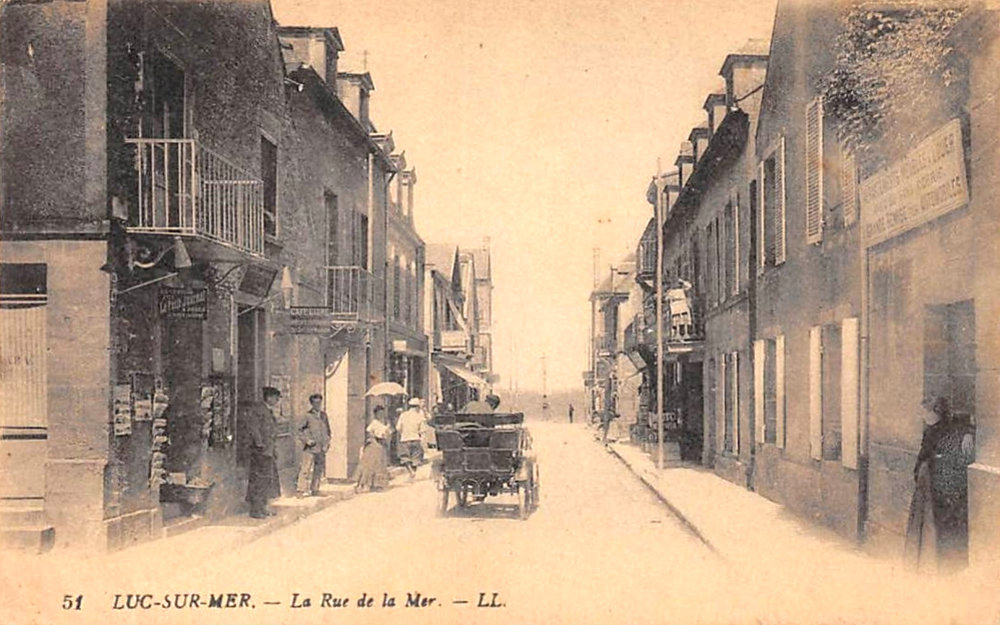 Novembre
1831 -
On lit dans l' Écho de la Seine-Inférieure.
- Un
négociant de Dieppe, membre de la commission sanitaire, nous écrit ce
qui suit : Novembre
1831 -
On lit dans l' Écho de la Seine-Inférieure.
- Un
négociant de Dieppe, membre de la commission sanitaire, nous écrit ce
qui suit :
Au
moment où la salubrité publique excite avec tant de raison la
sollicitude générale pour nous défendre contre l'invasion du choléra
asiatique qui nous menace de toutes parts, nous croyons devoir signaler
à la France entière un fait patent dont la gravité peut amener les
conséquences les plus désastreuses.
Suivant
leur habitude de tous les ans, les bateaux pêcheurs du quartier de Caen
arment ouvertement dans notre port, et avec une scandaleuse audace, pour
aller acheter du hareng au Helder, au Texel, et sur les rivages de la
Hollande, quoique ce pays soit placé par nos lois sanitaires sous le
régime de la patente suspecte.
Leurs
équipages disent à qui veut l'entendre que telle est leur destination,
et ils poussent l'oubli de toutes les convenances à tel point, qu'ils
mettent à terre, et cela sous les yeux d'une population nombreuse qui
les observe, tous leurs filets de pêche, et embarquent à la place des
barils pour contenir, et du sel pour préparer le hareng qu'ils vont
acheter à l'étranger, et qu'ils rapportent comme provenant de leur
pêche.
Leur
retour devant s'effectuer à Luc, Langrune et autres criques du
Calvados, où de tout temps leur commerce frauduleux et immoral a été
toléré, ils espèrent échapper cette année comme par le passé, à
la surveillance de l'administration des douanes de leur pays, qu'a tort
ou à raison l'opinion publique accuse depuis longtemps, sinon de
connivence, au moins d'une incurie ou d'une complaisance aussi
répréhensibles jusqu'à présent qu'elles peuvent devenir coupables
dans les circonstances actuelles.
Dans
une pareille occurrence, que va faire l'administration du département
du Calvados pour dissiper la crainte que nous éprouvons tous de voir
s'introduire par cette voie le funeste fléau, contre lequel tant de
prescriptions sont si rigoureusement recommandées, nous l'ignorons.
Nous savons cependant que la commission sanitaire de Dieppe a informé
le ministre du commerce et des travaux publics de la tentative insensée
que la cupidité de ces pêcheurs leur a suggérée, et nous en
attendons des mesures préventives. (Le Pilote du Calvados)
Décembre
1831 -
On nous adresse du littoral la note suivante.
- Nous
respectons trop la sagesse des mesures adoptées par l'intendance
sanitaire, dans l'intérêt du pays entier, pour ne pas nous être
assurés avant de publier cette réclamation qu'elle est de nature a
être prise en considération, sans porter atteinte aux précautions
qu'exige la salubrité publique. Nous la soumettons aux méditations de
MM. les membres de l'intendance, convaincus qu'il feront tout ce qui
dépendra d'eux pour concilier les intérêts de notre population
maritime avec les mesures que le pays a le droit d'attendre contre
l'invasion du choléra. Quelque soit d'ailleurs la décision qui sera
prise, par l'intendance, comment les pétitions qui doivent lui être
adressées dans le même sens que la note ci-après, nous inviterons
ceux même dont les intérêts pourraient se trouver momentanément
compromis à s'y soumettre, l'intérêt général devant dominer les
intérêts particuliers et en commander même quelquefois le sacrifice.
-
La commission sanitaire de Caen a arrêté, le 14 de ce mois, que
tout bateau pêcheur qui resterait à la mer plus de 24 heures, ne
serait plus admis à la libre pratique, Cette décision, quoique très
sage pour prévenir l'introduction du choléra, peut être modifiée
sans qu'il en résulte aucune absence de sécurité pour le pays.
Vingt-deux
bateaux de Luc et de Langrune sont partis à la pêche du hareng, plus
de 500 hommes forment l'équipage de ces bateaux. La plus grande partie
de la population de ces deux communes, qui s'élève à 4 000 habitants,
subsiste de l'industrie de la pêche, il serait même facile d'établir
que cette branche précieuse du commerce se rattache à des intérêts
bien plus étendus que ceux de la localité.
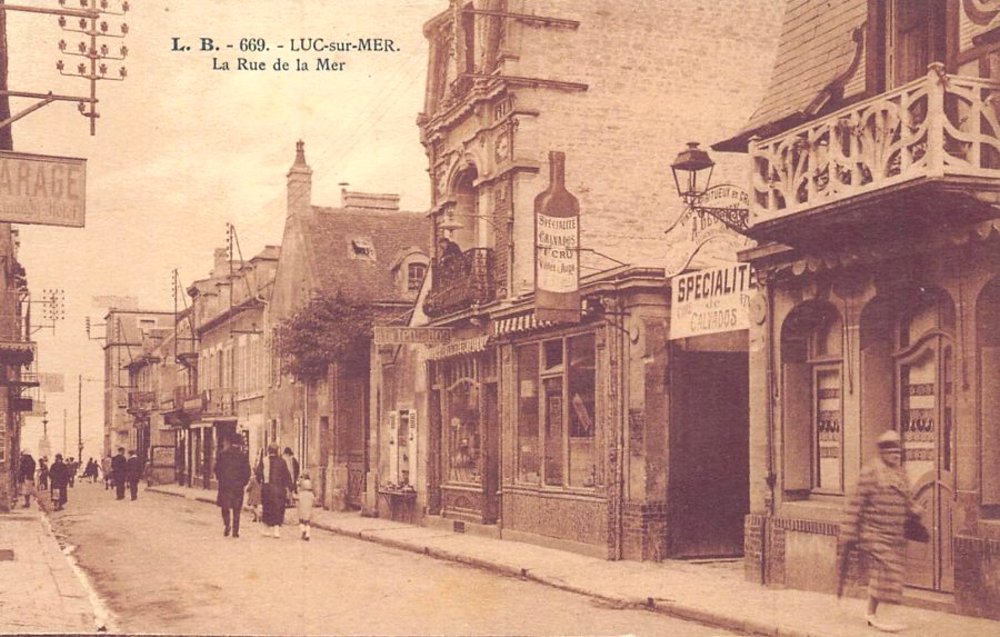 En
maintenant les dispositions de cet arrêté, qui enjoignent aux bateaux
pêcheurs d'aller purger leur quarantaine à l'île Tatihou, c'est
occasionner le plus grand préjudice à toute la population qui vit de
la pêche et à tous ceux qui y sont intéressés. En
maintenant les dispositions de cet arrêté, qui enjoignent aux bateaux
pêcheurs d'aller purger leur quarantaine à l'île Tatihou, c'est
occasionner le plus grand préjudice à toute la population qui vit de
la pêche et à tous ceux qui y sont intéressés.
1º.
Dans beaucoup de cas, le manque de sel, et le retard qui résultera de
la nécessité de poursuivre le voyage jusque sous la côte de la
Hougue, entraîneront la perte du poisson.
2º.
Le temps nécessaire pour se rendre au lieu de la quarantaine et les
délais du retour feront perdre aux pêcheurs des moments précieux,
puisqu'il faut qu'ils reviennent toujours à la côte de Caen pour
débarquer leur poisson, changer leurs filets et se ravitailler avant de
reprendre la mer.
3º.
Les réparations à faire aux bateaux pour les mettre en état de
continuer leur pèche. réparations qui ont lieu habituellement au
moment même de l'arrivée, ne pourront se faire qu'après qu'ils auront
purgé la quarantaine. On conçoit donc quel préjudice notable tous ces
retards et ces obstacles font naître au détriment du commerce, sans
utilité réelle pour les garanties de salubrité qui les occasionnent.
Ces
faits posés, que peut-on faire pour rendre le sort des pêcheurs moins
fâcheux, sans rien enlever aux précautions sanitaires qu'il est
nécessaire de prendre ? Il n'y aurait aucun inconvénient à permettre
aux bateaux de la côte de faire leur quarantaine soit au mouillage de
l'île de la porte ( Kiho) qui est vis-à-vis Luc et Langrune, à
une demi lieue en mer, soit dans celui de la fosse de Colleville, dans
lequel la tenue est également bonne, soit enfin près de la redoute de
Merville, dans la « Passée-au-Drôle »,
où de tout temps les navire, venant de la Méditerranée ont fait
quarantaine. Nous espérons que la justice de cette réclamation sera
appréciée par l'intendance, qu'elle aura égard à la position de
l'industrieuse population maritime, en reconnaissant que les endroits
ci-dessus indiqués peuvent remplacer les lieux désignés pour la
quarantaine, sans offrir moins de sécurité, puisque le plus parfait
isolement pourra avoir lieu au moyen de la surveillance du cordon
sanitaire établi sur le littoral. (Le Pilote du Calvados)
Décembre
1831 -
Mesures de prévention et d'atténuation du choléra.
- Le
conseil de salubrité publique vient de rendre publics les moyens qui
lui paraissent les plus propres à se préserver des atteintes du
choléra, et a en atténuer les effets, si malgré toutes les
précautions et les moyens hygiéniques employés, il venait à se
manifester dans nos contrées. Nous croyons utile d'emprunter au Journal
du Havre la note suivante :
1°. La propreté est de la plus grande importance, soit dans les
vêtements, soit dans l'intérieur des maisons, il faut écarter des
habitations les ordures, les fumiers, enfin tout ce qui produit des
émanations fétides. Il est reconnu que ces exhalaisons ajoutent à la
gravité des maladies en général, et accroissent notamment
l'intensité du choléra.
2º. Étendre et faire sécher dans les appartements, des linges
imprégnés d'eau chlorurée, selon les proportions qui seront
indiquées.
3°. Dans un local vaste et élevé, les fumigations à la
Guyton-Morveau sont d'une application plus prompte et plus étendue.
Elle doivent donc être préférées dans ces cas, vu la modicité de
leur prix.
4º. Se laver souvent les mains dans une solution légère de
chlorure, y tremper même les mouchoirs que l'on porte avec soi. Il est
bon de mettre sous les lits une assiette remplie de quelques onces de
chlorure solide de chaux, avec suffisante quantité d'eau. En ajoutant
un peu de vinaigre, et en remuant ce mélange, on accélérera le
dégagement du gaze désinfectant.
5º. Avoir recours à des frictions sèches ou chaudes, à des
bains de vapeurs, à des bains chauds d'eau douce et de préférence
d'eau de mer.
6º. Porter sur la peau une large ceinture de flanelle, éviter le
refroidissement des pieds.
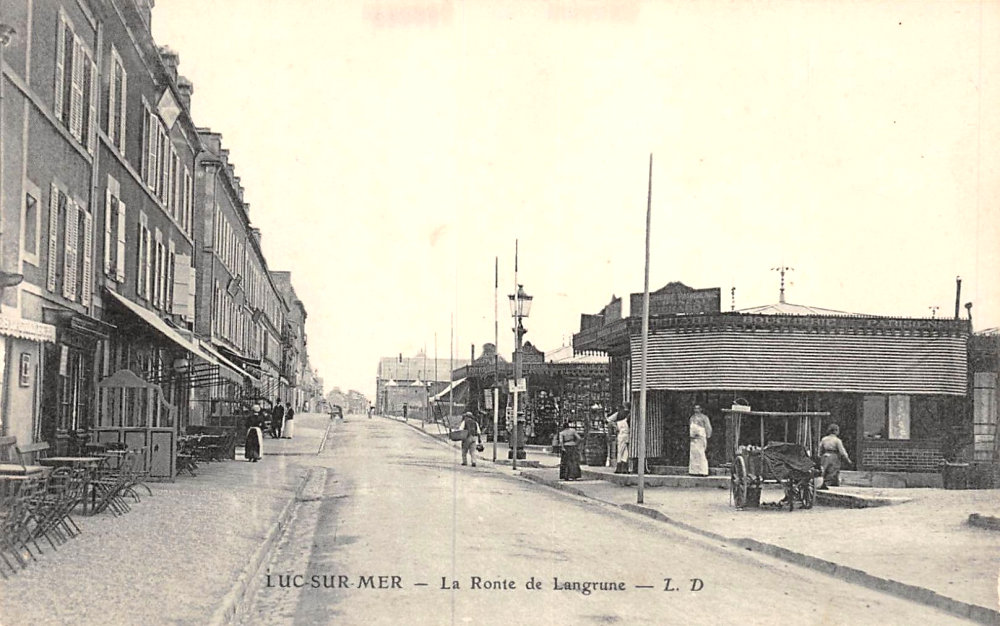 7º.
Éviter les réunions nombreuses, surtout dans un local resserré et
peut aéré. 7º.
Éviter les réunions nombreuses, surtout dans un local resserré et
peut aéré.
8º. Ne faire aucun changement à un genre de vie sain et
régulier, continuer un exercice modéré.
9°. Autant que possible la nourriture doit être presque toute
animale, il faut user des légumes frais en petite quantité, éviter
les viandes fumées, les salaisons, la pâtisserie et les fruits mal
mûrs.
L'abus
des liqueurs spiritueuses devient très préjudiciable dans les temps
d'épidémie, ainsi que les excès de tout genre.
10º. Enfin se mettre en garde contre ces spécifiques vantés par
quelques journaux, ou colportés dans les campagnes. (Le Pilote du
Calvados)
Janvier
1833 -
La pêche du hareng. -
La crainte
d'être retenus prisonniers par le Gouvernement hollandais avait
empêché la plupart des marins de notre côte de se livrer à la pêche
et au commerce du hareng sur la côte de Hollande.
Un
seul propriétaire de navire, de la commune de Luc, a fait une
expédition, et son bâtiment revenu hier d'un second voyage avec
un chargement complet va décider, sans doute, les autres marins, qui
font actuellement leurs préparatifs de départ. (Mémorial
du Calvados)
Avril
1833 -
Tentative de suicide à Luc-sur-Mer.
- Le
16 de ce mois, un homme âgé de cinquante cinq ans a tenté de se noyer
dans la mer en face de la commune de Luc. Il s'était attaché au cou
une pierre pesant vingt livres et avait essayé de se couper les veines
des bras au moyen d'un rasoir.
Le
garde champêtre, averti qu'un marin nommé Pesnel l'avait retiré de
l'eau, est parvenu, non sans peine, à le conduire à l'hôtel de la
gendarmerie de la Délivrande.
Il
a déclaré se nommer Gallé (Charles Joseph) et venir de Falaise où il
exerce la profession de tailleur.
Le
brigadier voyant que ce malheureux, qui paraît atteint d'aliénation
mentale, persistait dans la résolution d'attenter à ses jours, l'a
fait conduire à Caen, où il a été visoirement déposé dans la
maison d'arrêt.
(Mémorial du Calvados)
Juin
1834 -
Un Sauvetage. -
Dans la
soirée du 24 mai dernier, le bateau-pêcheur la « Magdeleine »,
commande par maître Leboucher (Jean-Baptiste), ayant sous ses ordres 25
hommes d'équipage, s'est perdu sur les rochers qui bordent au nord la
rade du port de Luc, à un quart de lieu du rivage.
Chassée
sur ses ancres par la force du vent et la violence de la mer montante,
la « Magdeleine » ne conservait aucune chance de
salut, et les hommes qui la montaient s'attendaient à une mort
imminente. Ils reprirent une lueur d'espérance, lorsqu'ils aperçurent
à la côte quelques-uns de leurs compatriotes qui s'efforçaient de
mettre une chaloupe à la mer pour aller à leurs secours. Ils y réussirent,
mais ce ne fut qu'après une lutte d'une heure environ qu'ils purent
gagner le bateau, où ils étaient attendus dans les angoisses de la
mort.
La
« Magdeleine » se brisait déjà de toutes parts,
mais la prudence du maître de l'équipage et l'intrépide dévouement
des marins du port furent couronnés d'un succès complet, les 25 hommes
furent sauvés successivement, et le bateau ne tarda pas à disparaître.
Il était alors six heures du soir. L'armateur est M. Letellier
(Alexandre), négociant à Luc.
Nous
devons signaler à la reconnaissance publique les quatre généreux
marins auxquels l'équipage de la « Magdeleine » doit
son salut. Ils se nomment Jean-Baptiste-Numa Leroux, officier distingué
de la marine marchande ; il était de l'expédition d'Alger, et c'est
lui qui engagea par son exemple ses compagnons dans la belle conduite
qu'ils ont montrée le 24 mai. Les autres 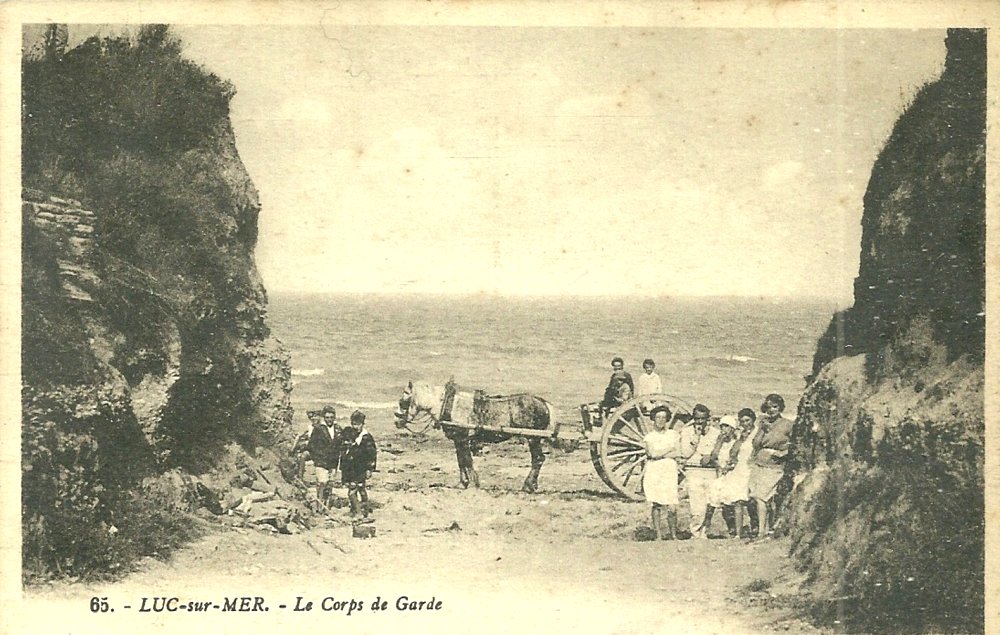 sont
Pierre Hamelin, François Leboucher et Pierre-Louis Lemarchand. (Mémorial
du Calvados) sont
Pierre Hamelin, François Leboucher et Pierre-Louis Lemarchand. (Mémorial
du Calvados)
Novembre
1840 -
Nouvelles Locales. -
La violence de la mer a été si grande qu'une
petite baleine, de celles connues sous le nom de souffleur, est venue
s'échouer hier sur notre côte, on face de Luc. Ce cétacé a plus de
neuf mètres de longueur.
(Source : L’indicateur de Bayeux)
Août
1842 - Nouvelles locales.
- Le
mot varech ou wrack, dans notre pays, ne désigne pas et n'a jamais
désigné une plante unique de
la famille des algues : il signifie une plante, une herbe quelconque que
la mer jette sur ses bords, et jadis, par extension, tous les débris
qui échouaient sur les côtes. — Il était synonyme d'épave.— De
là les expressions tomber en wrack, jeter en wrack, encore fort
usitées aujourd'hui.
C'est
à tort que M. Pilet a dit que le varech avait autre fois sa
législation, mais que les lois qui régissent la matière sont tombées
en désuétude. Trois ou quatre condamnations ont frappé, cette année
même, en 1842, dans l'arrondissement de Caen, des individus qui y
avaient contrevenu.
Le
droit de recueillir le varech appartient au premier occupant, le droit
de récolter les algues qui croissent sur les roches et que sans doute,
par analogie, on appelle aussi varech, appartient généralement aux
communes sur le territoire desquelles il a poussé.
Au
moyen-âge il constituait un droit féodal. Nous voyons, en effet, par
une charte du XIIe siècle,
conservée aux archives de la préfecture du Calvados, que Richard-Cœur-de-Lion
donne aux moines de St-Etienne de Caen le port de Dives, avec un
chantier pour la construction des navires auquel il ajouta le droit de
wrack. L'abbesse de Sainte-Trinité de Caen jouissait aussi de ce droit
dans diverses paroisses du Cotentin, notamment dans celles de Saint-Vast,
de Quettehou et de Morsalines. Beaucoup d'autres seigneurs possédaient
de semblables privilèges, mais il est probable que les uns et les
autres de ces privilèges étaient plus ou moins restreints et que les
cultivateurs riverains en étaient quittes pour abandonner aux suzerains
les épaves proprement dites.
En
tout cas, si ces dîmes existèrent jamais, on ne les payait plus, bien
avant le XVIIe siècle,
car la Coutume de Normandie n'appelle droit de varech que le droit de
s'emparer des choses jetées par la mer à terre.
L'ordonnance
de la marine de 1681 organisa par son titre X du livre 4e, la
coupe du varech dans les paroisses situées sur les côtes.
Les
habitants des paroisses devaient s'assembler le premier dimanche du mois
de janvier de chaque année, pour régler les jours auxquels devait
commencer et finir la coupe des herbes marines croissant en mer à
l'endroit de leur territoire.
Les
habitants des communes d'Hermanville, Lion et ses hameaux, Luc,
Langrune et ses hameaux, Bernières, Courseulles, Arromanches, Tracy,
Manvieux , Fontenailles, Longues, Marigny, Commes et ses hameaux,
Port-en-Bessin, Huppain, Villers, Ste-Honorine-des-Pertes, Colleville et
St-Laurent, pourront faire ladite coupe pendant trente jours, qui seront
choisis entre le troisième jour avant la pleine lune de mars, et
le troisième jour après la pleine lune d'avril. Ceux des communes de
Vierville, St-Pierre-du-Mont, Englesqueville et Grandcamp, pourront
faire la coupe des dites herbes, pendant trente jours. à compter du 1er
du 15 mars jusqu'au 15 avril suivant. (source : L’Indicateur de
Bayeux)
 Février
1843 -
Nouvelles locales. - On
avait annoncé un hiver rigoureux pour l'année 1842-43, déjà le
solstice d'hiver est passé, l'année 1843 s'ouvre, le soleil commence
à remonter sur l'horizon, et la température est restée jusqu'ici fort
douce et fort égale, on a compté, en décembre, des journées
comparables à celles de mars et d'avril. Février
1843 -
Nouvelles locales. - On
avait annoncé un hiver rigoureux pour l'année 1842-43, déjà le
solstice d'hiver est passé, l'année 1843 s'ouvre, le soleil commence
à remonter sur l'horizon, et la température est restée jusqu'ici fort
douce et fort égale, on a compté, en décembre, des journées
comparables à celles de mars et d'avril.
Les
cultivateurs en sont arrivés au point de désirer quelques gelées pour
empêcher que les plantes semées ne s'avancent trop.
En
Suisse, on récolte déjà des fraises dans les bonnes expositions, et
de toutes parts on signale des phénomènes de précocité surprenants. (source :
L’Indicateur de Bayeux)
Février
1843 -
Nouvelles Locale. - La
semaine dernière la neige est tombée pendant trois jours sur notre
contrée avec une abondance inaccoutumée, surtout à l'époque avancée
de la saison où nous nous trouvons. Un tapis blanc, d'une épaisseur
très considérable en certains endroits, a couvert les champs, les
routes, les rues , les toits des maisons.
L'arrivée
des voitures publiques a été retardée, les malles-poste de Paris et
de Cherbourg ont subi dans les heures de passage en notre ville, six à
huit de retard : vendredi, celle de Granville à Bayeux a été
retardée de 24 heures, il paraît que le parcours de la forêt de
Neuilly était devenu impraticable.
Au
reste, le dégel dure depuis plusieurs jours, la température s'est
sensiblement adoucie et les circulations se rétablissent sur tous les
points. Nous n'avons pas appris qu'il soit arrivé dans notre, contrée,
par suite de ce mauvais temps, d'accidents graves. (source : L’Indicateur
de Bayeux)
Février
1843 -
Nouvelles Locale. - Les
plus grandes marées qui en 1843, pourront occasionner des sinistres si
elles sont favorisées par les vents, seront celles du 16 février, 18
mars, 16 avril, 27 août , 26 septembre et 25 octobre.
Celles
du 25 septembre et du 18 mars, atteindront, sur toute notre côte,
presque le maximum. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Août
1843 -
Nouvelles locales. -
On nous communique un remède aussi sûr que prompt contre la
brûlure. Nous croyons utile de le faire connaître à nos lecteurs.
On
prend une pincée de pousses de jeunes buis que l'on pile avec trois
blancs de poireaux, et on y ajoute une cuillerée d'huile d'olive. On
renferme ensuite le tout dans un linge bien blanc et on l'applique sur
la partie brûlée.
Plusieurs
personnes qui ont fait l'essai de ce remède, en ont obtenu les plus
prompts et les plus heureux résultats. (source : L’Indicateur de
Bayeux)
Octobre
1843 -
Nouvelles locales. -
Nous lisons dans le
« Pilote », les lignes suivantes sur un genre d'abus qui
n'est que trop fréquent dans notre pays et contre lequel nous ne
cessons nous même de réclamer :
«
Il ne se passe guères de semaine sans que les personnes qui parcourent
à cheval ou en cabriolet la route de Caen à Luc ne soient victimes du
mauvais vouloir et de la brutalité des rouliers dont ils font
rencontre. La plupart de ces tyrans de grands chemins appartiennent à
la population de notre littoral, il est d'autant plus surprenant qu'ils
s'acharnent à vexer les voyageurs qui se rendent à la mer, que
l'intérêt bien entendu de leurs familles leur fait une obligation,
plus étroite de se montrer polis vis-à-vis des personnes habituées à
payer à beaux deniers  comptant
les quelques heures de distraction qu'elles viennent passer sur leurs
grèves. comptant
les quelques heures de distraction qu'elles viennent passer sur leurs
grèves.
Un
honorable habitant de notre ville a encore été, ces jours derniers,
renversé dans un fossé, avec son cabriolet et son cheval, par la
méchanceté purement gratuite d'un de ces charretiers qui, loin de lui
céder passage, s'est plu au contraire à le lui intercepter, en barrant
la route avec son équipage. C'est là le cas de regretter que les
cantonniers ne soient point investis du droit de verbaliser contre les
auteurs d'actes aussi blâmables, mais en attendant qu'il en soit ainsi,
ce qui doit vraisemblablement arriver tôt ou tard, il est urgent de
solliciter l'autorité compétente de mettre fin à un si déplorable
état de choses par tous les moyens coercitifs dont il lui est possible
de disposer. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Octobre
1843
- Nouvelles locales. -
En Basse-Normandie, l'existence de phénomènes de la nature, que
depuis le commencement de l'automne ils se sont multipliés autour de
nous. Beaucoup d'arbres d'espèces diverses se sont parés d'un second
feuillage, et dans plusieurs communes du Pays-d'Auge, voire même sur la
route de Caen à Lisieux, on remarque en ce moment certains pommiers
tout couverts de fleurs parmi d'autres qui menacent de se rompre sous le
poids des fruits maintenant à peu près murs dont, par extraordinaire,
ils sont surchargés cette année jusqu'à l'extrémité des branches
les plus frêles et les plus délicates en apparence. (source : L’Indicateur
de Bayeux)
Mai
1844 -
Nouvelles maritimes. -
Voici, d'après
des renseignements authentiques, quelle est l'étendue des sinistres
maritimes arrivés sur notre littoral depuis le commencement de la
tempête de ces jours derniers :
Le
brick la « Providence », capitaine Bouchon, venant de
Libourne, avec un chargement de vin et eau-de-vie, à destination du
Havre et de Caen, a été jeté à la côte, le 17, à neuf heures
du soir, à l'entrée de la rivière d'Orne. L'équipage a été sauvé.
Le
houry la « Prudence », venant de Bordeaux, avec un
chargement de vin et d'eau-de-vie, à destination de Rouen, a été
également jeté à la côte près de Deauville.
La
goélette norvégienne « Annette-Dorothée » , capitaine
Holer, venant de Mandal, chargée de bois, est aussi échouée sous
Cabourg, à peu de distance de la rivière de Trouville. On ignore si
les équipages de ces deux navires ont été sauvés.
Le
sloop anglais « Actif », capitaine Morgon, venant de
Swansea, avec un chargement de cuivre, à destination de Rouen, a fait
côte à Saint-Aubin-de-Langrune. L'équipage a été sauvé, on espère
renflouer le navire après déchargement.
Deux
houris, la « Victoire » et le « Jeune-Conquérant »,
ont été également jetés sur la côte près de Luc-sur-Mer.
Le
navire la « Jeune-Adèle », capitaine Laborde, allant
d'Abbeville à bordeaux, sur lest, a relâché à Courseulles. Ce navire
a éprouvé quelques avaries. Le capitaine Laborde a rapporté qu'il a
trouvé en mer, entre deux eaux et toute désemparée, une goélette
norvégienne , la « Caroline-Mathilde », capitaine Bioness,
venant de Moss avec un chargement de planches à destination de Caen, et
à la consignation de Mme veuve Verel.
Ce
navire est venu à la côte sous Asnelles, on a trouvé dans le roufle
un chat et un chien encore vivants, il y a malheureusement lieu de
penser que le capitaine qui a dû s'embarquer dans son canot avec son
équipage composé de 7 hommes, aura péri en même temps que lui en
voulant se rendre à terre.
Ce
qui tendrait à accréditer cette opinion, c'est qu'on a retrouvé
depuis l'échouement du navire qui est totalement brisé, les débris
d'un canot épars sur la côte ainsi qu'une grande quantité de  planches. planches.
Depuis
ce sinistre, il est entré à Courseulles une autre goélette
norvégienne, à destination aussi du port de Moss, qui a touché en
entrant et qui a fait de graves avaries. Elle est battue à chaque
marée par la violence des lames qui viennent du large et qui déferlent
sur elle avec une grande impétuosité.
Toute
la côte, depuis Courseulles jusqu'à Lion-sur-Mer, est couverte de
planches et de débris. (source :
L’Indicateur de Bayeux)
Juillet
1844 -
Nouvelles locales. -
La saison des bains de mer amène cette année comme
les précédentes sur notre littoral, outre les habitants de Caen et de
divers points de notre département, un grand nombre d'étrangers de
distinction, Luc et Lion surtout, ne cessent d'être fréquentés par
les baigneurs de tous les pays.
Parmi
les notabilités françaises qui doivent y venir passer une partie de la
belle saison, on cite particulièrement M. Arago, député et membre de
l'Académie des Sciences, pour toute la famille duquel des appartements
sont déjà retenus à Luc chez M. Jacquot, propriétaire de l'hôtel de
la Belle-Plage. M. Arago y est attendu immédiatement après la clôture
de la session parlementaire. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Juin
1846 -
Nouvelles locales. - On
annonce à Caen, la mort de M. Jacquot, maître de l'hôtel Belle-Plage,
à Luc, qui s'est brûlé la cervelle la semaine dernière.
(source : L’Indicateur de Bayeux)
Juillet
1851 -
Un incendie. - Voici
quelques détails sur l'incendie qui a éclaté, le 12 juillet, en la
commune de Luc.
L'incendie
s'est d'abord déclaré chez le sieur Roger, maréchal-forgeron. Le feu
a dû prendre au faîte de la maison communiquant avec la cheminée de
la forge. Il a ensuite envahi un grenier, où se trouvait un amas
considérable de chauffe de colza.
Cette
maison, couverte en chaume, est au centre d'un grand nombre d'autres
maisons également recouvertes en paille.
C'est
vers 7 heures et demie du matin qu'un voisin vit fumer la couverture et
donna l'éveil. Le vent d'ouest, qui soufflait avec violence, porta
bientôt de nombreuses flammèches sur la maison voisine, qui en était
cependant séparée par un chemin de près de trois mètres. La
couverture prit feu aussitôt. Tout le monde était dans la
consternation. Trente maisons au moins étaient sous le vent, menacées
d'être envahies, sans compter l'autre côté de la rue, qu'une
étincelle pouvait embraser.
Le
maire prit la prompte et sage résolution de faire découvrir
immédiatement la troisième maison. Le vent ne tarda pas non plus à se
calmer. C'est à cette double circonstance, au dévouement et à
l'activité des pompiers de Luc, qu'est due la conservation de tant de
maisons.
Une
heure après cette grande alerte, on était maître du feu.
Deux
maisons sont brûlées et une a perdu sa toiture. Une des maisons
incendiées était assurée, l'autre ne l'était pas.
Tout
le monde a fait son devoir, les pompiers de Luc, les habitants de la
commune et ceux des communes voisines.
Les
pompes de la Délivrande et de Bernières sont venues au secours du Luc,
avec le plus louable et le plus généreux empressement, mais on était
déjà maître du feu, lorsqu'elles sont arrivées. (source : L’Indicateur
de  Bayeux) Bayeux)
Juillet
1851 -
Nouvelles locales. -
La
récolte du colza est terminée, celle des blés va bientôt commencer.
Un grand nombre de propriétaires et de fermiers ont l'habitude
d'élever des meules de paille dans l'intérieur des cours de ferme, et
même le long des bâtiments d'exploitation et d'habitation. Cette
habitude présente des dangers d'incendie, sur lesquels nous appelons
toute l'attention des autorités locales. C'est leur droit et leur
devoir de veiller à ce que les meules de paille ou les tas de
bourrées, élevées à ciel ouvert, soient éloignées des bâtiments,
surtout de ceux dont la couverture
est en chaume. Aux termes d'un arrêté préfectoral, la distance ne
pourra être moindre de 50 mètres. Les arrêtés que les maires
pourront prendre à ce sujet devront être soumis à l'approbation de M.
le préfet. (source : L’Indicateur de Bayeux)
Décembre
1852 -
Nécrologie. -
Un honorable
négociant de la ville de Caen, dont la longue carrière a été
entourée de l'estime générale, M. Duval Vautier, maire de Luc, vient
de mourir dans cette commune à l'age de 84 ans.
(source : L’Indicateur de Bayeux)
Mars
1853 -
Nouvelles divers. - Au
nombre des personnes qui se sont signalées par leur dévouement, et qui
ont mérité des médailles d'honneur, nous trouvons les noms suivants,
qui appartiennent au Calvados : MM. Vidieu (Pierre-Joseph), employé à
la préfecture du Calvados ; Quentin fils, domicilié à Caen, et
Leboucher (Jean-François), maître au cabotage à Luc, ont reçu, les
deux premiers, une médaille d'honneur de 2e classe ; le
troisième, une médaille de 1re classe, pour avoir, le 12
août 1852, tous trois contribué, dans des conditions différentes, à
sauver le fils Leprestre, qui se noyait en se baignant à Luc. Leboucher
a assuré le sauvetage et empêché Vidieu d'être victime de son
dévouement,
M.
Bidot (Romain-François), charpentier de marine, a reçu une médaille
de 1re classe, pour avoir accompli de nombreux actes de
dévouement en diverses circonstances, notamment en sauvant deux enfants
en danger, de se noyer, les 16 mai 1847 et 3 février 1851.
MM.
Busnel (Charles-Hippolyte), cultivateur, et Deschamps (Eugène),
menuisier, ont reçu une médaille de 2e classe, pour avoir,
en novembre 1852, à Pont-Farcy, fait preuve de courage et d'abnégation
lors de l'inondation de novembre dernier, en secourant des personnes en
danger. (Source : L’Indicateur de Bayeux)
Février
1854 - Cour d'Assises du Calvados.
-
Présidence de M. le conseiller Courtoise.
- Audience du 8
février.
—
Trois ans de prison ont été infligés à Philippe
( Nicolas-François-Désiré ) âgé de 30 ans, menuisier, né à
Troarn, demeurant à Douvres, déclaré coupable d’avoir vers la fin
de 1853 commis deux vols d'argent en l'Église de Luc, dans un tronc
pour les pauvres et dans un autre tronc pour l'entretien de la chapelle.
(source Le Journal de Honfleur)
Août
1856 - On lit dans le Pilote du Calvados du 21 courant.
-
Le bruit courait, avant-Lier soir à Caen, que la veille, une
violente tempête ayant tout à coup éclaté sur notre littoral, avait
jeté à la côte plusieurs navires qui s'étaient perdus corps et
biens.
Cette
sinistre nouvelle, exagérant énormément l’étendue du mal, avait
néanmoins pour base un fait trop exact, un irréparable malheur. En
effet, dans la journée du 18, par un temps affreux, le sloop « Désirée-Marie-Alexandrine »,
capitaine Simon, et ayant trois hommes d’équipage, est allé se
briser devant Luc. Le capitaine a été emporté par un coup de mer, le
petit mousse, qui naviguait pour la première fois, dit-on, a été
noyé dans la cabine, le matelot seul a été sauvé par les sieurs
Buhour, pêcheurs à Luc, qui allaient lever leur filet.
Après
avoir arraché ce malheureux à une mort certaine, ils l’ont gardé à
bord pendant toute la durée de la pêche et l’ont ensuite ramené et
déposé à terre.
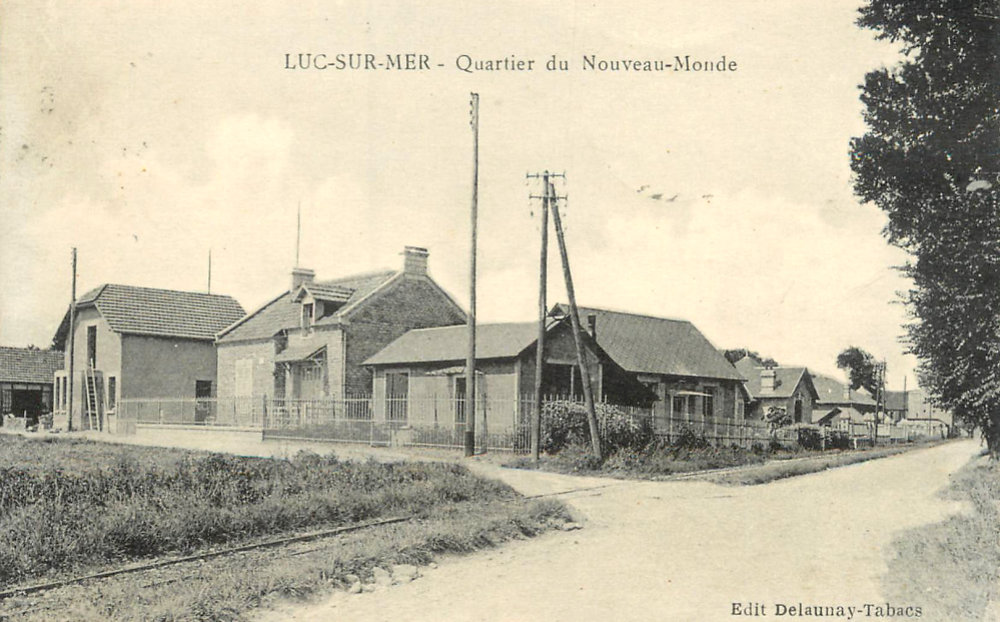 Les
premiers soins lui ont été prodigués par les employés de la douane
et il a été transporté ensuite chez M. Félix Marie, où il a reçu
tous les secours que nécessitait sa position. Les
premiers soins lui ont été prodigués par les employés de la douane
et il a été transporté ensuite chez M. Félix Marie, où il a reçu
tous les secours que nécessitait sa position.
Une
collecte a été faite à Luc par des baigneurs, en faveur du matelot et
de la famille du capitaine ; elle a produit 600 fr. environ.
Le
cadavre du capitaine a été retrouvé en face de Bernières.
(Source : Le journal de Honfleur)
Août
1856 - Un naufrage. -
Le sloop « Désirée-Alexandrine » qui, ainsi que
nous l’avons rapporté dans notre dernier numéro, a fait naufrage, le
18, sur les roches de Luc, où l’avait drossé une forte brise de nord
est, appartenait au port de Honfleur, il jaugeait de 25 à 50 tonneaux.
La
veille, il était sorti de Caen, avec un chargement de diverses
marchandises pour Rouen. On se rappelle que de trois personnes qui se
trouvaient à bord, deux ont péri ; le capitaine Simon et son propre
fils. Le pauvre enfant était en vacance et son père l’avait emmené
avec lui par partie de plaisir.
Le
corps du capitaine a été retrouvé dès le 19, devant Bernières. et
celui de son fils, le 25, sur la plage de Luc, à 500 mètres environ
des bains. (Source : Le journal de Honfleur)
Septembre
1856 -
On lit dans le Journal. -
Samedi
dernier, le nommé Pain (Pierre), poissonnier,
demeurant à Luc-sur-Mer, et soumis à la surveillance perpétuelle, a
rompu son ban. On ignore où peut-être le lieu de sa retraite. Le motif
de sa disparition serait un vol. Il se serait emparé d'un cheval au
préjudice d'un cultivateur des environs. Son frère, le nommé Pain
(Jean), pécheur, a été arrêté mercredi, à Lion, sous l'inculpation
de complicité et mis à la disposition de M. le Procureur impérial. (Source :
L’Indicateur de Bayeux)
Janvier
1859 - Des récompenses.
- Sur
la proposition de M. le commissaire de l'inscription maritime à Caen,
S. Exc. le ministre de la marine vient d'accorder, par une décision du
31 décembre dernier, deux médailles d'argent de 2e classe
aux matelots Lemarchand (Alexandre-Victor-Constantin), de Luc-sur-Mer,
et Duval (Pierre-Etienne), de Ver, et un témoignage officiel de
satisfaction au maître au cabotage, Tessel (Jacques-Théogène),
d'Ouistreham, commandant la goélette la « Louise »,
de Caen.
Ces
récompenses ont été méritées par ces marins pour leur belle
conduite dans le sauvetage de l'équipage du sloop « Espérance »,
d'Isigny, qui, le 10 octobre dernier, était sur le point de sombrer
dans la baie de Caen, lorsque la « Louise », revenant
de Sunderland, aperçut ses signaux et fut assez heureuse pour arracher
à une mort imminente les trois marins de Courseulles qui formaient
l'équipage en détresse.
A
peine le sauvetage fut-il effectué, que l’ « Espérance »
coulait sous les yeux des deux équipages.
Dans
cette circonstance, les matelots Lemarchand et Duval, qui montaient le
canot sauveteur, coururent les dangers les plus sérieux, la mer étant
très houleuse et menaçant à chaque instant de les submerger. (
Source : L’Indicateur de Bayeux)
Janvier
1859 -
Il n’y a plus d’hiver.
- Le
crédit de M. Babinet commence à baisser, depuis que l'atmosphère a eu
le mauvais goût de donner le plus complet démenti à ses prédictions.
M. Babinet avait prédit que l'hiver de 1858 à 1859 serait un des plus
rigoureux que nous ayons eus, et que cette rigueur, excessive
commencerait à se faire sentir surtout à partir du 15 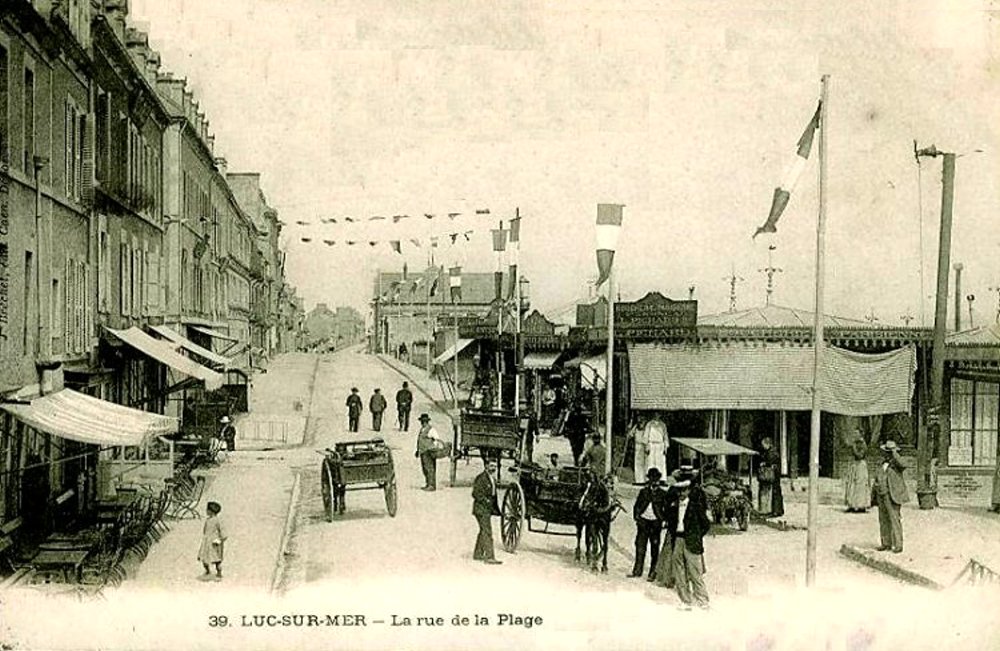 décembre
jusqu'au 1er janvier. Or, le 1er janvier est
passé, et l'on peut dire, sans crainte d'être démenti par personne,
que nous n'avons pas encore eu d'hiver, il est vrai que M. Babinet
explique qu'il a pu se tromper de quelques jours dans ses calculs, mais
il ajoute qu'il maintient sa prédiction qui commencera très
certainement à se réaliser à partir du 15 du présent mois. (
Source : L’Indicateur
de Bayeux) décembre
jusqu'au 1er janvier. Or, le 1er janvier est
passé, et l'on peut dire, sans crainte d'être démenti par personne,
que nous n'avons pas encore eu d'hiver, il est vrai que M. Babinet
explique qu'il a pu se tromper de quelques jours dans ses calculs, mais
il ajoute qu'il maintient sa prédiction qui commencera très
certainement à se réaliser à partir du 15 du présent mois. (
Source : L’Indicateur
de Bayeux)
Janvier
1859 - Avis. -
La Société
impériale et centrale de médecine vétérinaire, consultée par S.
Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
sur la loi des vices rédhibitoires, vient de décider que la
méchanceté et la rétivité seraient comprises désormais dans la
nomenclature des vices qui peuvent donner lieu à la résiliation des
marchés. ( Source : L’Indicateur de Bayeux)
Août
1860 - Cour d’Assises du Calvados.
-
Présidence de M. le conseiller Reboul.
Audience du 4 août.
L'accusation
est soutenue par M. d'Englesqueville, substitut de M. le
procureur-général.
Lemarchand
(Désiré-Constantin), 36 ans, marin, domicilié à Luc-sur-Mer.
Cet
homme avait à rendre compte devant le jury du Calvados d'un acte de
brutalité inouïe.
Embarqué
comme matelot à bord du navire « Augustine-Amélie »,
se rendant à la pèche aux huîtres, il avait sous ses ordres un jeune
mousse de la Délivrande, nommé Lebourgeois, à peine âgé de 11 ans.
Vers
la fin d'avril 1859, au moment où le navire quittait le port de
Saint-Valery, trouvant que cet enfant n'exécutait pas assez promptement
un ordre qu'il venait de lui donner, Lemarchand lui porta un violent
coup de pied qui l'atteignit dans la région du bas-ventre. L'enfant se
plaignit d'une très vive douleur, fut souffrant tout le reste de la
traversée, qui dura encore quinze jours, et put à peine continuer son
service.
Arrivé
à la Délivrande, il fut visité par un médecin, qui trouva son état
fort grave, et le fit entrer à l'Hôtel-Dieu de Caen, le 18 juin 1859.
Ce pauvre enfant y est depuis cette époque, et, malgré les bons soins
dont il a été l'objet et sa robuste constitution, son état n'a fait
qu'empirer, ses os ont été atteints par la carie, et tout fait
redouter une fin prochaine.
Lemarchand
niait l'acte de brutalité inqualifiable qui lui était reproché, mais,
indépendamment du témoignage de l'enfant, précis et persistant, il
était accusé par deux autres matelots, témoins de son action, et
d'ailleurs par les médecins qui déclarent que les accidents éprouvés
par l'enfant ne peuvent s'expliquer que par un coup reçu de la manière
qu'il indique.
Le
jury, écartant la circonstance aggravante d'incapacité de travail
pendant plus de trente jours, Lemarchand n'a plus été coupable que
d'un simple délit, pour lequel la Cour lui a infligé quatre mois
d'emprisonnement.
Défenseur,
Me Carel.
( L’Ordre et la Liberté)
Août
1862 - Une messe de charité. - Jeudi
prochain, 21 août, à trois heures de l'après-midi, un sermon de
charité sera prêché, dans la chapelle du nouveau Luc, par le
Révérend père J. Jelewicki, supérieur de la mission polonaise, à
Paris. (l’Ordre et la Liberté)
Janvier
1863 -
Le bureau de poste. -
Nous
apprenons que le bureau de poste de Luc, qui était situé, comme on
sait, à l'extrémité de cette commune, c'est-à-dire à
l'embranchement  de
la route qui conduit au Vieux-Luc, distant de plus d'un kilomètre,
vient d'être installé sur un point plus central par rapport aux
localités qui en dépendent. de
la route qui conduit au Vieux-Luc, distant de plus d'un kilomètre,
vient d'être installé sur un point plus central par rapport aux
localités qui en dépendent.
Placé
aujourd'hui près de l'hôtel de la Belle-Plage, à la limite même de
Luc et de Langrune, ce bureau va évidemment, par sa nouvelle situation,
donner une impulsion plus active au service, et les habitants comme les
nombreux baigneurs qui visitent cette partie de nos côtes pendant la
belle saison auront à se féliciter de cette amélioration qui depuis
longtemps était nécessaire. (l’Ordre
et la Liberté)
Juillet
1863 - Un naufrage.
- Un
épouvantable malheur est venu jeter jeudi dernier, la consternation
parmi les baigneurs et les pêcheurs de Luc-sur-Mer.
Vers
trois heures et demie de l'après-midi, à mer basse et pendant que la
plage était couverte de promeneurs, une embarcation, la « Mouette »,
portant trois pêcheurs, les nommés Victor Flambard ; Alexandre Hue,
dit Romain, et Émile Flambard, qui venaient de placer leurs filets, a
sombré à 2 kilomètres à peine du rivage, contre les brisants qui
avoisinent le rocher Guillot.
Le
canot monté par ces trois malheureux portait beaucoup de toile, et
renversé par un violent coup de vent, il s'est immédiatement trouvé
rempli par les vagues très creuses en cet endroit, et n'a pu se
relever.
L'un
des trois hommes, Victor Fambard, était très infirme et ne marchait
qu'à l'aide de béquilles, cependant on l'a vu quelques instants,
cramponné à un aviron et faisant des efforts désespérés pour se
sauver.
Aussitôt
que cet accident a été aperçu de la côte, un assez grand nombre de
voyageurs, parmi lesquels nous avons remarqué M. Jouen, avocat à Caen,
se sont jetés à la mer et ont pu atteindre le rocher Guillot, mais
leurs recherches ont été vaines et leur courage inutile. Les trois
infortunés pêcheurs avaient été engloutis et emportés par le flot.
Nous
renonçons à peindre les scènes de désolation qui se passaient sur le
rivage où étaient accourus les parents des naufragés.
Victor
Flambard était âge de 38 ans et marié depuis fort peu de temps ;
Émile Flambard était âgé de 14 ans à peine.
Une
autre embarcation, le « Prince-Impérial »,
commandée par Paul Lemarchand et montée par quatre hommes, se trouvait
au même moment sur le lieu du sinistre. Elle a fait plusieurs
tentatives pour sauver ces malheureux, mais la mer était si houleuse et
le vent qui soufflait du nord-est si actif, que tous ses efforts ont
été infructueux. (Moniteur
du Calvados.)
Juillet
1863 - Des militaire aux champs.
- Le ministre
de la guerre a décidé que cette année, comme les années
précédentes, des militaires seraient mis à la disposition des
cultivateurs qui en auraient besoin pour les travaux des champs, à
défaut d'un nombre suffisant d'ouvriers civils. (l’Ordre et la
Liberté)
Juillet
1863 - Le temps. -
Le
beau temps qui nous favorise d'une façon si exceptionnelle cette année
attire sur nos côtes une affluence considérable de baigneurs. De tous
côtés les plages offrent l'aspect le plus riant et le plus animé.
A
Trouville, le nombre des étrangers est immense, il en est de même à
Cabourg, à Beuzeval, à Houlgate. D'un autre côté, les voitures de M.
Luard, qui ne désemplissent pas, déversent à toute heure des flots de
voyageurs à Lion, à Luc, à Langrune, à Saint-Aubin, à Bernières à
Courseulles, etc... Arromanches n'est pas resté étranger à ce
mouvement, un assez grand nombre de baigneurs s'y sont donné
rendez-vous.
En
ce moment, deux hôtes illustres y sont attendus : le célèbre
historien, M. Thiers ; puis Mme la maréchale Mac-Mahon, duchesse de
Magenta.
 On
annonce pour dimanche prochain, une brillante fête de bienfaisance qui
sera donnée dans le vaste Casino de Cabourg. MM. les administrateurs de
cet établissement ont eu la bonne pensée d'organiser un bal au profit
des pauvres, parmi les souscripteurs on cite le prince et la princesse
de Metternich. (l’Ordre et la Liberté) On
annonce pour dimanche prochain, une brillante fête de bienfaisance qui
sera donnée dans le vaste Casino de Cabourg. MM. les administrateurs de
cet établissement ont eu la bonne pensée d'organiser un bal au profit
des pauvres, parmi les souscripteurs on cite le prince et la princesse
de Metternich. (l’Ordre et la Liberté)
Avril
1864 -
Chemin de fer en projet de Caen à la mer.
- M.
le préfet du Calvados, à la date du 14 avril, a pris l'arrêté
suivant :
Nous,
préfet du département du Calvados, officier de l'ordre impérial de la
Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.
-
Vu la décision, en date du 7 de ce mois, par laquelle M. le
ministre des travaux publics a autorisé M. Mauger (Anthime), demeurant
à Douvres, à faire les études d'un chemin de fer entre Caen et la
mer.
-
Vu l'art. 1382 du Code Napoléon, les lois des 16 septembre 1807
et 3 mai 1841.
Avons
arrêté :
Art.
1er.
M. Mauger et les agents par lui préposés sont autorisés, en
exécution de la décision ministérielle indiquée ci-dessus, à
pénétrer sur les propriétés privées pour étudier le meilleur
tracé de la ligne en projet de Caen à la mer.
Ces
études s'appliqueront aux terrains situés dans les communes de Caen
Venoix, Saint-Contest, Épron, Cambes, Mathieu. Anisy, Anguerny,
Douvres, Luc, Langrune, Saint-Aubin-sur-Mer, Bernières et
Courseulles.
Art.
2.
Une expédition du présent sera adressée à MM. les maires,
pour être affichée aux lieux accoutumés.
Une
expédition sera également transmise à M. Mauger, qui devra, lui et
ses agents, en justifier aux propriétaires, sur leur réquisition, en
prenant envers eux, s'il est besoin, l'obligation écrite de leur payer
les dommages occasionnés. (l’Ordre et la Liberté)
Juin
1864 -
Chemin de Caen à la Mer.
- Il
y a à peine deux mois qu'il est question d'un chemin de fer de Caen à
la mer, que déjà, tant est vive l'impatience du public, on voudrait
voir cette nouvelle ligne livrée à la circulation. Mais les choses ne
vont pas si vite, et, avant que le sifflet d'une locomotive ne se fasse
entendre sur les côtes si riantes de Luc ou de Courseulles, il faut
rédiger le projet, étudier le meilleur tracé, le soumettre à
l'approbation, puis faire les travaux, etc..., etc…, ce qui ne veut
pourtant pas dire que nous sommes condamnés à attendre longtemps
encore l'inauguration du chemin. Non l'entreprise est confiée à des
mains trop habiles et surtout trop actives pour avoir à redouter ce
désagrément. Nous pourrions presque prédire que, le 1er
juillet de l'année prochaine, la population caennaise pourra déjà se
rendre à Luc.
La
ligne projetée, qui s'étend de Caen à Courseulles, aura un parcours
total de 24 kilomètres, plus une ligne de raccordement, de 4 à 5
kilomètres, avec le réseau de l'Ouest, elle desservira les stations
suivantes : Caen, Cambes, Mathieu, Douvres, la Délivrande, Luc,
Langrune, St-Aubin, Bernières et Courseulles.
La
gare de Caen sera construite en grande partie sur le terrain occupé par
la propriété de M. de Lalonde, place St-Martin. Cette gare sera
monumentale, et l'idée générale qui a présidé à la composition de
sa façade offre une grande analogie avec les dessins de la magnifique
gare de Strasbourg, à Paris. Une colossale statue de Notre-Dame de la
Délivrande ornera son fronton, et, bénissant l'entreprise, elle
semblera la présider.
L'étude
des 24 kilomètres est terminée, mais le projet ne sera complètement
rédigé que dans un mois environ, époque à laquelle il sera soumis à
l'approbation de l'administration. Les travaux ne pourront donc être
commencés qu'au mois de septembre prochain, c'est-à-dire après les
récoltes.
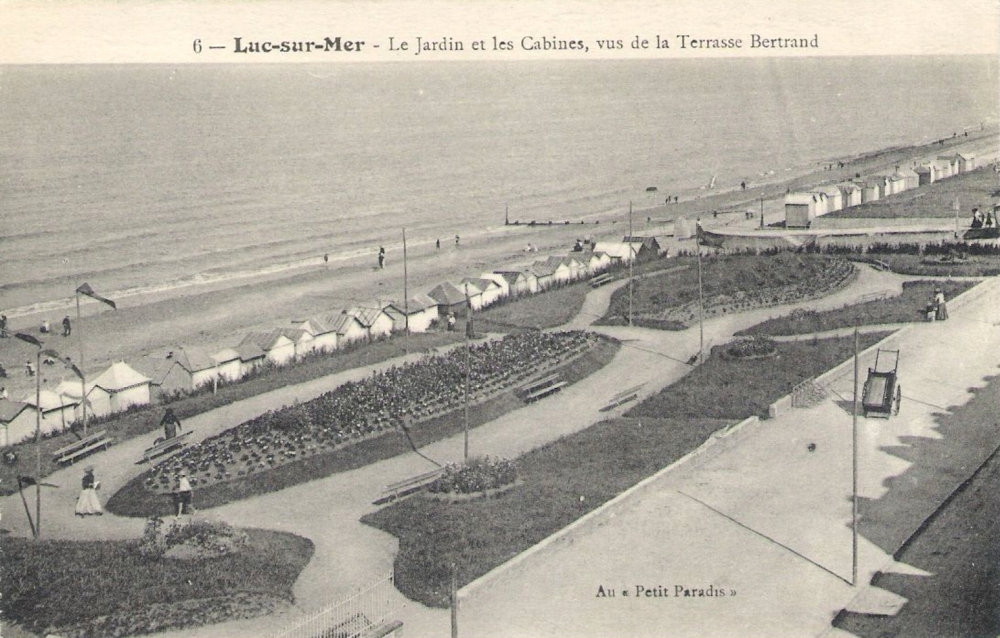 Il
n'y aura de travaux importants, dans toute l'étendue de la ligne, que
pour monter de Caen sur les hauteurs de Couvrechef, et pour descendre
des hauteurs de Mathieu jusqu'au niveau du rivage de Luc, et encore
l'importance de ces travaux n'est-elle que secondaire. Il
n'y aura de travaux importants, dans toute l'étendue de la ligne, que
pour monter de Caen sur les hauteurs de Couvrechef, et pour descendre
des hauteurs de Mathieu jusqu'au niveau du rivage de Luc, et encore
l'importance de ces travaux n'est-elle que secondaire.
Dans
tout le parcours, les plus fortes pentes n'excèderont pas un
centimètre par mètre, et les rayons des courbes ne seront nulle part
inférieurs à 500 mètres. Ce renseignement démontre péremptoirement
que l'exploitation sera plus facile que sur beaucoup de lignes de
premier ordre. Aussi la dépense totale n'excèdera-t-elle pas quatre
millions.
La
ligne de Courseulles se raccordera avec le chemin de fer de Paris à
Cherbourg, dans la prairie, derrière l'établissement du Bon-Sauveur,
au moyen de l'embranchement de 4 à 5 kilomètres dont nous avons déjà
parlé. Certains trains, et notamment l'express venant de Paris, seront
en correspondance immédiate avec le service de Courseulles, à cet
effet, une machine légère opérera le transport d'une gare à l'autre.
Le
trajet de Caen à Courseulles s'effectuera en 55 ou 60 minutes. Le
dimanche matin, le mouvement des voyageurs étant plus considérable,
des départs auront lieu d'heure en heure de Caen pour Luc, où on
arrivera une demi-heure après.
Il
y aura, bien entendu, une très grande amélioration dans le prix du
transport, on parle de billets d'aller et retour, de Caen à Luc,
moyennant 1 fr..
Ainsi
qu'il était facile de le concevoir, l'administration n'a rencontré
aucun obstacle de la part des cinq ou six cents propriétaires auxquels
elle a dú s'adresser pour obtenir des renseignements, aux termes de
l'arrêté de M. le préfet du Calvados, en date du 14 avril dernier,
tous ont montré une grande obligeance envers les agents de la nouvelle
entreprise. L'aplanissement
de toutes les difficultés matérielles laisse donc espérer que la
ligne de Caen à Luc sera livrée à la circulation le 1er
juillet 1865.
On
dira peut-être qu'il sera difficile de réaliser un projet aussi
important dans l'espace de dix mois. Nous n'aurons qu'une réponse à
opposer à cette objection, c'est que l'activité si connue de M. Mauger
et de M. l'ingénieur chargé du projet saura bien suppléer à la
brièveté du temps qui existe entre le mois de septembre et le mois de
juillet. (l’Ordre et la Liberté)
Octobre
1864 -
Postes. -
Entreprise du
transport des dépêches en voiture de Caen à Courseulles, nº 1, par
la Délivrande et Luc-sur-Mer : distance de 25 kilomètres environ à
exécuter à un ordinaire.
Les
personnes qui désireraient concourir à l'adjudication de l'entreprise
du service des dépêches sur la route ci-dessus désignée sont
invitées à se présenter tous les jours, de dix heures du matin à
quatre heures du soir, jusques et compris le 28 du mois d'octobre, aux
bureaux des postes de Caen ou de Courseulles, pour prendre connaissance
des charges de l'entreprise et y déposer leurs soumissions. (l’Ordre
et la Liberté)
Décembre
1864 -
Par décision. - de M. le directeur général
des postes, en date du 13 décembre, les bureaux de distribution
établis dans les communes de Beaumont-en-Auge, Luc-sur-Mer,
Saint-Sylvain et Ussy ont été convertis en direction de poste de plein
exercice. (l’Ordre et la Liberté)
Décembre
1864 -
Tribunal correctionnel de Caen.
- Présidence
de M. Lentaigne,
vice-président. M.
Bailleul, substitut de M. le procureur impérial, occupant le siége du
ministère public.
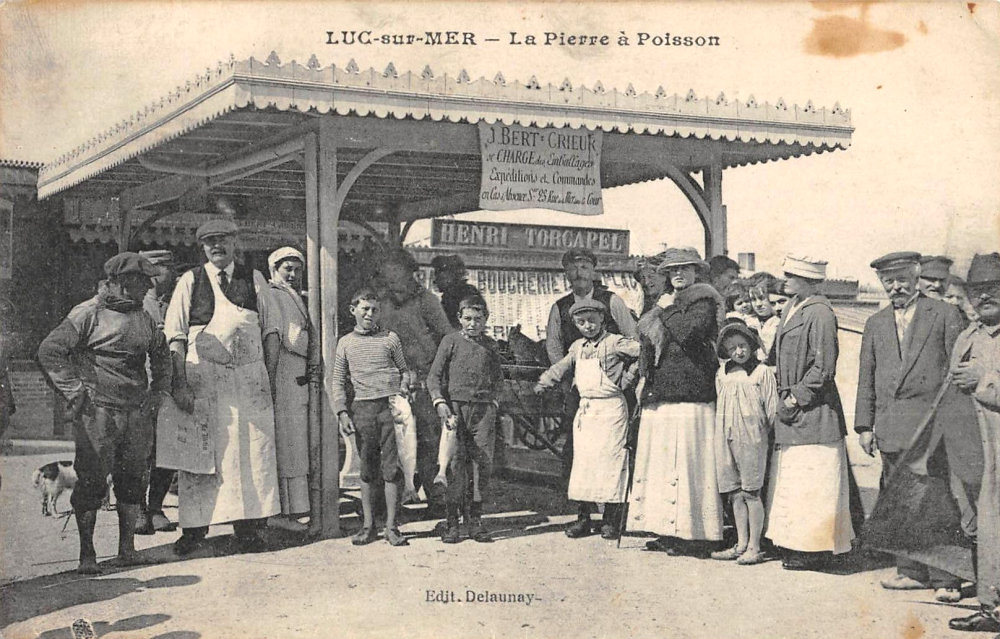 Audience
du 3 Décembre1864. Audience
du 3 Décembre1864.
-
Jacques-Théophile-Henri Blanc, baigneur à Luc, est prévenu
d'avoir, à Luc-sur-Mer, le 3 septembre 1864, outragé par paroles et
menaces l'adjoint au maire de ladite commune, à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, en le traitant de canaille, de vaurien, etc…
M.
Félicien Lemarchand, adjoint au maire de Luc, faisait une quête, parmi
ses concitoyens, au profit d'une parente du prévenu, qui est infirme et
incapable de travailler.
Celui-ci
se permit, le 3 septembre dernier, d'aller chez lui, lui demander compte
de l'emploi des deniers de cette quète, et s'emporta envers lui en
injures et menaces, le traitant de canaille, de vaurien, etc..., etc...,
et lui disant que, s'il méritait une calotte, il la lui donnerait.
A
l'audience, Blanc avoue les faits délictueux qu'on lui reproche, mais
il déclare qu'il considérait M. Lemarchand, quand il l'insultait,
comme un homme privé et non comme adjoint, magistrat de l'ordre
administratif, que c'était comme homme privé, en effet, et non en sa
qualité d'adjoint, que M. Lemarchand faisait la quête dont il est
question.
Le
Tribunal, adoptant ce système de défense, condamne le
sieur Blanc, avec admission de circonstances atténuantes, à 16 fr.
d'amende.
Il
n'avait pas de défenseur. (l’Ordre et la Liberté)
Mai
1865 - Par
arrêté du 26 de ce mois. - M.
Guérard-Delaville a été nommé maire de Luc-sur-Mer, en remplacement
de M. Pichon, démissionnaire, pour cause de mauvaise santé.
Espérons
que, grâce à l'intelligence et à l'activité du nouveau maire, Luc
pourra sortir de l'état d'abandon dans lequel il était plongé depuis
plusieurs années.
Le
projet de chemin de fer, vers le littoral, voté en principe par le
Conseil général, le 27 août dernier, a déjà donné de l'impulsion,
et une dizaine de constructions ont été faites à Luc, depuis la
saison dernière.
La
petite brochure que nous avons publiée dans le numéro de notre journal
du 11 juin, sur l'efficacité de l'eau de mer à Luc, par M. le docteur
Alfred Liégard, a aussi considérablement aidé le directeur des bains.
En effet, de vastes cabinets, où sont établis des appareils par
l'hydrothérapie marine, ne laissent plus rien à désirer aux malades.
Les
bains chauds qui se donnent en très grand nombre, sont très
fréquentés par les baigneurs et les personnes convalescentes.
Entr'autres
améliorations, on voudrait voir M. Aubergeon, le directeur des bains et
du buffet, faire faire un petit casino sur l'emplacement existant entre
la salle de billard et les cabanes des bains froids.
Les
dunes si belles et si verdoyantes, plantées de tamaris, et entourées
de petites palissades, feraient assurément d'agréables squares.
Laissons
à M. Guérard-Delaville l'initiative d'autres améliorations dont la
réalisation peut être immédiate. (Journal de Valognes )
Mars
1866 -
Les bains de mer. -
Les habitants du littoral
font déjà de grands préparatifs pour la saison des bains de
mer. Cette saison est l'une de leurs principales ressources, grâce à
la vogue actuelle de la villégiature maritime. Il n'est donc pas
étonnant si chaque localité cherche
à se surpasser pour offrir aux étrangers toutes les séductions
d'agrément et de confortable.
A
Luc-sur-Mer, la masure qui offensait la vue, vis-à-vis de l'hôtel de
M. Francis, a été démolie et le chemin qui conduit à la mer a été
réparé et élargi de plusieurs mètres. On y construit en ce moment
des maisonnettes destinées au petit commerce, ce qui ajoutera encore à
l'animation de la plage.
 Lion-sur-Mer,
Langrune, Saint-Aubin ne restent pas non plus inactifs. Dans cette
dernière localité, un hôtel-restaurant va être installé pour la
belle saison, et la municipalité de cette commune prend
toutes les mesures nécessaires pour en rendre le séjour plus agréable
que jamais aux étrangers. Lion-sur-Mer,
Langrune, Saint-Aubin ne restent pas non plus inactifs. Dans cette
dernière localité, un hôtel-restaurant va être installé pour la
belle saison, et la municipalité de cette commune prend
toutes les mesures nécessaires pour en rendre le séjour plus agréable
que jamais aux étrangers.
Comme
on le voit, nos populations maritimes ne restent pas en arrière du
progrès, et elles comprennent enfin que les bonnes récoltes ne se font
qu'avec de bonnes semailles.
Septembre
1866 -
Un accident. -
Le 26 septembre, le sieur Aubey, capitaine au cabotage, à Luc,
préparait des filets qu'il avait mis dans une chaudière. Il les retira
au moyen d'un croc, lorsqu'au
même moment sa casquette tomba dans la chaudière. Il voulut la
reprendre, mais il se pencha trop et tomba à son tour. La chaudière,
profonde de trois mètres environ, était à moitié remplie d'eau en
ébullition.
On
s'empressa de le retirer, mais le lendemain il a succombé après
d'horribles souffrances.
Mai
1867 -
Découverte d'un cadavre. - Le
21 mai courant, vers les six heures du matin, le cadavre d'un inconnu a
été trouvé à Luc-sur-Mer sur la plage par un préposé de la douane.
D'après
les renseignements obtenus, tout porte à croire que ce cadavre et celui
d'un sieur Chauvin Jean, âgé d'environ 55 ans, originaire des environs
de Blois (Loir-et-Cher).
La
levée et la constatation du cadavre ont fait connaître que ce
malheureux est mort des suites d'une congestion cérébrale.
Juin
1867 -
Le service télégraphique. - D'après
nos derniers renseignements, que nous avons tout lieu de croire puisés
à la bonne source, Luc serait appelé à jouir l'un des premiers, pour
la saison de
bain, d'un service télégraphique.
L'initiative
en serait due à son maire, qui fait en ce moment circuler dans la
commune une liste de souscription dont le produit serait destiné à
faire face aux frais d'installation.
Nous
faisons des vœux sincères pour la plus prochaine réalisation de ce
projet, et pour la complète réussite de l'entreprise qui en sera la
conséquence.
Juin
1867 -
Un acte de courage.
- Le maire de
Luc, M. Guérard-Delaville, nous communique le récit émouvant d'un
acte de courage et de sang-froid, qui vient d'être accompli par un jeune
mousse de 13 ans, originaire de cette commune.
Cet
enfant, qui a nom Polycarpe Salent, était parti vers trois heures
d'après-midi et par un temps magnifique, sur le petit bateau le
« Nain » de Luc, qui était armé en petite pêche.
L'équipage se composait du capitaine, d'un matelot et du jeune mousse.
Ils
avaient à peine de gagné le large, lorsqu'une violente bourrasque vint
assaillir la légère embarcation. Soudain le capitaine et le matelot
sont précipités à la mer.
Le
jeune mousse reste seul sur le pont du bateau, mais loin de céder au
vertige dans son isolement, son sang-froid et son énergie ne font au
contraire que grandir avec le danger.
Vite,
il déroule un fort grelin, et au milieu des éléments en fureur, il
parvient à les jeter aux deux naufragés dont une lutte opiniâtre
contre les flots a déjà brisé les forces.
Le
capitaine s'entoure le bras avec le cordage et en passe l'extrémité à
son compagnon d'infortune, qui se l'attache tant bien que mal autour du
corps.
L'enfant
alors se sentant incapable de hisser un pareil poids à bord de
l'embarcation, obéit à la meilleure des inspirations. Il attache le
bout du grelin qu'il tient entre ses mains au cabestan, et mettant
vigoureusement la manivelle en mouvement, il procède au sauvetage des
naufragés avec toutes chances de succès.
 Dix
minutes après, le capitaine était sauvé. Quant au malheureux matelot,
qui se nommait Paulo, il avait disparu, soit que ses forces l'aient
complètement trahi au dernier moment, soit qu'un commencement
d'asphyxie lui eut fait lâcher trop tôt la corde, il était devenu la
proie des flots. Son cadavre n'a pas encore été retrouvé. Dix
minutes après, le capitaine était sauvé. Quant au malheureux matelot,
qui se nommait Paulo, il avait disparu, soit que ses forces l'aient
complètement trahi au dernier moment, soit qu'un commencement
d'asphyxie lui eut fait lâcher trop tôt la corde, il était devenu la
proie des flots. Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.
M.
le maire de Luc termine en manifestant l'espoir de voir bientôt la
médaille des sauveteurs orner la poitrine du jeune mousse. Nous ne
saurions que nous associer aux voeux de notre honorable correspondant.
De
tels actes sont trop rares dans un âge si tendre, pour ne pas attirer
sur leur auteur de hautes bienveillances.
Juin
1867 -
Une rectification.
- Une double
inexactitude, que nous nous empressons de rectifier, s'est glissée
vendredi dernier dans notre compte-rendu du sauvetage de Luc.
Le
cadavre de la victime, qui se nomme Jean-François Paul Lemarchand (et
non Paulo, comme nous le disions), a pu être presque immédiatement
retiré de l'eau.
Nous
apprenons que M. le maire de Luc, a adressé à M. le Préfet du
Calvados un rapport circonstancié sur la belle conduite du jeune
Salent, et que ce rapport a été immédiatement transmis au vice-amiral
commandant la division maritime.
Août
1867
-
Le bureau télégraphique.
- Grâce à l'initiative de M. Grard-Delaville,
maire, un bureau télégraphique est ouvert à Luc-sur-Mer. Le public y
sera admis à présenter ses dépêches tous les jours, de 9 heures du
matin à midi, et de 2 heures à 7 heures du soir, les dimanches et
jours fériés, de 8 heures et demie à 9 heures et demie du matin et de
5 heures à 6 heures du soir.
Mai
1868 -
Le climat. -
L'élévation de la température qui n'a cessé de régner
pendant la majeure partie du mois qui se termine, est un événement
assez rare dans nos climats, où la chaleur n'atteint son maximum que
vers le mois de juillet.
Voici
à cette occasion la nomenclature des plus fortes chaleurs observées
depuis un siècle et demi :
En
1702, le thermomètre monta à 39 degrés centigrades au dessus
de zéro.
En
1753 et 1793, à 38 degrés.
En
1825, à 37 degrés.
En
1800 et en 1830, à 36 degrés.
La
moyenne de la chaleur des étés et de 30 degrés. Cette moyenne à
presque été atteinte dans la dernière quinzaine de mai 1868.
Juin
1868 -
Le service télégraphique.
- Lundi dernier le service télégraphique de Luc-sur-Mer
a été ouvert.
En
ce moment, on construit dans cette commune un Casino, qui sera édifié
sur la plage, à l'alignement des bains chauds. La salle principale aura
onze mètres de long sur sept de largeur.
L'ouverture
aura lieu du 10 au 15 juillet.
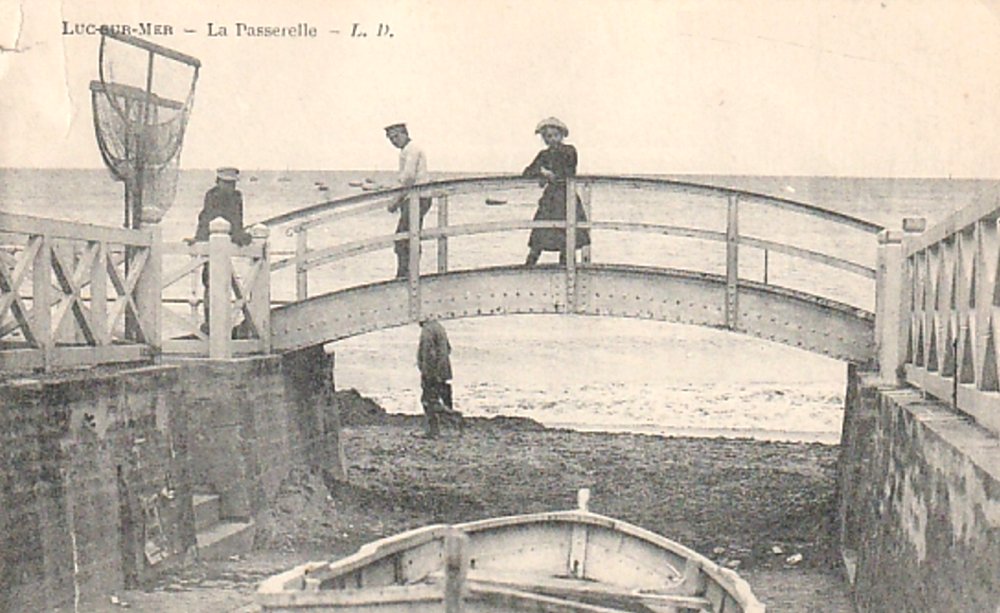 Juillet
1868 -
Inauguration. - Mardi
prochain, 21 juillet, à deux heures et demie aura lieu, dans la
chapelle du Nouveau-Luc, l'inauguration d'un orgue. Juillet
1868 -
Inauguration. - Mardi
prochain, 21 juillet, à deux heures et demie aura lieu, dans la
chapelle du Nouveau-Luc, l'inauguration d'un orgue.
Il
y aura sermon par M. l'abbé Lepretre, aumônier de Beaulieu, et Salut
solennel pendant lequel des solos seront chantés par M. Patriosi,
baryton soliste de
Saint-Pierre de Rome.
Août
1868 -
Un rappel. -
Nous croyons le moment opportun pour appeler que le 23 juillet,
la Cour impériale d'Aix a décidé que le fait de se baigner sans
vêtement constitue non pas seulement
une contravention de police, mais bel et bien un outrage public à la
pudeur prévue par l'art. 330 du Code pénal et puni, sauf l'admission
de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende de 16 à 200 fr.
Août
1868 -
Décision du Conseil général.
- La session
du Conseil général, commencée le lundi 24 août, a été terminée
lundi dernier, à trois heures.
Parmi
des décisions prises par le Conseil, nous devons une mention toute
particulière à l'approbation qu'il a donné, samedi, à la
construction des chemins de fer départementaux :
1°
Chemin de fer de Caen à Courseulles, passant par Cambes,
Mathieu, Douvres, Luc, Langrune, Saint-Aubin, Bernières.
2°
D'Orbec à Lisieux, sur une longueur de 16 kilomètres.
3°
De Falaise à Pont-d'Ouilly, à un point de raccordement sur la
ligne de Caen à Flers.
Septembre
1868 -
Un incendie. -
Un incendie qui pouvait avoir des suites plus graves, s'est
déclaré jeudi la nuit à Luc, sur le bord de la mer, dans l'écurie du
sieur Baudouin, maître d'hôtel.
Heureusement
qu'un marchand de fagots, qui avait ses deux chevaux dans l'écurie s'en
est aperçu. Vite il a coupé les longes de ses chevaux, et les a fait
sortir de l'écurie qui s'écroulait un instant
après.
Septembre
1868 -
Une belle fête. - Dimanche
matin, à l'occasion de la fête de Luc-sur-Mer, il a été distribué
environ 220 kilog. de pain aux pauvres de la commune.
Le
soir au bal, qui avait réuni une société d'élite, une quête au
profit des indigents a été faite par Mme Lapierre, accompagnée de M.
Guerard-Delaville, maire de
Luc.
Octobre
1868 -
Découverte d'un cadavre. -
Mercredi, vers huit heures du matin, le sieur Langrais,
cantonnier à Démouville, a trouvé sur la route qui traverse la
commune de Banneville, le cadavre du nommé Honoré Quesnel, âgé de 50
ans, cultivateur à Luc-sur-Mer.
La
mort de cet homme est attribuée à une asphyxie déterminée par
l'ivresse.
Mars
1869 -
Un ouragan. - L'ouragan
du 2 mars a occasionné des dégâts assez importants sur divers points
de notre département.
A
Luc, le clocheton de la
chapelle du Nouveau-Luc a été renversé dans la matinée par une
violente rafale. En tombant, l'une des pierres de ce clocheton après
avoir défoncé la toiture, le  plafond
et brisé la balustrade, a pénétré dans la chapelle, où elle a
creusé dans le pavé un trou d'une profondeur de 20 centimètres
environ. Il n'y avait personne dans la chapelle en ce moment. Les autres
pierres sont tombées ça et là sur le mur d'enceinte du monument et en
ont démoli une vingtaine de mètres. La couverture en ardoises et les
enduits en plâtre ont éprouvé des détériorations importantes.
L'orgue a également souffert. On évalue la perte totale a près de
3000 francs. plafond
et brisé la balustrade, a pénétré dans la chapelle, où elle a
creusé dans le pavé un trou d'une profondeur de 20 centimètres
environ. Il n'y avait personne dans la chapelle en ce moment. Les autres
pierres sont tombées ça et là sur le mur d'enceinte du monument et en
ont démoli une vingtaine de mètres. La couverture en ardoises et les
enduits en plâtre ont éprouvé des détériorations importantes.
L'orgue a également souffert. On évalue la perte totale a près de
3000 francs.
A
Lion, la mer, poussée par le vent, à défoncé le mur de soutènement
situé en face du Casino. Dans la direction de Luc, elle a submergé une
certaine quantité de terrains, et amené des éboulements de la dune.
A
Langrune, la mer a également envahi le jardin de M. de Franquenet sur
une longueur de plus de 20 mètres.
Aux
environs de Bayeux et de Pont-l'Evêque, bon nombre des pommiers ont
été arrachés par le vent.
A
Bayeux même, l'ouragan a renversé la partie supérieure de pinacle sur
le côté méridional du portail de la cathédrale.
A
Trouville, la mer était tellement grosse qu'elle a submergé les quais
à l'heure de la marée, et que ses larmes ont déferlé jusque
par-dessus le pont qui traverse la Touques.
Près
de Honfleur, la tempête a fait éprouver quelques dégâts aux
propriétés longeant la mer, mais sans pertes considérable.
A
Cabourg, la tempête s'est élevée avec une telle impétuosité,
que la mer a remporté la digne des bains de Cabourg, passé par-dessus
la route et envahi des maisons qui se trouvent à la descente de
Caumont, au pied de la falaise, le long du chemin du Mauvais-Pas.
La
mer a également fait sentir ses ravages à Houlgate, où elle a démoli
la digue de Mlle Dupont de
l'Eure.
Mars
1869 -
La tempête du 20 mars. -
Samedi dernier, on a relevé sur le rivage de Port-en-Bessin que
la mer venait d'y porter, un cadavre d'homme.
Il
a été trouvé à Luc une planche de poulaine en chêne, peinte
en noir et portant en lettres fouillées au ciseau le nom de « Tobina ».
Depuis
dimanche, on a recueilli sur la plage entre Langrune et Ouistreham, une
assez grande quantité de madriers et de planches en bois blanc,
marqués SS. G. d'un bout et X R de l'autre. Parmi ces épaves, on a
trouvé un bout-dehors de foc mesurant 7 mètres 40 de long. Toutes ces
épaves semble être à la mer depuis peu de temps. Ont fait
naturellement sur leur provenances des tristes conjonctures.
Mai
1869 -
Un bateau à la côte. - Le
brick français « Anne et Marie », capitaine Even, qui se
trouvait à la côte à Luc depuis les dernières tempêtes, en a été
retiré et conduit à Ouistreham par le remorqueur "Commerce"
se rendant à Caen, pour suivre ses
réparations.
Mai
1869 -
Un bateau à la côte. - Le
brick français « Anne et Marie », capitaine Even, qui se
trouvait à la côte à Luc depuis les dernières tempêtes, en a été
retiré et conduit à Ouistreham
par le remorqueur "Commerce" se rendant à Caen, pour suivre
ses réparations.
Août
1869 -
Fait divers.
- Samedi
dernier, à Luc-sur-Mer, un cheval attelé à la voiture d'un marchand
de moules, est tombé mort en gravissant la montée qui réunit la plage
et les dunes.
 Les
baigneurs se sont empressés de faire entre eux une collecte, dont le
montant a atteint le chiffre de 70 à 80 francs. Les
baigneurs se sont empressés de faire entre eux une collecte, dont le
montant a atteint le chiffre de 70 à 80 francs.
Septembre
1869 -
Fait
divers.
- Nous avons
dit dans notre dernier numéro qu'un
cadavre avait été trouvé entre Luc et Langrune. Le corps a été
reconnu pour être celui
du nommé Jean-Baptiste
Bénouville, âgé de 70 ans, cultivateur et maçon, demeurant à
Douvres, il avait au cou une pierre de 5 kilogs attachée avec une
corde. On attribue ce suicide à une querelle survenue entre ce
malheureux et sa femme.
Octobre
1869 -
Fait divers.
- Une
certaine appréhension paraissant exister au sujet de la grande marée
attendue sur les côtes de la Manche dans les premiers jours du mois
prochain, le
lieutenant-gouverneur de Jersey a consulté à ce sujet le «
département météorologique » de Londres qui a répondu que la plus
haute marée aura lieu le 6-7 octobre, d'après les calculs des tables
des marées de l'Amirauté, et qu'il y a toute raison de croire qu'elle
excédera seulement de quelques pouces la hauteur des marées ordinaires
d'équinoxe.
Octobre
1869 -
Le chemin de fer de
Caen à Courseulles.
- On
s'occupe activement des formalités à remplir pour commencer le chemin
de fer de Caen à Courseulles. Les entrepreneurs traitent à
l'amiable avec les propriétaires des terrains nécessaires à la
construction de la voie, et, en cas de contestation, le jury va être
tout prochainement appelé à statuer.
S'il
ne surgit aucune difficulté sérieuse, si l'hiver ne vient pas par sa
rigueur, interrompre, les travaux, tout porte à croire que la partie
comprise entre Caen et Luc-sur-Mer sera terminée et livrée à la
circulation pour le mois de juillet prochain.
Beaucoup
de personnes se demandent quel sera le prix des places ? Si les
entrepreneurs s'en tiennent aux conditions stipulées dans le Cahier des
charges, le prix du voyage devra être, en 3e
classe, à peu près le même que par les voitures
publiques.
Mars
1870 -
La tempête.
- Le
mauvais temps de la semaine dernière a porté ses fruits. La côte de
Courseulles à Ouistreham se couvre de débris et d'épaves. Dimanche
dernier, on apercevait entre Saint-Aubin et Langrune, à peu de distance
du rivage, une portion considérable d'un grand navire, dont la
nationalité n'a pu être reconnue, les pêcheurs rentrant au port ont
rencontré en mer des planches, des madriers, dont l'abord n'était pas
sans danger, des balles de coton et de tabac qui indiquaient un naufrage
dans nos parages. Un bateau de Courseulles employé à la pêche des
huîtres a ramené dans sa drague une botte neuve, dans laquelle se
trouvait la jambe du propriétaire, paraissant récemment détachée du
tronc. Aucun cadavre n'a été signalé.
Juin
1870 -
Fait
divers.
-
l e 16 juin, vers 2
heures du soir, un incendie dont la cause est inconnue, a détruit trois
corps de bâtiments ainsi que divers instruments aratoires, situés à
Luc-sur-Mer, appartenant
aux nommés Charles et Achille Letellier
et Constant Flambard, propriétaires. Perte
: 3.750 fr.
Juillet
1870 -
Fait divers.
- Des
manifestations patriotiques ont eu lieu sur notre littoral. A
Lion-sur-Mer, la Marseillaise et le Chant du Départ ont été chantés.
A Luc-sur-Mer, on a brûlé et bombardé
en effigie M. de Bismark, aux applaudissements des personnes accourues
pour assister à ce réjouissant spectacle.
Septembre
1870 -
Les espions.
- Des
espions prussiens sont signalés sur notre littoral. A Langrune, une
visite domiciliaire a été faite pour arrêter des marchands
colporteurs dont les allures étaient suspectes. Lundi,
entre Luc et Lion, trois individus
étrangers ont été arrêtés et dirigés sur Caen.
|